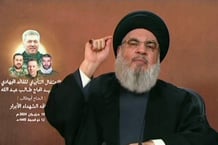Forces armées tunisiennes : 2e partie, la menace jihadiste
Laurent Touchard travaille depuis de nombreuses années sur le terrorisme et l’histoire militaire. Il a collaboré à plusieurs ouvrages et certains de ses travaux sont utilisés par l’université Johns-Hopkins, aux États-Unis. Ce billet en deux parties est consacré à l’histoire des forces armées tunisiennes.

Le mont Chaambi, où l’armée tunisienne a fait les frais de la présence jihadiste. © AFP
Dans ses préceptes stratégiques, Habib Bourguiba façonne l’apolitisme de l’armée. Doctrine que reprend Ben Ali. Quant à l’apolitisme en question, il s’exprime aussi bien lors de l’éviction de l’un que de la chute de l’autre. Dans le premier cas, l’armée ne s’oppose pas à l’accession au pouvoir du "général du ministère de l’Intérieur" qu’est Ben Ali, sécuritaire plus que militaire. Dans le second cas, lors de la révolution tunisienne, l’armée se déploie pour assurer la sécurité des bâtiments publics. Mais, son chef, le général Ammar, refuse de relayer l’ordre d’ouvrir le feu sur les manifestants. Au lieu de cela, il commande à la troupe d’intervenir pour protéger la foule contre les éléments du mi-nistère de l’Intérieur fidèles à Ben Ali (dont des snipers). Ainsi, l’armée remplit-elle sa mission : défendre la Nation, sans pour autant être l’instigatrice des événements qui l’agitent. Il y a là ce que l’on pourrait appeler une "passivité active", induite par la doctrine de la "faiblesse calculée" de Bourguiba. Si ce principe a eu pour mérite d’éviter un bain de sang lors de la Révolution tunisienne, quelle est sa valeur pour lutter contre le péril terroriste, jusque-là relativement inconnu ?
>> Lire aussi la première partie de ce billet : Forces armées tunisiennes : l’héritage…
Face à la crise libyenne
Au cours des mois qui suivent la fin du régime de Ben Ali, l’armée gère avec beaucoup d’efficacité, les conséquences d’une autre révolution, celle-ci chez le voisin libyen. Sa présence à la frontière dissuade les troupes de Kadhafi de poursuivre les insurgés sur le territoire national. Elle désarme ces derniers de manière organisée, elle prend en charge, avec l’aide de volontaires civils, au moins 500 000 réfugiés (la cohésion armée-Nation chère à feu Bourguiba…). Quant à la Marine, elle vient au secours d’un nombre toujours plus grand de pauvres ères qui tentent de traverser la Méditerranée sur des esquifs à bout de souffle. L’appréciation est simple : l’armée tunisienne accomplit un formidable travail humanitaire, dans des conditions particulièrement dures, dans un contexte explosif.
La nature de l’ennemi terroriste
En janvier 2012, à la suite de la prise d’otages d’In Amenas en Algérie, des éléments du Groupement de forces spéciales (GFS) sont déployés, par précaution, sur différents points sensibles dans le sud du pays. Le risque est bien réel : depuis le début 2011, quelques membres de la katiba d’Abou Zeid se sont infiltrés sur le territoire tunisien, profitant du désordre ambiant. De là, ils entrent en Libye. Un an plus tard, ils sont rejoints par une trentaine de rescapés de l’unité d’Abou Zeid, tué dans le nord du Mali, puis par une dizaine d’autres jihadistes revenus de Syrie. Ils s’installent dans la zone du mont Chaambi… Parmi eux, beaucoup maîtrisent les techniques et tactiques de la "petite guerre", à commencer par l’usage des engins explosifs improvisés (EEI) dont ils truffent le mont Chaambi.
Dans les villes et localités, Abou Iyad al-Tunisi (Seifallah ben Hassine, également connu sous le nom d’Abou Iyadh) crée Ansar al-Charia en avril 2011, groupe proche de la mouvance Al-Qaïda. L’homme est impliqué dans l’assassinat du commandant Massoud, en Afghanistan, en 2001. Son objectif principal tient en une islamisation radicale de la société tunisienne tout en contrant le syndicat laïc de l’Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT). Ansar al-Charia est en fer de lance de l’émeute contre l’ambassade américaine de Tunis le 14 septembre 2012. Ses membres considèrent le gouvernement comme corrompu et "à la solde de l’Occident". Ses cellules s’implantent dans les villes du pays. Avec l’aide des "jihadistes des montagnes" ils entreposent des armes, prennent le contrôle des mosquées… Par ailleurs, les activistes islamistes assassinent deux opposants : Chokri Belaïd le 6 février 2013 et Mohamed Brahmi le 25 juillet 2013, déclarant ainsi la guerre à la démocratie en Tunisie. Ennahdha, parti islamiste au pouvoir, réagit mollement, voire avec ambiguïté. Faute de directives des autorités politiques, l’armée est témoin d’une situation qui se dégrade.
Des services de renseignement dépassés, un pouvoir politique loin de la réalité
Plus habitués à traquer impitoyablement des opposants politiques que des terroristes salafistes, avec une police judiciaire davantage accoutumée à arracher des aveux qu’à mener des investigations, les services de sécurité ne sont pas correctement préparé à mener la guerre à un ennemi qui sait exploiter les faiblesses "nécessaires" inhérentes aux démocraties. Plus encore lorsque celles-ci sont jeunes, comme en Tunisie. En outre, ces services sont tétanisés par ce que l’on pourrait nommer "le syndrome post-brutal". Beaucoup des fonctionnaires au service du pouvoir précédent restent en place. Ils adoptent alors un profil bas pour se faire oublier. Ou encore, ils cherchent les faveurs des nouveaux dirigeants, ce qui n’est pas toujours compatible d’efficaces activités de renseignement. Le tout dans un contexte où il est difficile d’instaurer des protocoles de surveillance de citoyens suspectés d’être des islamistes radicaux. Les moyens ne manquent pas : Ben Ali en disposait et en abusait. Cependant, les services de renseignement sont désormais limités quant à la manière de les utiliser. La question des écoutes, semble-t-il interdites pour l’heure, est représentative du problème.
Lorsque le pouvoir se réveille enfin, que l’armée reçoit l’ordre d’agir, beaucoup de temps a été perdu…
Pour ne rien arranger, naïvement convaincus de pouvoir rallier les "égarés radicaux", les dirigeants ont tout d’abord refusé de considérer les salafistes comme un danger. Ils n’ont pas donné les ordres, ils n’ont pas assumé les décisions qui auraient permis aux forces de sécurité de démanteler sans délai les cellules naissantes d’Ansar al-Charia, d’éliminer les jihadistes dans la zone de Kasserine. Pourtant les signaux d’alerte s’allument très tôt : au printemps 2013, des paysans parlent déjà de la présence d’explosifs qui tuent les bêtes, du danger de travailler dans certains endroits. Dernier problème, et non des moindres : les relations entre l’armée et les forces de sécurité intérieure ne sont pas au beau fixe. L’échange d’informations, la coopération en souffrent, ce qui fait l’affaire des salafistes. Lorsque le pouvoir se réveille enfin, que l’armée reçoit l’ordre d’agir, beaucoup de temps a été perdu et les moyens ne correspondent pas aux besoins.
Des moyens matériels limités…
L’armée tunisienne dispose de 84 chars de combat : 30 M60A1 et 54 M60A3. S’ajoutent 48 chars légers SK-105 Kuerassier d’origine autrichienne, initialement conçus comme "tank destroyers" et 40 blindés à roues AML90 pour la reconnaissance en force. Les hommes des trois brigades d’infanterie mécanisées sont transportés par 140 blindés chenillés M113A1 et M113A2 (dont certains sont des véhicules de commandement M577A2 ou antichars M901ITV), ainsi que par 110 blindés à roues Fiat 6614. Acquis récemment, des blindés légers utilitaires et de reconnaissance Renault Sherpa 2, susceptibles de recevoir des protections contre les EEI, dotés d’un tourelleau téléopéré, augmentent sensiblement le potentiel du parc blindé. L’artillerie possède 12 M114A1 de 155 mm (qui semblent utilisés pour l’instruction) et 55 M198, également d’un calibre de 155 mm mais plus modernes.
Les pilotes de l’Armée de l’Air, formés en Égypte, mais aussi en France et en Italie, se montrent très actifs, voire agressifs. Les 12 chasseurs-bombardiers F-5E et F-5F Tiger II, les L59T Albatros multiplient les patrouilles offensives au-dessus des frontières depuis la crise libyenne. Ainsi, le 20 juin 2012, trois véhicules transportant des armes depuis la Libye sont détruits au cours d’un raid aérien nocturne. Les pilotes d’hélicoptères AB205 et UH-1 Iroquois mènent pour leur part de dangereuses missions de surveillance et de transport d’assaut au profit des unités spéciales, notamment dans le secteur du mont Chaambi. En plus de deux mitrailleuses de bord MAG, peuvent être montés des paniers à roquettes. De 5 à 12 (selon les sources) SA341 Gazelle modernisées peuvent tirer des missiles antichars HOT (contre des véhicules ou des retranchements) ou recevoir un canon de 20 mm. Mais Iroquois et Gazelle sont fragiles face aux tirs d’armes légères ou même de RPG-7 lorsqu’ils sont en vol stationnaire ; ils doivent donc être engagés avec prudence.
Atout non négligeable, la Tunisie comprend 8 C-130B et C-130H Hercules, 1 C-130J-30 (un second est attendu en 2014) qui lui permettent de déployer plus d’un bataillon, rapidement, en n’importe quel point du pays. La leçon de Gafsa en 1980 a bien été retenue… De plus, elle possède deux L410 Turbolet pour le transport léger mais aussi la surveillance des frontières. D’autres appareils pour effectuer ce type de missions (voire des drones) seraient évidemment nécessaires. Enfin, à l’image de l’aviation et des forces terrestres, les navires de la marine sont anciens et en nombre insuffisant : elle ne possède que quelques patrouilleurs qui opèrent le long des côtes.
Des informations récurrentes mentionnent l’acquisition de matériels de seconde main : 54 Leopard 2A4, des AMX-30B2 ex-Saoudiens, des 110 Fahd, des Mirage 2000-5 du Qatar, voire des F-16… Toutefois, il ne s’agit souvent que de possibilités (à l’instar des 12 SH-60F Oceanhawk que Washington souhaiterait proposer à Tunis en remplacement des vieux HH-3E) ou de rumeurs sans aucun autre fondement que l’imagination. L’annonce quant au don de 150 blindés (dont le modèle n’est pas précisé) et de 300 camions par l’Allemagne demande davantage de confirmations (notamment de la part de Berlin) pour être validée. Reste que si elle se vérifie, 54 Leopard 2A4 pourraient compter parmi les 150 blindés évoqués, en remplacement d’une partie des chars M60A1 et M60A3. Il a aussi été question de la modernisation des F-5 afin de les "câbler" pour le tir de missile air-air AIM-9J ou air-sol AGM-65 Maverick. Ces derniers amélioreraient la capacité de frappe de précision, par exemple contre des véhicules dans le désert, contre des camps jihadistes sur les reliefs…
Par ailleurs, le 19 juin 2013, le ministre de la Défense, Abdelkarim Zbidi demande à Gordon Gray, ambassadeur américain en Tunisie, un soutien logistique pour "augmenter ses capacités opérationnelles [de l’armée] et son aptitude à accomplir sa mission garantissant la stabilité dans les zones frontalières du pays." De son côté, le Qatar a fourni des véhicules légers. Deux conventions de coopération militaire signées le 19 novembre 2012 permettent de supposer que cette aide ne s’arrêtera pas là. La France n’est pas en reste, cherchant à se faire "pardonner" les erreurs du début de la révolution tunisienne. Elle a ainsi livré, en janvier 2013, 89 véhicules (dont des quads), 200 gilets pare-balles, 80 lunettes de vision nocturne, des caméras de surveillance, ainsi que 200 gilets pare-balles. Matériel précieux dans la lutte contre une guérilla.
Potentiel humain
De nombreux jeunes échappent ainsi au service militaire en raison de passe-droits.
Formée d’un noyau d’officiers, sous-officiers et soldats de métier de qualité, avec de solides unités spéciales et commandos, l’armée se compose d’une majorité d’appelés du contingent. Voici peu, l’ensemble était encore considéré comme discipliné et relativement bien entraîné. En témoigne leur attitude lors de la crise libyenne ou encore pendant la Révolution. Cependant, tout n’est pas parfait. Le système de la conscription est loin d’être aussi égalitaire qu’il se voulait être à l’origine. De nombreux jeunes échappent ainsi au service militaire en raison de passe-droits. Beaucoup de ceux qui n’y coupent pas estiment perdre leur temps. D’autres considèrent que le service national est une manière pratique pour les politiques de faire baisser – artificiellement – le chômage.
D’un point de vue stratégique, ce devoir envers la nation s’inscrit parfaitement dans la doctrine de Bourguiba. En revanche, il manque de pertinence dans le cadre d’une lutte anti-insurrectionnelle. Celle-ci exige de préférence des professionnels (ou alors, des réservistes aguerris, longuement formés, avec de fréquentes périodes de rappel) affûtés. Or, depuis deux ans, l’entraînement des unités (y compris au sein des unités spéciales et commandos) pâtit de sollicitations diverses éloignées du métier des armes : missions d’aide aux réfugiés libyens, surveillance de bâtiments publics, patrouilles contre les trafiquants le long des frontières… En outre, les fractures politico-religieuses qui ébranlent la société tunisienne ont évidemment un écho chez les filles et les fils de cette même société qui accomplissent leur service national.
Certains officiers ne cachent pas que le moral diminue. Ils relèvent des cas d’indiscipline et d’aucuns affirment que les salafistes bénéficient de soutiens, voire de complicités, au sein de l’armée et des forces de sécurité… L’indignation qu’a soulevée l’exécution de neuf militaires sur le mont Chaambi le 29 juillet 2013, la colère de la foule dans la rue ne doivent pas cacher qu’au-delà de la rhétorique changeante de l’opinion, les conscrits en première ligne ne sont pas aussi enclins à risquer leur vie contre des terroristes qui n’hésitent pas à égorger ceux qui tombent entre leur main. Difficile pour eux de donner un sens au risque de perdre yeux, bras ou jambes, dans un combat avec un adversaire invisible dont la règle est de n’en respecter aucune, tandis que s’entre-déchire la société civile.
Amélioration de la situation
Contre toute attente, le gouvernement semble enfin prendre la mesure de la menace terroriste alors que s’amorce (difficilement) l’instauration d’un dialogue national entre le parti islamiste au pouvoir, Ennahdha, et les autres acteurs de la vie politique. Il est vrai qu’il n’a plus le choix. De fait, il prend des décisions fortes, dont un renforcement de la coopération avec l’Algérie, très expérimentée en matière de lutte contre les "terrobandits" islamistes. Coopération qui implique des échanges dans le domaine du renseignement (avec la mise sur pied d’une cellule dédiée). À quoi il faut ajouter la perspective de programmes de formation de forces de sécurité tunisiennes sous l’égide d’Alger. En parallèle est créée une zone tampon dans le sud du pays, cette pointe frontalière enclavée entre l’Algérie et la Libye, lieu de tous les dangers que sillonnaient jusqu’alors les trafiquants d’armes et les jihadistes. L’armée y joue désormais un rôle important tandis que l’accès à la région est strictement contrôlé, ce pour une durée de un an.
Dans le même temps, les militaires cessent de protéger les bâtiments publics et les axes importants dans les villes. Ils "quittent" la sécurité publique pour se consacrer à leur rôle premier : la défense des frontières du pays. De fait, les effectifs ainsi libérés peuvent reprendre l’entraînement, être déployés contre le péril jihadiste… Autre illustration : l’offensive reprend contre les activistes radicaux implantés dans les reliefs du mont Chaambi. Elle paraît mieux préparée que la précédente tentative de ratissage, avec des moyens plus conséquents. Initiatives qui n’empêchent pas les terrobandits de "vaquer à leurs activités" : le 16 septembre 2013, venus de Libye, ils s’en prennent au poste frontalier de Mkissem. La Garde nationale les repousse toutefois. Mais l’avancée la plus significative réside dans la perception d’Ansar al-Charia par le pouvoir : l’organisation est désormais considérée comme terroriste. Après des semaines d’atermoiements, l’ennemi est clairement désigné.
L’armée ne réussira rien en dehors d’une approche globale initiée par le pouvoir
La plupart des insurrections, quelle que soit leur nature, sont résilientes. Plus encore si des facteurs endogènes et exogènes favorisent leur survie, voire leur développement. C’est le cas en Tunisie, dans un pays où règnent les tensions politiques et religieuses, dans un climat économique délétère (presque 40 % de chômage dans la zone de Kasserine, fléau qui touche surtout les jeunes), tandis que de l’autre côté de la frontière libyenne l’instabilité et l’insécurité sont de mises, tandis qu’environ 800 jeunes Tunisiens se battent en Syrie aux côtés des jihadistes d’Al-Nosra. Or, une partie rentreront chez eux un jour… Le terrorisme a encore de beau jour devant lui en Tunisie (comme dans beaucoup d’autres pays).
Certes, le pays ne deviendra pas la Somalie comme a menacé le général Rachid Ammar en démissionnant de ses fonctions de chef d’État-major, le 24 juin 2013. Néanmoins, les forces de sécurité ne sont pas au bout de leur peine. Figées dans la doctrine Bourguiba que rendent caduque les défis du terrorisme islamiste, elles sont peu adaptées aux combats à mener. D’autant que l’armée n’a pas la capacité à changer les choses en dehors d’une approche globale de la crise avec les jihadistes et leurs sympathisants. Approche qui passe par la fin d’une naïveté plus ou moins hypocrites d’Ennahdha, par l’instauration d’un dialogue avec l’opposition, par la volonté de réaliser l’avenir plutôt que de s’enfermer dans des querelles partisanes. Les clefs de cette approche, c’est le pouvoir qui les détient. Pas l’armée.
>> Retrouver tous les articles du blog défense de Laurent Touchard sur J.A.
>> Pour en savoir plus : consulter le blog "CONOPS" de Laurent Touchard
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus
- Ce que l’on sait du cambriolage à la présidence du Cameroun
- Mahamat Idriss Déby Itno, un président dans l’œil de Moscou
- Lutte antiterroriste en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara se tourne vers la Chine
- Face à la Russie, Alassane Ouattara, « véritable ami » de l’Ukraine en Afrique
- Évacué en France, Brice Laccruche Alihanga « très affaibli »