Algérie : plongée au coeur du système
Opaque et complexe, ce que les Algériens appellent le « nidham » (« système ») n’est pas un cabinet de l’ombre. Mais un mode d’exercice du pouvoir qui implique tous les rouages de l’État.
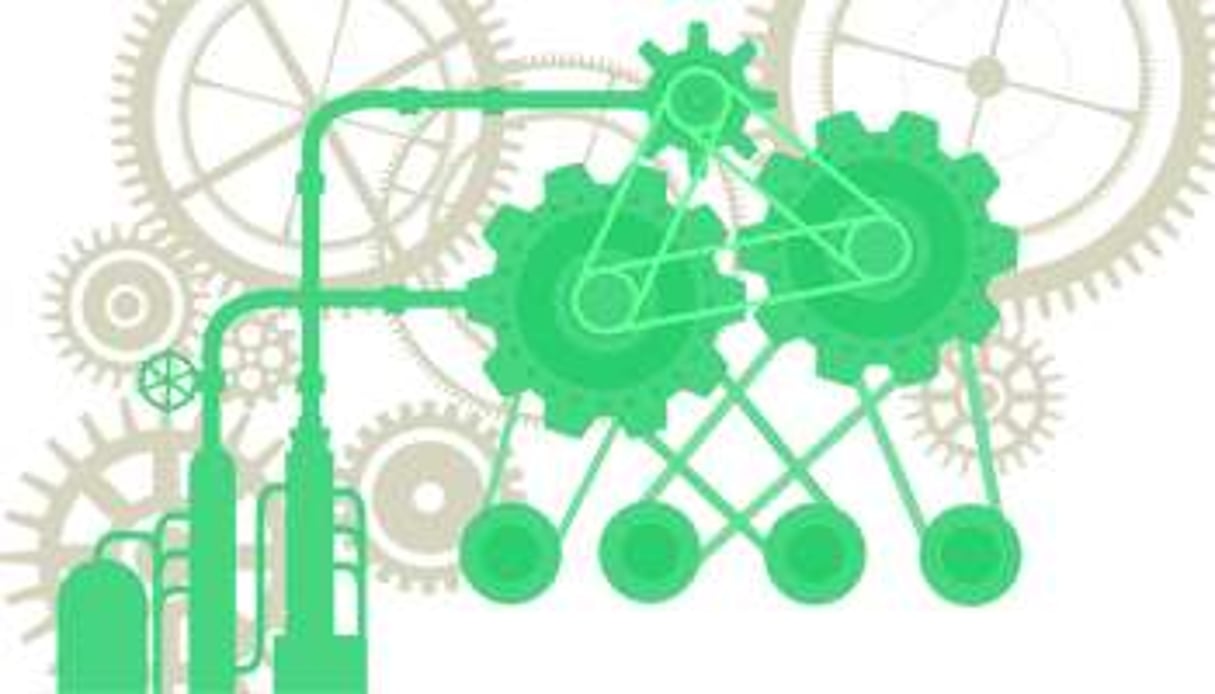
Deux sources alimentent le système : la Banque d’Algérie et la Sonatrach. © Christophe Chauvin/JA
Abdelaziz Bouteflika en convalescence à l’Institution nationale des Invalides, à Paris : les images diffusées le 12 juin, après un mois et demi d’absence, montrent un président sans doute hors course pour briguer sa propre succession, voire incapable d’achever son mandat. Elles ne dissipent pas pour autant le brouillard qui entoure l’échéance présidentielle d’avril 2014, avec une classe politique peu pressée de sortir de sa léthargie.
Et alors que se pose la question de savoir comment l’Algérie fonctionne en l’absence prolongée de son chef, les deux partenaires clés du pays, Washington et Paris, semblent sereins à propos de l’après-Bouteflika. La sous-secrétaire d’État américaine aux Affaires politiques, Wendy Sherman, a indiqué le 17 juin que son pays était prêt à « travailler avec toute institution démocratiquement élue ». Le 31 mai, le président français, François Hollande, disait, lui, croire en « la solidité des institutions » algériennes. Il évoquait ainsi le « système », cette machine opaque et autonome, si particulière à Alger depuis un demi-siècle. En arabe, le mot utilisé est « nidham », qui signifie à la fois système, ordre et ordonnancement.
Stratégie
Une machine complexe mais efficace. Le nidham n’est pas une somme d’individus mais un ensemble de rouages interdépendants et d’inégale importance. « Subalternes ou dans la haute hiérarchie, les hommes passent, les rouages demeurent », répétait son fondateur, Houari Boumédiène, qui l’avait imaginé avant même l’indépendance, dans sa stratégie de prise du pouvoir. Le système est d’abord composé du rouage suprême, l’institution présidentielle, qui en assure la pérennité. Le palais d’El-Mouradia pilote directement, et distinctement, deux autres rouages indispensables, l’Armée nationale populaire (ANP) et les services de renseignements (hier Sécurité militaire, aujourd’hui Département du renseignement et de la sécurité, DRS). Aux étages inférieurs du mécanisme, un ensemble de rouages mineurs (administration, justice, partis politiques, société civile, etc.) assurent le relais sur l’ensemble du territoire national.
Paranoïa
Pour lubrifier le fonctionnement de cet ensemble qui incarne « l’État national » (expression utilisée par Boumédiène), un credo : protéger à tout prix l’indépendance de décision et la souveraineté. Pour cela, l’État sera jacobin, l’idéologie nationaliste et le discours souverainiste, teinté d’hostilité à l’égard de l’ancienne puissance coloniale et d’une suspicion frisant la paranoïa à l’égard de l’étranger.
Toute décision est prise de manière collégiale, dans le cadre légal et constitutionnel, et l’opacité du nidham « ne permet ni à ceux qui en sont éloignés, ni à ceux qui y travaillent de répondre à la question : qui est responsable ? » affirme Abderrahmane Hadj Nacer, ex-gouverneur de la Banque d’Algérie. Le système n’est donc pas un cabinet de l’ombre composé d’une élite techno-militariste. C’est une mécanique bien huilée dont la base sociale (les corps constitués, une armée de fonctionnaires, des centaines de milliers de cadres ayant bénéficié de l’ascenseur social grâce à la manne pétrolière) n’a jamais cessé de croître. Une démographie qui lui permet de « gagner démocratiquement une élection », assure une autre source.
Sa longévité (de 1962 à nos jours) tient à cette « solidité » qu’évoque François Hollande, malgré les défaillances qui ont jalonné son histoire : en 1967, l’armée tente de renverser Boumédiène, sans y parvenir ; un quart de siècle plus tard, les services de renseignements n’anticipent pas le raz-de-marée islamiste aux législatives de décembre 1991 ; dans la foulée, l’un des piliers du système, le Front de libération nationale (FLN, ex-parti unique), affiche de soudaines aspirations démocratiques et s’oppose au putsch électoral. Mise à l’écart pendant trois ans, la formation survit et réapparaît, rénovée.
Le système avait déjà subi quelques réformes menées par le colonel Chadli Bendjedid (arrivé au pouvoir en 1979 après la mort de Boumédiène). Si Bendjedid se heurte au début à l’hostilité des caciques du FLN, les révoltes sanglantes d’octobre 1988 lui permettront de proposer une nouvelle Constitution en février 1989, laquelle mit fin au régime de parti unique.
Les rouages peuvent ainsi hésiter. Ce fut le cas à l’égard d’Abdelaziz Bouteflika, ce dernier est au final une bénédiction pour « l’État national ». Au cours de ses deux premiers mandats, entre 1999 et 2009, le Trésor public injecte environ 150 milliards d’euros dans l’économie. Le pays se développe, la qualité de vie s’améliore et la base sociale du nidham s’agrandit. La politique de réconciliation nationale réduit l’intensité de l’insurrection islamiste, une guerre éreintante pour l’armée et les Services. Mieux : accusés d’exécutions sommaires, d’atteintes aux droits de l’homme et soupçonnés d’être derrière les massacres de civils, ceux-ci sont réhabilités sur la scène internationale grâce au charisme de Bouteflika et à son savoir-faire diplomatique.
Le chef de l’État, qui, malgré son ulcère hémorragique de novembre 2005, compte se présenter à sa troisième présidentielle, révise la Constitution et son article 74 qui limite le nombre de mandats. C’est chose faite en novembre 2008, et Bouteflika est réélu l’année suivante. Les amendements « présidentialisent » davantage le régime, sans toutefois rompre les grands équilibres du pouvoir. Décidée de manière unilatérale, la réforme préserve l’harmonie du système.
Gorges profondes
Les soucis de santé affaiblissent certes le président, mais pas la présidence. Toujours aussi omnipotent, le rouage suprême se passe désormais de chef. Une situation inédite pour le nidham, qui voit d’un mauvais oeil l’intrusion de deux personnages : Mohamed Rougab, secrétaire particulier, et Saïd Bouteflika, frère et conseiller spécial, deviennent les deux canaux par lesquels le président transmet ses instructions. Une situation peu appréciée, au nom du légalisme, par une partie du système. Qui réagit. En 2010, des investigations du DRS révèlent ainsi une série de scandales financiers, impliquant des personnalités réputées proches de Bouteflika. Nourrie par des « gorges profondes », la presse algérienne s’en donne à coeur joie. Tête de Turc préférée : Chakib Khelil, son ami d’enfance, ministre de l’Énergie et des Mines de 1999 à 2010.
Le Printemps arabe et les menaces qu’il fait planer sur la pérennité du système apaisent cependant les tensions pour un temps, jusqu’au discours de Sétif, le 8 mai 2012. « Ma génération a fait son temps », affirme Bouteflika dans ce qui reste sa dernière allocution publique. Une manière d’annoncer qu’il ne briguera pas de quatrième mandat et d’inviter d’autres cadres à passer la main. Quelques mois plus tard, des voix s’élèvent dans la classe politique pour lui demander de rempiler. Les attaques contre son entourage, par presse interposée, se font de plus en plus violentes. Elles visent désormais son frère Saïd, à qui il est reproché d’avoir protégé des personnalités impliquées dans les scandales financiers et, plus grave, de s’immiscer dans la bataille de succession qui secoue le FLN. Le 27 avril 2013, le journal francophone Le Quotidien d’Oran annonce le limogeage de Saïd Bouteflika, une information totalement infondée mais reprise par plusieurs médias nationaux. Quelques heures plus tard, le chef de l’État est foudroyé par un accident vasculaire cérébral qui lui vaut un nouvel exil médical à Paris.
Le nidham sortira-t-il affaibli de cet épisode ? Il n’en donne pas l’impression. Pour l’heure, il n’y a pas de guerre interne. Le DRS poursuit son travail, sans oublier d’en informer en temps réel El-Mouradia. Le système fonctionne. Mais il doit désormais se tourner vers l’avenir, pour survivre aux hommes.
Avec Bouteflika, la valse-hésitation
Sans états d’âme, le système et ses rouages ont fait quelques volte-face dans leur relation avec Abdelaziz Bouteflika. En 1979, pour l’empêcher de succéder à Boumédiène, les Services ont pesé sur l’armée. Vingt ans plus tard, pour la présidentielle de 1999, ils lui déroulent le tapis rouge. Le nouveau chef de l’État savoure ce retournement mais exclut toute idée de revanche : pour mettre en oeuvre son programme, il a besoin de la bonne entente qui caractérise le fonctionnement du système. Mais, très vite, sa politique de réconciliation embarrasse l’armée. Une partie du commandement y voit une capitulation face à l’ennemi intégriste. Le chef d’état-major, le général Mohamed Lamari, se rebelle : alors que Bouteflika brigue un deuxième mandat, il ne fait pas mystère de son soutien à l’un de ses rivaux, Ali Benflis. Soutenu par les autres rouages, Bouteflika est réélu en 2004 avec plus de 80 % des voix. Le général Lamari démissionne quelques mois plus tard. Un incident de parcours dont l’armée sort indemne. CH.O.
Une succession peut en cacher une autre
Qui succédera à la vieille garde ? Trois scénarios sont envisageables après la diffusion, le 12 juin, des premières images d’Abdelaziz Bouteflika. Dans le premier, il est suffisamment rétabli pour en découdre avec les Services, qu’il soupçonne d’être derrière la campagne de presse visant ses proches. Une telle éventualité, inédite dans l’histoire du système, pourrait provoquer son implosion.
Cependant, même diminué, l’homme semble assez lucide. Et il ne peut ignorer que l’armée ne saurait rester les bras croisés. Il évitera sans doute de ruiner un bilan bien plus flatteur que ceux de ses prédécesseurs. Second scénario : il revient aux affaires en maintenant le statu quo. Dans ce cas, il jouera un rôle direct dans le choix de son successeur.
Enfin, de guerre lasse, Bouteflika pourrait jeter l’éponge, s’adresser à la nation pour annoncer son incapacité à achever son mandat. Quoi qu’il en soit, si le passage de relais à la tête du rouage suprême ne semble pas menacer la pérennité du nidham (« système »), deux autres successions s’annoncent délicates. Celle de l’octogénaire Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, d’abord.
Mais surtout celle de Mohamed Mediène, alias Tewfik, 71 ans, à la tête du tentaculaire Département du renseignement et de la sécurité (DRS) depuis vingt-trois ans. Il est le dernier « Malgache » – surnom des cadres du ministère de l’Armement et des Liaisons générales (Malg), ancêtre du DRS – en poste, et son départ sera le plus complexe à négocier. « Le chef du DRS est confronté à un dilemme. Voudra-t-il laisser l’empreinte d’un Youri Andropov, ex-chef du KGB, qui a encouragé la perestroïka, ou celle d’un Lavrenti Beria, son lointain prédécesseur, symbole de la répression aveugle ? » interroge le politologue (et ancien officier du DRS) Mohamed Chafik Mesbah. CH.O.
________________________
Par Chérif Ouazani
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus – Politique
- Maroc-Algérie : que contiennent les archives sur la frontière promises par Macron ?
- La justice sénégalaise fait reporter l’inhumation de Mamadou Moustapha Ba, évoquan...
- Une « nouvelle conception de l’autorité » : Mohamed Mhidia, un wali providentiel à...
- Les sextapes de Bello font le buzz au-delà de la Guinée équatoriale
- Sextapes et argent public : les Obiang pris dans l’ouragan Bello




