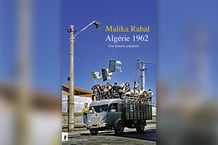Centrafrique : silence, on tue
Les journalistes ne peuvent plus s’y rendre, mais quelques humanitaires bravent encore le danger. Peter Bouckaert, directeur de la section Urgences de Human Rights Watch, a raconté à Jeune Afrique son voyage dans le nord de la Centrafrique, là où l’État a cessé d’exister. Là où tout peut arriver.

Des milliers de personnes ont été déplacées, quand elles n’ont pas été massacrées. © MATTHIEU ALEXANDRE / AFP
Ce 10 novembre, face aux commerçants du village de Gaga, à plus de 200 km de Bangui, le général Abdallah Hamat se faisait menaçant. "Nous allons combattre l’ennemi ! N’y a-t-il pas un musulman assez loyal ici pour nous fournir le carburant ?" tonnait-il, promettant d’attaquer les miliciens chrétiens du village voisin. Une fois les motos, l’argent et le fuel obtenus, Hamat et la trentaine d’hommes qui l’accompagnaient se sont enfoncés dans la brousse. Direction Camp Bangui.
Nous n’avons pu arriver au village en question que quatre jours plus tard, après nous être faufilés entre les positions tenues par la Séléka, cette coalition rebelle qui a pris le pouvoir en mars dernier et qui a été officiellement dissoute, sans que cela permette d’éviter que le pays ne sombre dans le chaos. Le centre de la bourgade avait été mis à sac. Le sol était jonché de douilles et d’éclats de grenades. L’odeur des cadavres nous a pris à la gorge. Plus tard, des survivants nous ont confié avoir fui précipitamment pour échapper à l’horreur.
Encore un village détruit, encore des hommes et des femmes jetés sur les routes… En Centrafrique, l’État a cessé d’exister. Dans le Nord, là où les attaques ont été les plus nombreuses, les dates affichées sur les tableaux noirs des écoles s’arrêtent en mars dernier. Les hôpitaux, les dispensaires, les bâtiments gouvernementaux… tout a été pillé. Même les portes et les encadrements de fenêtres ont disparu.
Les milices anti-balakas, aussi brutales que la Séléka
Nous avons traversé ces régions début novembre. Souvent, craignant que nous n’appartenions à la Séléka, les gens ont fui à notre arrivée. À plusieurs reprises, il nous a fallu stopper notre véhicule pour dégager la route des bagages précipitamment abandonnés. La terreur qu’inspire la Séléka est telle qu’il nous est arrivé d’y trouver, aussi, des nourrissons en pleurs, laissés là, au bord de la piste, par leurs parents. Une famille que nous étions parvenus à rassurer nous a expliqué qu’elle avait marché toute la nuit pour tenter de gagner Bossangoa, la capitale régionale où s’entassent déjà, dans des conditions misérables, plus de 40 000 déplacés. Le père, épuisé, a ajouté que son village d’Ouham-Bac avait une nouvelle fois été attaqué mi-octobre, et qu’une dizaine de personnes avaient été tuées. Que Bossangoa se trouvait très loin, que les routes étaient dangereuses et que la plupart de ses voisins avaient préféré se cacher dans la brousse, bien qu’il n’y ait rien à manger. Et tout cela dure depuis le mois de mars…
La nouveauté, c’est qu’en réaction à cette frénésie de pillages et de destructions, des paysans ont pris les armes et se sont constitués en milices tout aussi brutales, connues sous le nom de milices anti-balakas ("antimachettes"). Il y a des années, François Bozizé, lorsqu’il était encore au pouvoir, avait utilisé ces groupes d’autodéfense pour combattre les coupeurs de route. Leurs membres étaient exclusivement chrétiens. Aujourd’hui, ces combattants affublés de "fétiches pare-balles" et munis de fusils de chasse ou de couteaux affrontent la Séléka. Des déserteurs de l’armée, restés fidèles au président déchu, leur ont apporté la puissance de feu de leurs AK-47 et leur savoir-faire militaire. Et partout, dans le Nord, les récits de l’horreur qui s’est abattue sur la Centrafrique se suivent et se ressemblent.
Des corps jetés dans un brasier
Le 6 septembre au matin, des anti-balakas ont mené une offensive sur des avant-postes isolés de la Séléka, dévastant au passage plusieurs localités musulmanes. Des centaines de civils ont été massacrés. Les hommes surtout sont visés. Peu importe qu’ils soient liés ou non à la Séléka. Peu importe que ce soit des adultes ou des enfants.
Tala Astita se trouvait dans la ville de Zéré quand les quartiers musulmans et le QG local de la Séléka ont été attaqués. À 5 heures du matin, des hommes armés ont fait irruption dans sa hutte et ordonné à son mari et à son fils de 13 ans de sortir. Ils ont été tués à coups de machette. Leur maison a été incendiée et leurs corps ont été jetés dans le brasier. Tala est tout de même parvenue à convaincre les assaillants qu’elle était chrétienne. Pendant des semaines, elle s’est cachée dans la brousse, déguisant son dernier fils de 3 ans en fille, l’affublant de boucles d’oreilles pour qu’il échappe à la mort. Sa fille de 14 ans n’a pas eu cette chance, la seconde épouse de son mari non plus. Elles ont été enlevées et n’ont plus donné signe de vie.
Particulièrement visés, les Peuls mbororos. Ces nomades musulmans, dont les troupeaux traversent champs et cultures, sont depuis longtemps haïs par les fermiers chrétiens au nom de rivalités ancestrales qui rappellent celles qui ont plongé le Darfour dans la guerre. En septembre, des milliers de têtes de bétail leur ont été volées et des gardiens de troupeaux ont été abattus.
Beldo Ibrahim, une Mbororo de 32 ans, se trouvait dans un campement près de Guetté, le 6 septembre, quand des anti-balakas ont attaqué. Le jour n’était pas encore levé. "Ils étaient si nombreux, se souvient-elle. Ils nous ont forcés à nous allonger par terre et nous ont dit qu’ils ne tueraient que les hommes. Ils en ont égorgé quatre sous nos yeux, dont mon mari. Les autres, c’était des enfants âgés de 3, 10 et 14 ans. Ma fille a reçu un coup de machette sur la tête et ils lui ont lacéré le dos. Comme elle était dans les bras de son père, ils ont cru que c’était un garçon."
Le même jour, le campement de Hadija, près de Bir Zambé, a lui aussi été attaqué. Son mari, ses trois enfants, la seconde femme de son mari et leurs cinq enfants… Tous ont été abattus. Hadija a pris une balle dans la nuque et a été laissée pour morte. Elle n’a été retrouvée qu’une semaine plus tard, grièvement blessée, étendue au milieu des corps en décomposition de ses proches. En Centrafrique, l’horreur le dispute à l’indicible.
Par endroits, la Séléka a été contrainte de se replier vers des zones plus peuplées et à redoubler de brutalité. La méthode est toujours la même : ils surgissent à tombeau ouvert dans les villages, puis incendient, pillent, massacrent et mitraillent. Malheur à ceux qui ne peuvent pas fuir… Des habitants de Wikamo, dans la province d’Ouham, nous racontent l’histoire de Nicole Faraganda, 34 ans. Le 10 octobre, la Séléka a attaqué son village. La veille, Nicole avait accouché d’une petite fille. Trop faible pour courir se mettre à l’abri, elle a été abattue. Les assaillants sont ensuite descendus de leurs véhicules et ont pillé l’école et l’hôpital, et brûlé une à une les centaines de huttes aux toits de chaume qui constituaient Wikamo. Quelques heures plus tard, ils sont arrivés à Ouham-Bac et ont tué une dizaine de personnes supplémentaires dont Gaston, un aveugle que ses voisins n’avaient pas emmené dans leur fuite et qui avait vainement tenté de se cacher dans un fourré.
Pour les paysans, il est devenu trop dangereux de retourner aux champs. Chrétiens ou musulmans, ils sont systématiquement abattus dans la région de Bossangoa, tantôt par les membres de la Séléka, tantôt par les anti-balakas. Pour survivre, les milliers de personnes réfugiées dans la brousse doivent mener un combat quotidien contre la faim et la maladie. Nous y avons rencontré Raphaël Newane, autrefois chef du village de Ndjo. Le visage marqué par une profonde tristesse, il nous a conduits aux tombes de deux de ses petits-enfants, emportés la semaine précédente par une crise de paludisme à l’âge de 6 mois et de 9 mois. Plus loin, Placide Yamini, l’ancien médecin du village, a expliqué que quatre ou cinq déplacés mouraient chaque semaine faute de soins. Les combattants de la Séléka ont mis à sac l’hôpital et la pharmacie de Ndjo mi-septembre, et Placide n’a pu sauver que quelques instruments chirurgicaux. Là, dans la brousse, il se laisse gagner par le découragement : "Nous vivons et nous mourons comme des bêtes."
C’est maintenant qu’il faut agir
L’horreur qui a englouti la Centrafrique est insupportable, mais elle pourrait encore empirer tant est grand le risque que la situation dégénère en guerre interreligieuse. C’est une véritable course contre la montre qui est engagée, et il faut bien avoir conscience que le coût de l’inaction serait immense. La réponse internationale à cette crise a, jusqu’à présent, été minimale. Les éléments de la force africaine de la Force multinationale de l’Afrique centrale (Fomac) quittent rarement leurs bases et se plient trop souvent à l’autorité de la Séléka. Ce qu’il faut, c’est une force de maintien de la paix robuste, comme celle que l’ONU a déployée en RD Congo. Et plus encore qu’au Mali, la réponse de la France, si elle est suffisamment ferme, pourrait aider à ramener la stabilité. Après tout, ces hommes qui sèment le chaos ne sont pas des militaires bien organisés, mais des miliciens qui doivent mendier des véhicules et du carburant… Enfin, les pays de la sous-région et la France devraient rappeler à Michel Djotodia et à tous ceux qui convoitent le pouvoir que ce bain de sang les conduira plus sûrement devant la justice que dans un fauteuil de président. Human Rights Watch
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus
- À la demande d’Alassane Ouattara, João Lourenço nouveau médiateur pour le Sahel ?
- Est de la RDC : Corneille Nangaa, l’histoire d’un apprenti rebelle
- Au Cameroun, Paul Biya songe-t-il toujours à autoriser la double nationalité ?
- Roland Dumas et l’Afrique : des plaidoiries au scandale
- Sonangol obtient le feu vert d’Alassane Ouattara pour la vente de ses parts dans la SIR