Boualem Sansal : « Il n’y a plus assez d’intellectuels libres pour faire renaître l’islam »
Dans « Abraham », son neuvième roman, Boualem Sansal imagine un nouveau prophète chargé d’apaiser les maux de l’humanité, et tisse une histoire qui résonne fortement avec l’actualité. Entretien.

L’écrivain algérien Boualem Sansal à Paris, en octobre 2013. © Vincent Fournier/JA
Faut-il encore présenter Boualem Sansal ? Depuis son entrée fracassante dans l’univers de la littérature francophone en 1999 avec son premier roman, Le serment des barbares, l’écrivain algérien, ancien ingénieur venu sur le tard à l’écriture, n’a cessé de cumuler les succès avec des ouvrages exigeants et originaux.
En 2015, son 2084, la fin du monde, adaptation très personnelle sous forme de dystopie du célèbre 1984 d’Orwell, a même été un véritable best-seller en France comme dans le monde. Il lui a permis d’obtenir le prestigieux Grand prix de l’Académie française.
Pourfendeur régulier, dans ses essais comme dans plusieurs de ses livres de fiction, de l’idéologie et des agissements des islamistes, amoureux de son pays et critique féroce de son évolution et de son régime, il surprend à nouveau avec le sujet peu banal de son neuvième roman. Dans Abraham ou la cinquième alliance, il raconte en effet qu’un habitant de l’ancienne Mésopotamie considère que son fils Abram, qui ne porte évidemment pas ce prénom par hasard, est une réincarnation du patriarche Abraham et est appelé à devenir un nouveau prophète.
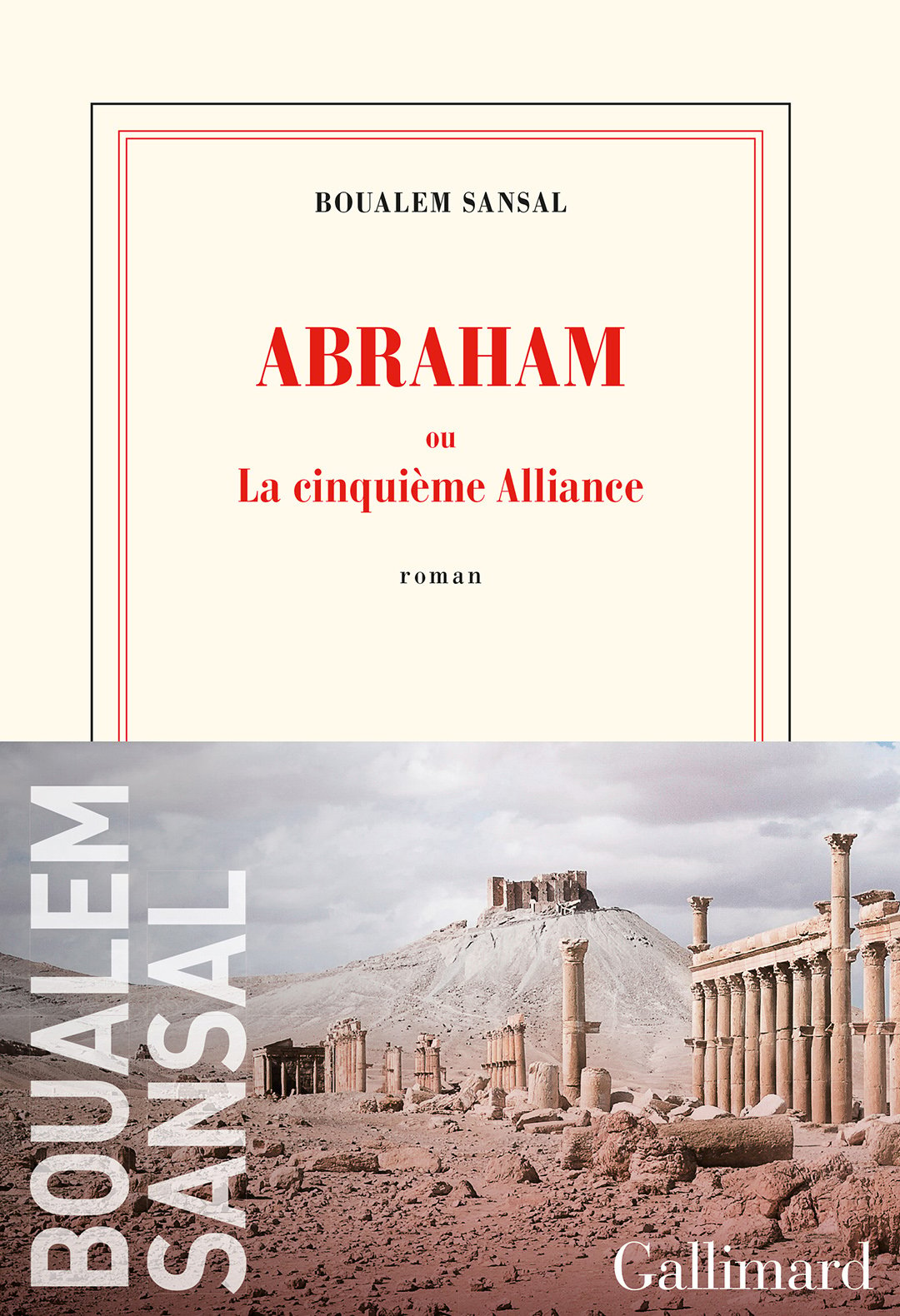
« Abraham ou la cinquième alliance », de Boualem Sansal, Gallimard, 288 pages, 21 euros © Editions Gallimard
Celui-ci devra annoncer une « cinquième alliance » avec Dieu, après celles qu’ont autrefois conclues Abraham, Moïse, Jésus et bien sûr Mohammed, afin d’apaiser les maux de l’humanité. Ce qui entraine le « héros » du livre, accompagné de sa famille et de ses disciples, à refaire à l’identique, 4000 ans après, le périple d’Abraham à travers le Moyen-Orient. Il parcourt alors des territoires en pleine effervescence, puisque tout se passe il y a une centaine d’années, au moment de la Première guerre mondiale, de l’effondrement de l’empire ottoman et du califat ainsi que de la venue de colonisateurs occidentaux déterminés à asseoir leur domination sur toute la région.
Évoquant donc la Genèse, le livre prend souvent la forme d’un conte philosophique. Notamment quand le père d’Abram puis lui-même discutent à la manière socratique avec ceux qui les suivent dans leur « aventure » vers la Terre promise. Mais l’ouvrage, s’il est sérieux, n’est jamais ennuyeux et peut se lire d’une traite. D’autant que ce qu’il raconte résonne fortement avec ce qui se passe de nos jours, en Orient comme en Occident et, bien sûr, en Algérie.
Jeune Afrique : Abraham est un livre très ambitieux puisqu’il couvre nombre de champs : historique, géopolitique, religieux, philosophique… Même pas peur ?
Boualem Sansal : Quand je suis parti pour raconter cette histoire, je pensais que ce ne serait pas trop difficile. Puis, après avoir écrit 10 ou 15 pages, je me suis dit que l’entreprise allait me prendre 10 ou 15 ans vu l’ampleur du sujet. Mais heureusement, grâce notamment à la pandémie qui m’a interdit de bouger, de voyager à l’étranger, j’ai pu me mettre à travailler 10 à 15 heures par jour sans interruption. Et j’ai constaté que j’avançais bien, que ma mémoire sur ce sujet qui me passionnait depuis longtemps, depuis une bonne trentaine d’années en fait, fonctionnait bien.
Pourquoi avoir situé cette histoire il y un siècle et au Moyen-Orient ?
L’idée était de ressusciter dans un roman cet Abraham, à l’origine du monothéisme, que nous connaissons tous. Où ? Ma première idée fut de situer le récit dans une banlieue autour de Paris. Mais c’est au Moyen-Orient que cela s’est passé, alors autant respecter l’histoire.
Ensuite quand ? Là encore, ma première idée, celle de retenir la période actuelle, ne fut pas la bonne. En continuant à me documenter sur le personnage d’Abraham, j’ai constaté qu’à son époque, il y avait un contexte politique, des guerres d’empires opposant les Hittites, les Égyptiens, les Babyloniens, les Assyriens ou les Perses. Le mieux était donc de choisir une période pendant laquelle s’étaient déroulées des guerres d’empires au Moyen-Orient. La seule que j’ai trouvée se situe autour de la Première guerre mondiale, avec les empires ottoman, austro-hongrois, anglais, français, allemand qui intervenaient tous dans le conflit.
Nous ressentons tous que le christianisme, le judaïsme et l’islam sont en échec »
J’avais mon théâtre, et quel théâtre ! Les guerres d’empires, ce ne sont pas comme les guerres entre nations, entre royaumes. Un roi est un petit personnage, une sorte de directeur ou de chef d’entreprise, alors qu’un empereur domine plusieurs peuples, une immense région. Avec des préoccupations à la fois politiques, culturelles, linguistiques, économiques. Les empires ont toujours un rapport à la colonisation, ils ont une vision planétaire, qui dépasse leur temps, qui se veut millénaire.
Ne restait plus qu’à trouver le ton, et le ton biblique s’est imposé. Avec un prophète parcourant des territoires, discutant avec ses disciples. Il n’y avait plus qu’à se mettre au travail.
Créer une nouvelle religion, comme vous le faites dans ce roman, ce n’est pas une petite entreprise ! En quoi était-ce nécessaire ?
Nous ressentons tous, je crois, que les trois religions monothéistes sont en échec. Pour le christianisme, le déclin a commencé avec le schisme protestant, il s’est accéléré avec les Lumières, l’idée de la laïcité, la montée de l’athéisme, la modernité à laquelle il n’a pu s’adapter. Le judaïsme, pour sa part, n’est en fait jamais sorti de son petit univers, entre hébreux, et, contrairement au sionisme, il n’a pas vraiment d’histoire à grande échelle.
Et puis il y a l’islam. Quand il arrive, c’est « la » nouvelle grande religion, qui veut conquérir le monde. C’est bien parti, on a vu se développer la belle civilisation arabo-musulmane. Sur cette lancée, le monde islamique aurait pu devenir la première puissance mondiale.
L’islam a repris de la vigueur avec les pétrodollars, la guerre et la politique politicienne »
Mais au sortir du Moyen-Âge, c’est l’Europe qui a pris cette place, ce sont les nations européennes qui ont récupéré l’héritage arabe, hindou, etc. Elles ont dominé la planète, aussi bien l’Asie que l’Amérique et le Moyen-Orient. L’islam est entré en sommeil, chassé de l’Espagne, de la Chine, de partout. Et est arrivé la chute de l’empire ottoman, la fin du califat, la colonisation. L’islam, c’est la charia plus le calife. Les deux ont disparu avec la destitution du calife et l’arrivée d’Atatürk.
Et s’est donc ajouté la colonisation. Ne restait alors plus de l’islam que des gestes sans spiritualité, sans signification, un service minimum assurant le lien social. S’il a repris ensuite de la vigueur, ce n’est pas par la voie spirituelle, par la conquête des âmes, mais par les pétrodollars, par la guerre, par la politique politicienne grâce à l’entrisme dans le jeu politique.
Et ce qu’on nous propose, comme j’ai voulu le montrer dans mon livre 2084, c’est un univers orwellien. Il n’y a plus assez d’intellectuels libres représentant une masse critique afin de faire renaître la spiritualité, une dynamique, un souffle prophétique dans l’islam.
Alors, est-ce que le monothéisme est mort ? Non, l’idée de Dieu n’est pas morte, elle est toujours là, mais en jachère. C’était donc tentant de se dire : Abraham nous a donné la genèse, Moïse les tables de la loi, Jésus les Évangiles, Mahomet le Coran, maintenant repartons de zéro dans un roman avec un nouveau prophète. Ou plutôt avec un nouvel Abraham, puisque celui-ci, un juste, un pur, n’a pas créé de religion mais a été un messager, transmettant l’idée du monothéisme.
Imaginer un nouveau prophète, même dans un roman, n’est-ce pas blasphématoire ?
Je me suis posé la question. Mais d’abord, des nouveaux prophètes, même si ce sont souvent des fous, il y en a tout le temps, ce n’est pas si rare en réalité. Et puis si aux yeux des salafistes, c’est blasphématoire, je ne vois pas pourquoi on leur laisserait le droit de décréter ce qu’on doit considérer comme tel. On a notre petite liberté ! Cela ne m’a pas arrêté longtemps.
Vous avez écrit une bonne partie du livre en Algérie pendant le grand mouvement de protestation contre le régime, le Hirak. Ce qui se passait dans la rue vous a-t-il inspiré ?
J’avais commencé à écrire, ma réflexion sur le sujet étant achevée, pendant l’été qui a précédé le début du Hirak. La conséquence de ce mouvement a surtout été de suspendre mon travail pendant un temps. Je n’ai plus du tout avancé en février et en mars 2019 car j’étais en plein dans le mouvement, je participais aux marches, à tout ce qu’il y avait autour.
J’ai cessé de croire au Hirak. Plus le temps passe, plus il sera difficile de le faire repartir »
Et puis j’ai complètement arrêté, j’ai cessé de croire au Hirak avant même la fin de mars, pensant que cela n’irait pas loin puisque les manifestants étaient incapables de s’organiser. Ils venaient tous les vendredi, une journée où l’on ne travaille pas, et ils passaient deux heures dans une ambiance amicale, festive. D’autant que la police, alors, laissait faire. C’était quoi, de la politique ou du rêve ?
Les gens pensaient qu’ils allaient faire tomber le régime, mais pour cela il faut des stratégies. Or ceux qui manifestaient étaient très divisés, il y avait des islamistes, des nationalistes arabes, des modernistes, des laïcs, des Kabyles… Impossible d’avoir une ligne directrice, une base de négociation. Des personnalités appréciées ont parlé d’une plateforme, mais cela n’a pas été loin.
Ce n’est donc pas l’élection d’Abdelmadjid Tebboune ou la survenue de la pandémie qui ont mis fin au mouvement ?
Le mouvement a continué après l’élection de Tebboune. Quant à la pandémie, les gens ont mis longtemps à voir que cela concernait l’Algérie et pas seulement l’Asie puis surtout l’Europe. Ils pensaient volontiers que l’on assistait à une manœuvre des services pour décourager les protestations.
Le pouvoir, en fin de compte, n’a laissé se dérouler le mouvement que tant que cela l’arrangeait, ou plutôt tant que cela servait la lutte des clans. Celle de ceux qui voulaient faire tomber le clan Bouteflika, de ceux qui voulaient faire tomber le clan du général Gaïd Salah, etc. Des luttes de clans comme celles qui existent depuis toujours en Algérie, au sein de l’armée et des services secrets.
Je refuse de vivre comme un émigré ou un réfugié politique »
Certes, à un moment, l’idée de la désobéissance civile a été lancée, et elle aurait pu inquiéter le pouvoir. Mais là aussi, ce n’est pas allé loin, cela ne s’est pas concrétisé. Et les gens se sont fatigués, au bout de dizaines et de dizaines de vendredis. D’autant que les autorités ont déclaré qu’il était irresponsable de poursuivre le mouvement et que les arrestations se sont multipliées.
N’y-a-t-il alors aucun espoir de voir le régime changer ?
En tout cas, pas grâce à la façon dont s’est déroulé le Hirak. Le mouvement reprendra peut-être sous une autre forme, qui sait ? Mais plus le temps passe, plus ce sera difficile. Et ce qu’on peut craindre pour l’instant, surtout avec la situation économique qui va rester dramatique, c’est que reprenne ce dont on a l’expérience depuis toujours en Algérie, des émeutes ici ou là en permanence.
Si la situation est aussi désespérée, pourquoi restez-vous en Algérie, où vous êtes mal considéré par beaucoup, à commencer par le pouvoir ?
Parce que, de toute façon, je refuse de vivre comme un émigré ou un réfugié politique. Le pays ne marche pas, mais je suis un citoyen, avec un passeport et une carte d’identité. Si je suis menacé, au moins je le suis dans mon pays. S’il le faut, j’irai me cacher quelque part dans le Sahara.
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus – Culture
- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...
- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés
- Trick Daddy, le rappeur qui ne veut pas être « afro-américain »
- Au Bénin, « l’opposant sans peur » à Patrice Talon emprisonné
- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?






