Louisa Yousfi : « J’inscris mon geste dans un mouvement collectif antiraciste et décolonial »
Dans « Rester barbare », Louisa Yousfi redonne au terme ses lettres de noblesse. L’essai à succès est un manifeste politique et littéraire annonciateur d’une œuvre forte.

Louisa Yousfi. © Anthony Francin/La fabrique éditions.
Quand on demande à Louisa Yousfi comment elle souhaite qu’on la définisse, elle répond : comme une barbare ! Dans son essai court et puissant, la jeune femme s’applique à donner de la substance à ce « rester barbare » qui donne le titre à son premier livre. Elle convoque des grandes figures : Kateb Yacine, Chester Himes, Ralph Ellison, James Baldwin, Sony Labou Tansi… Et aussi le rap, avec en premier lieu Booba et PNL, qui montre la réalité augmentée du barbare qu’elle oppose aux moules proposés par ce qu’elle appelle l’Empire.
D’une rare fulgurance, le texte est à la fois rigoureux dans les termes et ouvre des pistes de réflexion, que l’écrivaine s’applique à elle-même. Elle pose les jalons d’un projet littéraire sans concession en tant que « femme issue de l’immigration ». Mais à sa façon, à contre-courant des codes du récit actuel. Un pari ambitieux, dont son talent nous laisse à penser qu’elle le relèvera. Son propos est un manifeste à la fois politique et littéraire qui ne se résume pas mais qui se lit d’un bloc.
Jeune Afrique : Quels éléments de votre parcours sont signifiants pour nous éclairer sur votre essai et ses intentions ?
Louisa Yousfi : Je suis une Arabe en France. Voilà qui est signifiant. C’est à partir de cette identité sociale que j’ai tâché de dénouer toutes les contradictions, dilemmes et conflits de loyauté que nous impose le grand récit de l’intégration. Être une Arabe en France, c’est à la fois habiter la figure de l’altérité qui ferait peser sur le pays une menace pour son intégrité morale et, en même temps, c’est être empêtrée dans les rouages de l’intégration, c’est-à-dire dans le processus d’effacement et de domestication de tout ce qui constitue effectivement cette « altérité » : nos cultures, nos langues, nos religions, nos histoires… Ce que je dessine dans mon essai, c’est donc une histoire de l’intégration vue de l’intérieur : c’est parce que nous ne sommes plus des « barbares » que la question de notre « barbarie » devient essentielle. Elle permettra de figurer l’espace en nous qui aurait résisté à cette emprise structurelle et morale.
L’insulte « barbare » est vue sous un jour nouveau : ce qui est nommé ainsi ce sont mes derniers trésors. Et comment fait-on pour les protéger ces derniers trésors, comment fait-on pour se raconter sans les livrer à la prédation d’un monde qui veut nous faire la peau, qui nous contraint à n’avoir comme horizon salutaire que celui de nous fondre dans la norme blanche et occidentale ? C’est une interrogation d’écrivaine et une préoccupation militante. C’est là un autre point « signifiant » : j’écris dans l’arène. Qu’est-ce à dire ? Que contrairement au poncif sur la littérature et l’engagement politique, la militante en moi ne combat pas l’écrivaine et l’écrivaine en moi ne combat pas la militante. Ce qui me donne du cœur à l’ouvrage, qui me permet d’écrire sans trembler, qui me contraint – favorablement – à une certaine éthique de l’écriture, c’est le sentiment de prendre part à l’époque et d’inscrire mon geste dans un mouvement collectif antiraciste et décolonial.
Tout en haut de vos remerciements figure Houria Bouteldja. Pouvez-vous nous raconter le lien qui vous unit à elle et au Parti des indigènes de la République (PIR) ?
C’est simple : si je n’avais pas croisé il y a quelques années le chemin du PIR, et plus particulièrement celui d’Houria Bouteldja, j’aurais écrit de la soupe intégrationniste, confuse et misérable – je plaisante à peine. La politique m’a sauvée : c’est là que j’ai appris que nous n’étions pas condamnés à négocier honteusement notre petite place sur le dos d’autres barbares, mais qu’il nous revenait de penser la poursuite de la lutte pour notre dignité entamée par nos aïeuls.
Quant à Houria Boutedja, si je dis qu’elle a sauté la première, c’est parce qu’elle est l’incarnation vivante de ce titre, Rester barbare. Elle est celle qui a mené dans ce pays des « attentats » idéologiques et politiques dont les forces traditionnelles peinent encore à se remettre. Elle a créé une langue politique nouvelle, débarrassée du surmoi civilisationnel. Après elle, il devenait possible de relever la tête, d’arrêter de se justifier pour rien, et de penser hors des sentiers prévus par la République. La remercier dans ce livre est aussi ma manière d’appliquer ma propre devise « rester barbare » : ne céder à aucun chantage à la respectabilité et ne jamais douter de la moralité de ce que nous défendons.
Pour vous, le barbare est « irrécupérable ». Qu’est-ce qui le caractérise ?
J’ai en tête une vidéo de James Baldwin dans laquelle on le voit dire à propos du processus intégrationniste : « Something doesn’t work. » Il y raconte comment, à la fin d’un parcours exemplaire de jeune homme noir plein de bonnes volontés et tout entier mobilisé pour s’intégrer dans la société américaine, « quelque chose ne marche pas ». Il le dit et éclate de rire. C’est cela, la barbarie intime. D’abord, l’idée d’un irréductible en soi qu’il s’agirait de chérir plutôt que de cacher ou de détruire en vain. Ensuite, la considération que cet inassimilable est l’occasion de saper toutes les règles du jeu, d’éclater de rire face à un système démuni qui ne sait plus identifier ce qu’il voit, et qui dans la panique finit par conclure à notre « barbarie » dans son sens à lui, c’est-à-dire la disqualification de notre humanité.
Tout ce que l’Empire ne comprend pas, il l’appelle « barbare », c’est le sens étymologique du terme. Mais ne pas être cerné, échapper aux radars, c’est une perspective amplement plus désirable que celle d’être le serviteur zélé de l’Empire, non ? Et pourtant, tout nous pousse à ne pas prêter l’oreille à ce feu qui brûle en nous, à vouloir l’éteindre. Au contraire, c’est le refoulement de ce feu intime qui est dangereux : c’est là que nous pouvons nous mettre à « péter un câble ».
La littérature récente a fait émerger la figure du transfuge. Quel regard porte sur lui le barbare ?
Le transfuge de classe tel qu’il est employé majoritairement aujourd’hui dit : « Regardez-moi, malgré tous mes efforts, je continue à ne pas jouir des mêmes places que les privilégiés ! Scandale ! » Le barbare : « Je n’ai rien à gagner à m’intégrer dans votre monde. Mon honneur, c’est d’avoir échappé à l’intégration complète. » Il préfère interroger la légitimité du mythe intégrationniste au lieu de chercher à démontrer vainement qu’il n’est qu’un mythe. Par ailleurs, le barbare est une figure fondamentalement collective. Il ne se conçoit qu’en termes de « horde » ou de « peuple ». Ça, c’est important : ce n’est jamais une individualité qui cherche à tirer son épingle du jeu et qui, ne parvenant pas exactement à ses fins, finit par désespérer. Le barbare est un destin commun qui se dote d’une dimension épique, singulièrement charismatique.
La sociologie est impuissante à saisir cette part active en nous qui refuse l’intégration
Vous écrivez : « Dire l’ensauvagement est un processus intégrationniste. » La sociologie est-elle inapte à raconter la condition barbare ?
La sociologie a plutôt tendance à réactiver la figure du sauvage : l’être à sauver, à développer. Elle renvoie tous nos maux de postcolonisés à des histoires de « manques ». Il y a évidemment quelque chose de vrai là-dedans, mais il me semble qu’elle est impuissante à saisir cette part active en nous qui refuse l’intégration et qui ne se laisse ferrer par aucun outil d’analyse traditionnelle. Se raconter en demeurant une énigme pour l’Empire, c’est le pari du récit de la barbarie.
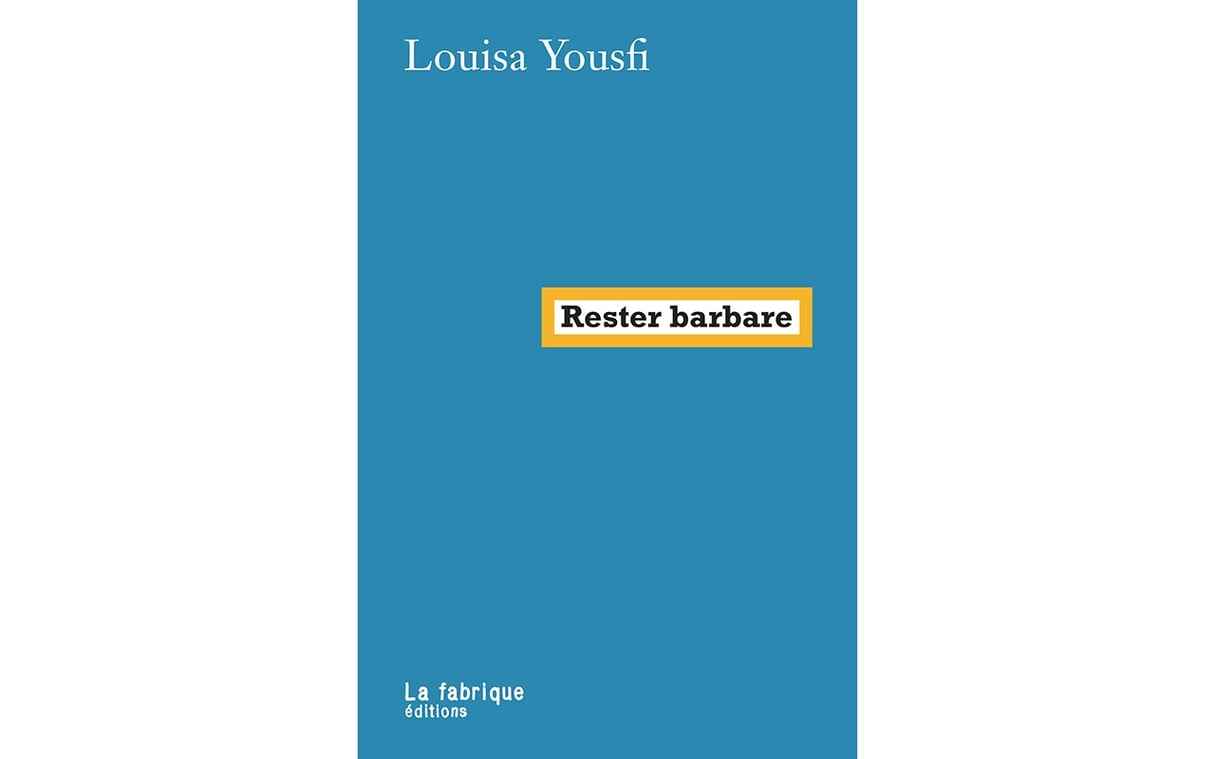
"Rester barbare", par Louisa Yousfi. © Anthony Francin/La fabrique éditions.
Le rap a une fonction centrale dans votre livre, celui de raconter au plus près la « réalité augmentée » des barbares. Que dit cette langue du rap ?
Disons qu’elle a vraiment « des choses à dire » pour reprendre l’expression de Kateb Yacine. Cela ne passe pas forcément par le sens, mais par une espèce de cartographie de reconnaissance immédiate, une « télépathie secrète » qui parle à la communauté des barbares. Privés de langue propre, ils apprennent ainsi à se voir et à se raconter autrement : ni neutralisés, ni élucidés, ni ratatinés. « Augmentés », oui. Une véritable mythologie de la condition barbare.
Nous, femmes issues de l’immigration, souffrons d’un trop-plein, notamment d’un traitement de faveur qui est une arnaque
Dans le dernier chapitre, vous tracez les lignes de votre projet littéraire, celui d’écrire en tant que femme issue de l’immigration. Que manque-t-il selon vous aux voix féminines issues de l’immigration ?
Précisément, rien. Nous souffrons d’un trop-plein, notamment d’un traitement de faveur qui est une arnaque. La manière dont l’Empire cherche encore à politiser nos intérêts de genre sur le dos de nos communautés alourdit notre geste d’écrivaines, nous qui avons dès lors à dealer à la fois avec les fantômes du passé, comme celui de la « beurette », et avec l’époque qui attend de nous que nous réparions les représentations en écrivant « joliment » sur les « jolies choses » qui constituent nos communautés. Il y a donc un devoir de responsabilité allié à un devoir de réparation : comment écrivons-nous en « restant barbares » à partir de cela ? Voilà l’impasse. J’essaie de trouver des voies, des « ruses » même, pour la dépasser. C’est ce que j’ai appelé « la voie du blâme ».
Rester barbare de Louisa Yousfi (La fabrique éditions, 112 p., 10 €)
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus – Culture
- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...
- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...
- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?
- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés
- Bantous : la quête des origines






