Jennifer Richard : « L’impérialisme n’est pas mort. Au contraire, il se perpétue »
Dans « Notre royaume n’est pas de ce monde », la romancière franco-américaine dissèque avec brio et érudition les rouages de l’exploitation coloniale, au-delà de la Première Guerre mondiale. Interview.

Jennifer Richard, à Paris, le 15 septembre 2022. © Bruno Levy pour JA
Après Il est à toi ce beau pays (2018) et Le diable parle toutes les langues (2021), qui relate la vie du marchand d’armes Basil Zaharoff, l’auteure franco-américaine Jennifer Richard continue d’explorer la période 1873-1916, avec Notre royaume n’est pas de ce monde. Un roman de plus de 700 pages, précisément documenté, qui démonte tous les ressorts de l’impérialisme et en dénonce la perpétuation. Un fonctionnement que Basil Zaharoff, personnage également présent dans ce dernier opus, résume ainsi en s’adressant à Blanche Delacroix, maîtresse puis épouse et veuve du roi des Belges Léopold II : « Madame, le servage a rendu possible la construction de ce château, les colonies vous ont donné les moyens de l’acquérir, et la guerre me permet aujourd’hui de vous l’acheter. » Rencontre avec la romancière, à Paris.
Jeune Afrique : Notre royaume n’est pas de ce monde met en scène de nombreux personnages historiques. Mais il s’articule surtout autour de l’opposition entre Léopold II et le pygmée Ota Benga.
Jennifer Richard : C’est le point de départ de tout. J’ai découvert l’histoire d’Ota Benga dans un guide touristique, en 2015. Je partais de rien, je n’avais aucune connaissance sur l’Afrique, aucun lien personnel avec elle et aucun intérêt pour la colonisation quand j’ai lu cet encart du « Guide du routard », lors d’un voyage à New York.
J’ai alors appris que ce pygmée avait été exposé pendant trois semaines au zoo du Bronx, en 1906, dans la cage des singes. J’ai été choquée, comme j’imagine beaucoup de lecteurs du « Guide du Routard » ! J’ai alors envisagé d’écrire son histoire. Mais en lisant sa biographie, Ota Benga, un Pygmée au zoo, de Phillips Verner Bradford – le petit-fils de Samuel Phillips Verner, le missionnaire américain qui fit venir Ota Benga aux États-Unis –, je me suis rendu compte que la vie de ce missionnaire schizophrène, qui travailla pour Léopold II, était tout aussi intéressante et que je pouvais plus aisément m’identifier à lui, ma culture étant plus proche de la sienne…
Vous racontez tout de même une grande partie de la vie d’Ota Benga !
Il a eu une vie incroyable, il a beaucoup voyagé. Mais je ne suis pas entrée dans sa tête, je n’ai pas essayé d’expliquer sa psychologie. Il m’a ouvert une porte, je l’ai suivi ainsi que tous les personnages qui ont gravité autour de lui. Il m’a permis de découvrir cette histoire et la façon dont le pouvoir politique pouvait exploiter les bons sentiments d’une population, par exemple en lui faisant croire qu’il allait lutter contre l’esclavage alors qu’il s’agissait de prendre pied en Afrique. Le duo Léopold II-Ota Benga fonctionne bien : il permet de comprendre cette ère politique.
Pourquoi avoir choisi Ota Benga, comme narrateur ?
Choisir un pygmée du Congo, c’est une manière de dire que l’on se place au-delà des questions de race. Un pygmée n’intéresse personne, nulle part. C’est le symbole même de l’opprimé, qui vit dans une forêt, sur une terre que tout le monde convoite. Il a sur le dos tous les industriels, tous les prospecteurs occidentaux, ainsi que tous les passeurs et les intermédiaires africains qui lorgnent son territoire. Il est victime de tous, et c’est pour cela que je ne parle pas de racisme.
Quant à Léopold II, c’est l’ogre occidental, que vous dépeignez surtout par les yeux de sa maîtresse française, Blanche Delacroix.
Cette histoire est elle aussi incroyable. Blanche Delacroix, qui a obtenu le titre de baronne de Vaughan, a fait écrire ses mémoires, dans lesquels elle évoque les richesses qu’elle a extorquées aux Belges et aux Congolais grâce au roi. Tout est détaillé ! On la déteste, dans le livre comme en Belgique !
Léopold II ne se cachait pas d’avoir des maîtresses, et celle-ci était sa favorite. Mais les Belges aimaient beaucoup la reine Marie-Henriette de Habsbourg-Lorraine. Réputée proche du peuple, elle se rendait au marché pour rencontrer ses sujets. Les Belges avaient du mal à accepter les extravagances du roi avec cette petite greluche de Blanche !
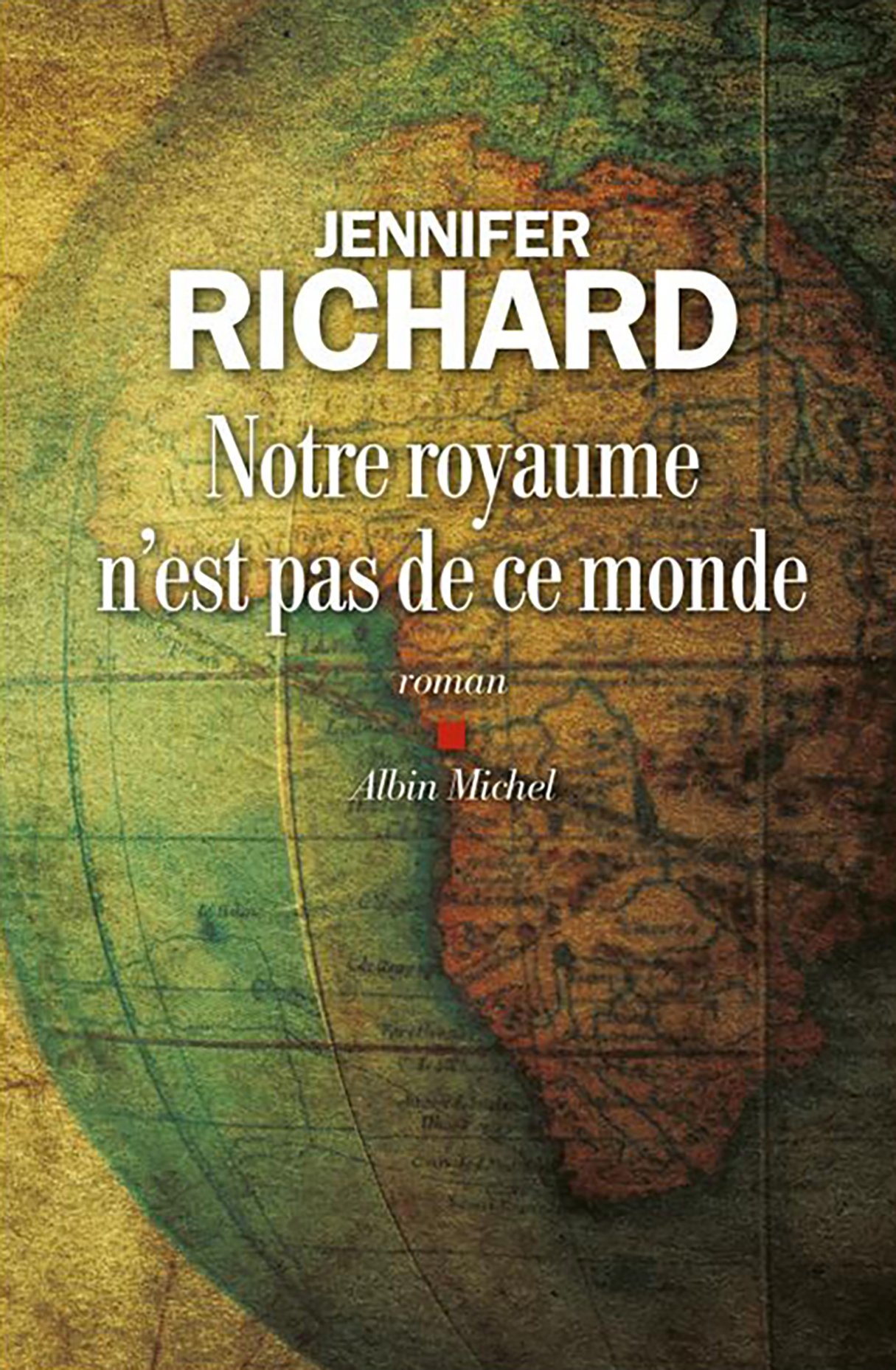
© DR
Vous ne décrivez pas Léopold II comme un personnage sympathique, évidemment, mais vous ne le déshumanisez pas non plus.
L’idée n’était pas de le diaboliser, même s’il fait un méchant idéal, même s’il est un homme obsédé par sa maîtresse, un ogre dont il serait difficile de lisser le caractère. Pour autant, je n’aimerais pas qu’on se dise uniquement « Quelle ordure ! ». Je veux montrer que l’on est dans un processus politique d’exploitation.
Léopold II n’est que le deuxième monarque d’un petit pays qui met la main sur un territoire d’une superficie démesurée par rapport à sa métropole. Comme je le raconte, il se passe exactement la même chose avec la IIIe République en France ou avec le Royaume-Uni de la reine Victoria. Ces pays utilisent les mêmes procédés de propagande visant à faire croire qu’ils vont apporter la civilisation à des peuples alors qu’il s’agit seulement d’extorquer leur territoire et d’exploiter leur jeunesse.
Au-delà de la colonisation, votre livre s’attaque surtout au système impérialiste.
C’est tout un système économique que j’ai découvert, et toute une propagande qui existe encore. Cela m’a ouvert les yeux sur la politique, aussi je n’ai pas voulu me cantonner à un discours de dénonciation de la colonisation et du racisme. Le système qui se met en place sur tous les continents et dans tous les pays est le même du nord au sud, de l’est à l’ouest, au Congo comme en Afrique-Équatoriale française. C’est pourquoi j’ai voulu aussi évoquer de nombreuses personnalités qui ont été assassinées pour avoir dénoncé ces exactions.
En effet, la période 1870-1916, que vous racontez en détail, est commentée par Jean Jaurès, Rosa Luxemburg, Pier Paolo Pasolini, Saddam Hussein, Oussama Ben Laden, Samuel Doe…
Tous ont été assassinés parce qu’ils luttaient contre l’impérialisme, chacun avec ses propres moyens. Je ne voulais ni rester bloquée sur le thème de la colonisation, sur l’Afrique centrale ou sur une période de l’Histoire trop limitée, ni opposer les Noirs aux Blancs. J’ai une vision très marxiste de l’Histoire. L’idée était de montrer les intérêts économiques des Européens et des Américains à l’œuvre derrière leurs discours. Ces faits peuvent être commentés par des personnalités qui ont vécu la même chose bien des années plus tard, pour démontrer que la colonisation ne s’est pas arrêtée au moment des indépendances. L’impérialisme n’est pas mort. Les intérêts économiques sont toujours là, le sous-sol est toujours aussi riche, et les détenteurs du pouvoir sont toujours les mêmes.
Les opposants à l’impérialisme que vous citez entretiennent tous des liens, plus ou moins forts, les uns avec les autres…
Oui, par exemple Mouammar Kadhafi était un fan d’Abraham Lincoln. Tel un duo qui se perpétuerait dans l’Histoire, Martin Luther King et Malcolm X sont les pendants de Booker T. Washington et de W.E.B. Du Bois. Le cinéaste et écrivain italien Pier Paolo Pasolini a lutté contre la société pétrolière ENI et ses activités en Libye ; il est donc un peu lié à Kadhafi, mais, surtout, il est le pendant de l’activiste nigérian Ken Saro Wiwa, qui s’est insurgé contre Shell : tous deux ont mené un combat assez similaire et ont été assassinés.
Quant au Centrafricain Barthélémy Boganda, sa mère est morte en travaillant dans une plantation de caoutchouc. Ce qui est fou, c’est que tous ces hommes sont morts jeunes. J’ai calculé que l’espérance de vie d’un anti-impérialiste était de 48 ans.
Vous vous montrez tout de même assez tendre à l’égard de certaines figures de la colonisation, comme Pierre Savorgnan de Brazza…
Je pense qu’il y a eu certaines figures sincères sur le terrain, des missionnaires, des aventuriers. Mais, très vite, d’autres personnages ont pris le pouvoir : des agents commerciaux, des militaires, qui ont verrouillé hiérarchiquement le système. On a eu des héros, les Stanley, Livingstone, Brazza, qui ont été portés aux nues, puis, tout à coup, il a fallu changer de discours et on les a jetés à la poubelle.
Brazza, qui est un héros jusqu’à la fin du XIXe siècle, un chouchou des médias de l’époque, un prince charmant pour toutes les femmes, finit par se demander : « Que faisons-nous donc ? J’ai livré le territoire d’un pays qui m’a adopté et que j’aime à des individus qui sont en train de le vendre à la découpe à des industriels et à des exploiteurs ! »
À partir de ce moment, on le traîne dans la boue, on fait de lui un fondamentaliste musulman. Dans les articles de l’époque, on traite Brazza comme on traite aujourd’hui les frères Kouachi [auteurs de l’attentat contre l’hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo, en janvier 2015]. Et dans le même temps, pourtant, on va le chercher – grâce à Jaurès – pour lui confier une mission d’enquête au Congo, qui restera secrète jusqu’en 2014, date à laquelle l’historienne Catherine Coquery-Vidrovitch retrouvera son rapport expurgé.
Vous consacrez aussi de nombreuses pages à Roger Casement, qui dénonça, entre autres, les violences coloniales au Congo. Qui était-il ?
Casement est un personnage extraordinaire qui a dénoncé les exactions coloniales belges au Congo, puis celles commises au Pérou, dans le Putumayo. Son rapport a d’ailleurs été lu par Rosa Luxemburg, qui en a été très impressionnée. Elle en parle dans certains de ses écrits.
Après avoir dénoncé l’emprise coloniale du Royaume-Uni sur l’Afrique et l’Amérique, Sir Roger Casement a rejoint l’Allemagne afin de tenter de fournir des armes aux indépendantistes irlandais. Bipolaire, en dépression la plupart du temps, il a eu une fin tragique. Les carnets dans lesquels il racontait ses relations homosexuelles ont été rendus publics et il a été pendu pour haute trahison par les Britanniques. C’est une figure que ces derniers devraient aujourd’hui mettre en avant.
Votre livre est très documenté. Quelle part laissez-vous à l’imagination ?
Il y a très peu de fiction. J’ai lu beaucoup de livres (français, belges, anglais, américains) sur la colonisation, des biographies, des discours, des journaux de missionnaires, des articles de presse en accès libre sur Gallica. Tout est écrit, en fait, et l’on peut aisément comparer les discours politiques et les actions que les gouvernements occidentaux prétendent mener au nom des droits de l’homme, de la démocratie et des Lumières. Ce décalage entre les paroles et les actes est là, offert sur un plateau.
J’ai parfois été obligée de retirer certains éléments de mon livre, car il devenait trop foisonnant. La part du roman réside dans la mise en perspective des personnages, dans les dialogues et les scènes précises, dans les phrases que je mets dans la tête des uns et des autres. En revanche, les dates et les événements que j’évoque sont réels. Aucune anecdote n’est inventée. Je n’écris pas pour faire un beau texte. Ce qui m’oriente, c’est l’idée politique.
Votre livre précédent, Il est à toi ce beau pays, portait sur une période antérieure.
Oui, les deux livres couvrent la période allant de 1873, date de la mort de David Livingstone, à 1916, milieu de la Première Guerre mondiale, qui a éclaté en raison de cette course à la colonisation à laquelle se livraient les pays européens. J’ai coupé mon livre en deux parce que les éditeurs blêmissent quand vous annoncez 1 500 pages ! Entre les deux tomes, j’ai inséré l’histoire du marchand d’armes Basil Zaharoff (Le diable parle toutes les langues) pour bien montrer que mon sujet, c’est l’impérialisme. Celui-ci d’ailleurs ne concerne pas que les Africains, mais aussi les Européens entre eux, le dépeçage de l’Empire ottoman en est une preuve.
Que vous inspirent les positions dites décoloniales ?
Je déteste les cloisonnements, tout comme ces termes d’ « assignation » et d’ « appropriation », qui pourrissent le débat. Je souffre un peu de ce phénomène d’ « assignation », parce que je m’efforce d’avoir un discours rassembleur et d’éviter des propos culpabilisants. Mes personnages font bien la différence entre les hommes politiques et les peuples. Les peuples français ou belge n’ont pas forcément grand-chose à voir avec ce qui a été fait et ce qui se fait en leur nom.
J’ai voulu rassembler des personnalités de tous bords, pour dire que nous devons rester solidaires face aux pouvoirs, quels qu’ils soient. C’est en cela que j’ai une perspective marxiste et que je n’entends pas dénoncer un racisme qui serait ancré chez certaines populations.
Pour l’écriture de mon livre précédent, j’ai rencontré un cercle d’écrivains noirs engagés, qui promeuvent la littérature africaine. « D’où parles-tu et à qui parles-tu ? » m’ont-ils demandé. Je suis Européenne, je l’assume. Je ne parle pas de l’Afrique, je ne prétends pas faire son portrait. Au contraire, je dresse plutôt un portrait de l’Occident à travers ce qu’il a fait de l’Afrique et ce qu’il en fait aujourd’hui. J’ai ma place, on a tous la nôtre. On n’a pas à se voir enfermé dans une case, à se voir interdire d’aborder un sujet. J’essaie de montrer qu’on peut faire revivre des personnages africains, être métis et ne pas parler de racisme.
Vous l’évoquez quand même…
Oui, pour analyser les raisons économiques qui l’expliquent. Aux États-Unis, il n’y a pas de haine du Blanc contre l’ancien esclave, mais une haine du blanc démocrate qui a tout perdu pendant la guerre contre le « nouveau libre » qui votera républicain pour renverser l’ordre qu’il a toujours connu.
Cette haine vient du fait que, dans le Nord, les anciens esclaves ont accepté de travailler pour des salaires plus bas, ce qui a permis de briser les grèves. Cette opposition entre démocrates et républicains a changé au fil des décennies. On ne comprend plus du tout, aujourd’hui, que les abolitionnistes, c’était les républicains, et que le Ku Klux Klan, c’était les démocrates. Le racisme n’est pas épidermique. Il est toujours lié aux intérêts des uns ou des autres, mais cela, personne ne veut l’entendre. Il faut parler d’économie, elle est au centre de tout.
Notre royaume n’est pas de ce monde, de Jennifer Richard, éd. Albin Michel, 736 pages, 24,90 euros
[post-content-frame frame_title= »Un%20homme%20au%20Zoo » frame_content= »La%20vie%20du%20pygm%C3%A9e%20Ota%20Benga%20est%20un%20roman%20%C3%A0%20peine%20croyable.%20Les%20d%C3%A9tails%20en%20sont%20bien%20connus%20puisqu%E2%80%99elle%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20racont%C3%A9e%20dans%20un%20livre%20de%20Phillips%20Verner%20Bradford%20et%20Harvey%20Blume%2C%20traduit%20en%20fran%C3%A7ais%20par%20Bernard%20Ferry%20%3A%20Ota%20Benga%20%3A%20un%20Pygm%C3%A9e%20au%20zoo%20(%C3%A9d.%20Belfond).%20N%C3%A9%20dans%20la%20for%C3%AAt%20de%20l%E2%80%99Ituri%20vers%201883%2C%20membre%20de%20la%20tribu%20des%20Mbuti%2C%20il%20a%20vu%20toute%20sa%20famille%2C%20femme%20et%20enfants%2C%20massacr%C3%A9e%20par%20les%20hommes%20du%20roi%20L%C3%A9opold%20II%20de%20Belgique%2C%20avant%20d%E2%80%99%C3%AAtre%20lui-m%C3%AAme%20r%C3%A9duit%20en%20esclavage%20et%20enferm%C3%A9%20dans%20une%20cage.%20Puis%2C%20achet%C3%A9%20par%20le%20missionnaire%20et%20explorateur%20am%C3%A9ricain%20Samuel%20Phillips%20Verner%2C%20il%20est%20emmen%C3%A9%20aux%20%C3%89tats-Unis%20avec%20d%E2%80%99autres%20pygm%C3%A9es%20pour%20y%20%C3%AAtre%20expos%C3%A9%2C%20d%E2%80%99abord%20lors%20de%20l%E2%80%99e-Exposition%20universelle%20de%20Saint-Louis%2C%20en%201904.%20Ses%20dents%20lim%C3%A9es%20en%20pointe%20et%20sa%20petite%20taille%20font%20le%20bonheur%20des%20visiteurs%20blancs%E2%80%A6%20%3Cbr%3E%0AOta%20Benga%20sera%20ensuite%20promen%C3%A9%20comme%20une%20curiosit%C3%A9%20%C3%A0%20travers%20le%20territoire%20am%C3%A9ricain%20par%20Verner.%20De%20retour%20au%20Congo%20en%201905%2C%20il%20sert%20de%20guide%20et%20d’interpr%C3%A8te%20%C3%A0%20l%E2%80%99explorateur%20afin%20de%20l%E2%80%99aider%20%C3%A0%20amasser%20des%20objets%20de%20valeur%2C%20%C3%A9pouse%20une%20Twa%2C%20mais%20se%20voit%20rejet%C3%A9%20apr%C3%A8s%20le%20d%C3%A9c%C3%A8s%20accidentel%20de%20cette%20derni%C3%A8re%2C%20mordue%20par%20un%20serpent.%20De%20retour%20aux%20%C3%89tats-Unis%2C%20Ota%20Benga%20sera%20log%C3%A9%20au%20zoo%20du%20Bronx%2C%20%C3%A0%20New%20York%2C%20avant%20d%E2%80%99%C3%AAtre%20expos%C3%A9%20sous%20l%E2%80%99%C3%A9tiquette%20suivante%C2%A0%3A%3Cbr%3E%0A%3Cem%3E%20%C2%AB%C2%A0Le%20Pygm%C3%A9e%20africain%20Ota%20Benga.%20%C3%82ge%C2%A0%3A%2023%C2%A0ans.%20Taille%C2%A0%3A%201%2C50%C2%A0m.%20Poids%C2%A0%3A%2046%2C7%C2%A0kg.%20Rapport%C3%A9%20depuis%20la%20rivi%C3%A8re%20Kasa%C3%AF%2C%20dans%20l’%C3%89tat%20ind%C3%A9pendant%20du%20Congo%2C%20au%20sud%20de%20l’Afrique%20centrale%2C%20par%20le%20docteur%20Samuel%20P.%20Verner.%20Expos%C3%A9%20tous%20les%20apr%C3%A8s-midi%20de%20septembre%C2%A0%C2%BB.%20%3C%2Fem%3E%3Cbr%3E%0AL%E2%80%99affaire%20provoque%20un%20toll%C3%A9%20et%2C%20%C3%A0%20la%20fin%20du%20mois%20de%20septembre%2C%20il%20est%20confi%C3%A9%20%C3%A0%20un%20orphelinat.%20Toujours%20d%C3%A9sireux%20de%20rentrer%20chez%20lui%2C%20Ota%20Benga%20m%C3%A8nera%20ensuite%20une%20existence%20d%E2%80%99Am%C3%A9ricain%20ordinaire%20pauvre%20tentant%20de%20survivre%20gr%C3%A2ce%20%C3%A0%20des%20petits%20boulots%20comme%20celui%20d%E2%80%99ouvrier%20dans%20une%20manufacture%20de%20tabac.%20Priv%C3%A9%20de%20tout%20espoir%20de%20retrouver%20sa%20terre%20natale%20apr%C3%A8s%20le%20d%C3%A9clenchement%20de%20la%20Premi%C3%A8re%20Guerre%20mondiale%2C%20il%20se%20suicidera%20d%E2%80%99une%20balle%20dans%20la%20poitrine%20%C3%A0%20Lynchburg%2C%20le%2020%20mars%201916.%3Cbr%3E%0A%3Cstrong%3E%20N.%20M.%0A%3C%2Fstrong%3E » /]
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus – Culture
- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...
- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...
- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?
- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés
- Bantous : la quête des origines






