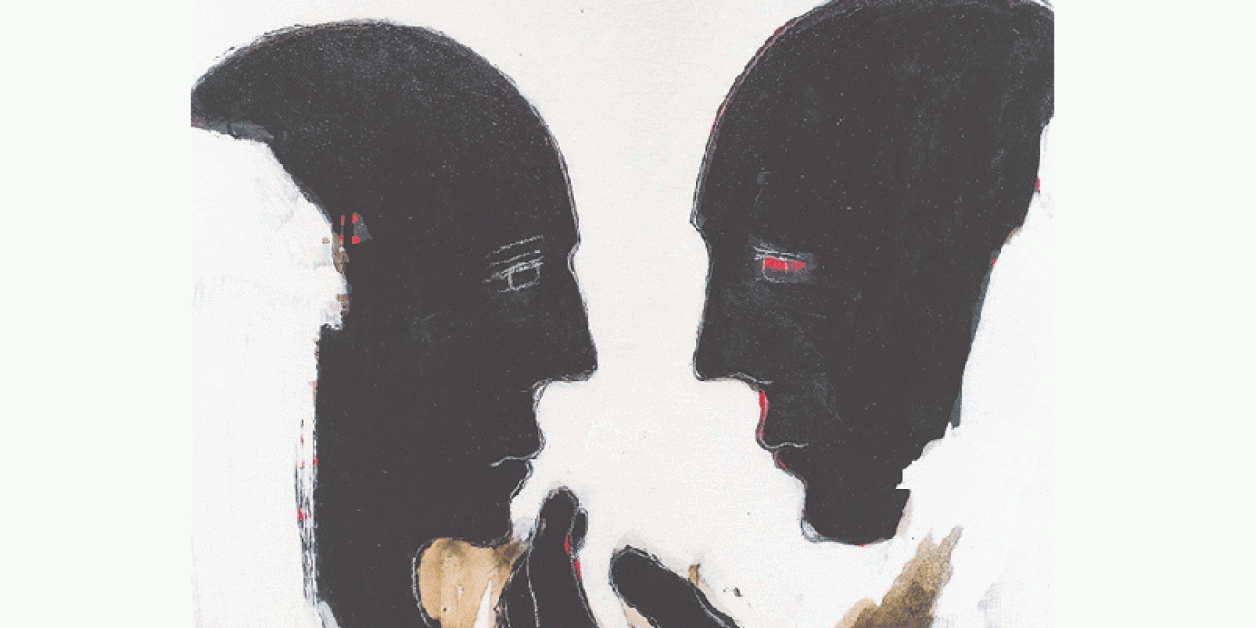Enfants métis du Rwanda et post-colonialisme
Avec « Consolée », son nouveau roman, la Franco-rwandaise Beata Umubyeyi Mairesse revient sur l’histoire de ces enfants arrachés à leurs familles africaines à l’époque coloniale belge et s’en saisit pour décrypter la société actuelle. Entretien.

L’autrice franco-rwandaise Beata Umubyeyi Mairesse. © Cecile Nieszawer/Flammarion
Abordé dans Jeune Afrique, le parcours des enfants métis arrachés à leurs familles africaines pendant la colonisation belge reste largement méconnu. C’est l’un des sujets de Consolée, roman de Beata Umubyeyi Mairesse. L’autrice franco-rwandaise, née en 1979 à Butare, dans le sud du Rwanda, retrace la vie de Consolée, soustraite à sa famille à sept ans dans ce qui s’appelait alors le Ruanda-Urundi. « Les oncles ont dit, prenant un air désolé qu’elle ne leur connaissait pas, que de toute façon, ils n’avaient pas le choix, que l’ordre était venu des chefs blancs et porté par le géniteur jusque-là absent. Aucun de leurs bâtards ne devait continuer à vivre sur les collines avec les indigènes. »
Consolée devient Astrida, l’ancien nom de Butare, parce qu’une autre pensionnaire de l’institut pour enfants mulâtres de Save, à quelques kilomètres au Nord de sa ville natale, porte le même prénom qu’elle. Son destin la conduit ensuite dans une famille d’adoption en Belgique. On la retrouve plusieurs décennies plus tard dans un Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) du sud-ouest de la France. Frappée par la maladie d’Alzheimer, la vieille femme se souvient par bribes mais personne ne peut la comprendre : elle perd son français et s’exprime dans une langue inconnue du personnel, le kinyarwanda.
Je voulais montrer les résonances entre le passé et le présent
Consolée se heurte ainsi à des murs intérieurs, la maladie, et extérieurs, l’indifférence. Ramata, stagiaire en art-thérapie, veut ouvrir une fenêtre sur son passé. La quinquagénaire d’origine sénégalaise se remet d’un burn-out. Elle qui avait gravi toutes les marches de la méritocratie s’est heurtée au plafond de verre. « Lafrance », comme elle l’écrit avec ironie en un mot, n’a pas tenu sa promesse républicaine. À travers Consolée, c’est son propre rapport à sa mémoire et à la transmission à sa fille, Inès, qu’elle interroge.
Beata Umubyeyi Mairesse nous avait impressionnés avec son premier roman, Tous tes enfants dispersés. La romancière et la poétesse se conjuguent pour évoquer l’histoire, non comme une matière figée, mais comme une manière de décrypter la société actuelle. Il est question de racisme, de post-colonialisme, des combats pour l’égalité… Le modèle social est aussi questionné à travers le business des Ehpad, le malaise des personnels soignants. Mais Consolée est d’abord une poignante histoire de femmes emplies d’humanité.
Jeune Afrique : Quand avez-vous découvert l’Institut pour enfants mulâtres de Save, au Rwanda ?
Beata Umubyeyi Mairesse : J’en ai entendu parler dans les médias quand l’association « Métis de Belgique », réunissant les anciens enfants de l’Institut de Save, a mis sur le devant de la scène leur histoire, avec notamment une audition au Parlement belge, en 2017. Save n’est pourtant qu’à quelques kilomètres de Butare, où je suis née et où j’ai grandi. C’est dire que cette histoire a été effacée au Rwanda. Et en Belgique, ces métis ont été invisibilisés pendant des décennies.
Pensez-vous que la prise de conscience du fait colonial soit supérieure en Belgique ?
Je ne sais pas si on en parle plus en Belgique ou en France. Je reviens de Bruxelles où une commission parlementaire sur le passé colonial a travaillé pendant toute une année et a auditionné plus de 3 000 personnes, des chercheurs, des témoins de l’époque, etc. Il y a là-bas une volonté peut-être plus prononcée de se confronter au passé colonial. Le Premier ministre belge a officiellement demandé pardon au nom de la Belgique aux métis des colonies. Je n’imagine pas une chose pareille en France de sitôt, à cause de ce qu’on appelle « la non-repentance ».
Consolée, votre roman, participe-t-il du travail de mémoire ?
Mon roman vise à faire connaître au grand public le sort des métis dans les colonies d’Afrique subsaharienne. Il y a eu des articles à ce sujet mais à travers la fiction, on touche un public plus large. Et je voulais aussi montrer les résonances entre le passé et le présent. On a tendance à voir le fait colonial comme quelque chose de révolu en occultant les conséquences à très long terme sur la vie des gens. J’avais envie de le mettre en résonance avec la réalité de l’immigration post-coloniale en montrant que tout ça n’est pas arrivé de nulle part, qu’une longue histoire nous lie à travers ce passé.
Vous abordez la perte de mémoire historique par le biais de la maladie d’Alzheimer. Est-ce que « un vieux qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle », pour reprendre la phrase attribuée à Amadou Hampâté Bâ ?
Oui, si on ne l’a pas écouté. S’il y a eu transmission, la personne qui meurt n’emporte pas la bibliothèque avec elle et je pense qu’elle meurt beaucoup plus sereinement. Consolée a des choses à transmettre mais Ramata aussi, qui doit trouver un moyen de parler à sa fille. Les expériences des aînés ne sont pas seulement destinées aux livres ou aux musées. Si elles nous sont transmises à temps, elles nous aident à vivre et à comprendre le présent.
Je fais partie de la génération entre, d’une part, les personnes qui ont connu la décolonisation et, d’autre part, les jeunes qui ont grandi en France. Ma génération a cette possibilité de faire le pont, pour apaiser à la fois nos aînés et nos enfants, pour dégoupiller les héritages.
Ramata, parfait exemple d’intégration républicaine, a fait un burn-out avant de se reconvertir professionnellement dans l’art-thérapie. L’assimilation conduit-elle à une perte de soi ?
On lui a fait croire qu’elle pouvait être assimilée, elle y a cru, mais au final il y a eu rejet. Ça veut peut-être dire que l’assimilation n’est pas la bonne recette. L’idée de l’intégration est plus juste sachant que l’intégration ne doit pas se faire dans un sens, ce n’est pas uniquement les gens qui doivent s’intégrer, c’est aussi la société qui doit les intégrer.
Ramata subit le racisme à travers des remarques, des attitudes. Avec Claude Mouret, psychologue québécoise, elle remarque qu’Astrida, seule non-blanche est ignorée. Le combat communautaire est-il une modalité d’action politique ?
Claude vient du Canada où la notion de communauté n’est pas un gros mot, contrairement à la France. J’ai travaillé au Canada avec différentes communautés. Là-bas, il est normal de dire que les problèmes de santé de telle communauté ne sont pas forcément ceux d’une autre communauté. Sachant que communauté, ça peut être la communauté d’âge, d’origine ethnique, d’orientation sexuelle… Mon expérience professionnelle dans le champ de la lutte contre le Sida m’a amenée à défendre des mobilisations communautaires.
S’il y a des spécificités d’expérience, il faut les prendre en compte et non jouer cette petite musique hypocrite française de l’universalisme, qui renvoie souvent au modèle masculin, blanc, bourgeois, hétérosexuel. Je suis pour l’universalisme, si ça veut dire qu’on intègre tout le monde quelle que soit l’origine, la religion, etc. Le combat communautaire peut donc être une modalité d’action dans l’idée d’atteindre l’égalité et non dans un sens de repli communautariste.
Vous évoquez aussi la « hiérarchie entre les métèques » dont ont été victimes Ramata, noire, et son mari Khalil, arabe. Leur mariage a été désavoué par une grande partie de leurs familles respectives. L’unité dans le combat antiraciste est-il une illusion ?
Non car il y a une expérience commune. La vie est une histoire d’expériences, et non de carte d’identité ou de caractéristiques innées. Aujourd’hui, l’expérience du racisme est vécue par les Noirs, les Arabes, les Asiatiques avec parfois des modalités différentes, mais cette oppression est commune. Il peut y avoir une solidarité face à cette oppression.
Dans votre roman, vous évoquez les traces coloniales à travers, en particulier, les statues. Faut-il les déboulonner ?
Quand un esclavagiste ou un colonialiste donne son nom a une rue ou a sa statue au milieu d’une place, c’est de la glorification. Il ne s’agit pas de faire table rase du passé. Ces statues ont tout à fait leur place dans des musées ou dans des lieux où on explique à quelle époque elles ont été érigées, pourquoi, et ce que la société d’aujourd’hui a à dire sur cette histoire. Ça m’a l’air tellement simple à faire mais on est dans une conflictualisation constante du passé et des mémoires.
Vous évoquez aussi l’histoire tragique des Tutsi à travers les tueries de 1959, 1960, 1963. L’Histoire est-elle vouée à être un éternel recommencement et pensez-vous que la situation soit fondamentalement différente aujourd’hui de ce qu’elle était lors du génocide des Tutsi du Rwanda ?
La grande différence est que les pogroms des années 1950/60/70 avaient été suivis d’une totale impunité, ce qui a permis le génocide de 1994. Depuis, il y a eu une justice, certes bricolée avec ce que le pays pouvait faire alors, mais en tout cas une condamnation et un travail d’histoire. Il faut que le passé soit constamment remémoré mais surtout mis en perspective avec le présent, qu’il permette de l’éclairer. Sinon ça ne se sert à rien, on se répète.
Quelle place pour la poésie quand les faits sont si cruels ?
La poésie est une façon de sonder les âmes. J’aime cette phrase du poète espagnol Gabriel Celaya : « La poésie est une arme chargée de futur ». C’est une respiration qui peut dire la souffrance. C’est l’arme la plus efficace face au silence, parce qu’elle touche au cœur.
Consolée de Beata Umubyeyi Mairesse, Autrement, 366 pages, 21 euros
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus – Culture
- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...
- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...
- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?
- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés
- Bantous : la quête des origines