Djamel Tatah face au silence déraisonnable du monde
Le peintre franco-algérien fait l’objet d’une vaste rétrospective au musée Fabre de Montpellier (sud de la France) jusqu’au 16 avril 2023. Une œuvre forte qui raconte une humanité confrontée à la violence.

L’exposition « Djamel Tatah, le théâtre du silence » se tiendra jusqu’au 16 avril 2023 au Musée Fabre, à Montpellier. © Montage JA ; Musée Fabre
Parmi toutes les œuvres de Djamel Tatah exposées pour la vaste rétrospective que lui consacre le musée Fabre de Montpellier (Djamel Tatah, le théâtre du silence, jusqu’au 16 avril 2023), rares sont celles qui portent un titre. Mais en cherchant bien, il est possible d’en dénicher trois : Autoportrait à la Mansoura (1986), Autoportrait à la stèle (1990) et Les Femmes d’Alger (1996). Ces trois exceptions font de toute évidence référence à l’Algérie, pays d’origine de ses parents : si lui est né en 1959 à Saint-Chamond, près de Saint-Étienne, en France, son père, Belkacem, avait quitté sa Kabylie natale en 1947 pour rejoindre la vallée du Gier, où sa femme, Bahdja, le retrouverait en 1956.
« Hybridation »
L’Algérie, Djamel Tatah l’a découverte à 14 ans, en 1973, lors d’un voyage familial. Il y est retourné ensuite à plusieurs reprises, « en quête de ses origines », selon le directeur du musée Fabre, Michel Hilaire. En 1982, Tatah a notamment visité Tlemcen et les ruines antiques de Tipaza, où il a pu voir la stèle érigée en hommage à l’écrivain français Albert Camus – sur laquelle une phrase du Prix Nobel de littérature, tirée de Noces, est inscrite : « Je comprends ici ce qu’on appelle gloire : le droit d’aimer sans mesure. »
Cette découverte sera à l’origine de l’Autoportrait à la stèle, une vaste toile où deux autoportraits en pied du peintre, chacun situé à une extrémité de l’œuvre, encadrent la citation. Larges à-plats de couleurs vibrantes, corps à l’échelle humaine, visages anonymisés et répétés… Les éléments caractéristiques du travail de l’artiste sont là. Mais la plupart des toiles que le peintre réalisera par la suite ne portent que la mention : « Sans titre ». Si l’Algérie coule dans les veines de Djamel Tatah, si son travail s’enracine dans une géographie personnelle, son ambition est bien plus vaste.
Je suis un mutant en France
« L’Algérie, c’est le pays de mes parents, c’est un pays que j’affectionne, mais je n’y ai jamais vécu, je n’y ai jamais eu de vie sociale, dit-il. Dans les années 1980, j’y allais tout le temps, puis c’est devenu trop difficile. Je suis né en France et, en ce qui concerne la souffrance du déracinement, je pense que mes parents ont plus souffert que moi. Cela a été très dur pour eux, sans pour autant être facile pour les personnes de ma génération – jamais intégrés à 100 %. Mais nous nous sommes fait notre place. J’appartiens à ces gens qui sont en mutation. J’aime me définir comme un mutant en France. »
Certains parleraient de créolisation, d’autres de métissage. Djamel Tatah, lui, emploie plutôt le mot « hybridation ». « Il n’y a pas de frontières dans mon regard, soutient-il. L’hybridation est importante dans mon travail. Pour moi, inventer, c’est mélanger. »
Architectures de couleur
Et, avec constance, Djamel Tatah mélange – l’abstraction et la figuration, les images tirées de ses archives, de l’actualité ou de l’histoire de l’art – pour aboutir à un ensemble d’une extrême cohérence. Depuis ses premières peintures réalisées sur des panneaux bricolés à partir de planches irrégulières jusqu’à ses immenses toiles actuelles, Djamel Tatah ne cesse de placer dans des architectures de couleur des corps à taille humaine, pour la plupart habillés de vêtements sombres dont on peut deviner les plis, pour la plupart absorbés dans leurs pensées, pâles et silencieux.
« J’ai toujours travaillé d’après photographies, sur l’idée de temps arrêté, explique-t-il. J’utilise l’ordinateur pour créer des mises en scène et prendre de la distance par rapport aux modèles. Si la technologie s’est améliorée, ma technique n’a pas vraiment changé depuis le milieu des années 1990. Je vidéoprojette les images sur la toile et je dessine les contours avec une grosse craie blanche. Ensuite, je remplis autour du dessin avec de la peinture. »
Rares sont les décors dans la peinture de Tatah, les personnages évoluant toujours dans des plans colorés qui peuvent faire penser à l’abstraction américaine (notamment à Barnett Newman) ou à l’Atelier rouge d’Henri Matisse. « Qu’est-ce qu’un plan coloré ? Je ne parle jamais de fond, je parle plutôt d’espace. C’est l’espace architectural du tableau dans lequel la figure s’intègre comme dans une architecture rationalisée à l’extrême. »
Pour le spectateur, cet espace n’est pas vide : il est habité par ce que son cerveau et son imagination y projettent, guidés en cela par l’attitude, le regard, la position des personnages qui y sont représentés. Et souvent, ces attitudes, ces regards suggèrent la violence du monde extérieur. Dans l’un des cartels de l’exposition, les commissaires Michel Hilaire et Maud Marron-Wojewodzki citent à juste titre cette autre phrase d’Albert Camus : « L’absurde naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde. »
Violence suggérée
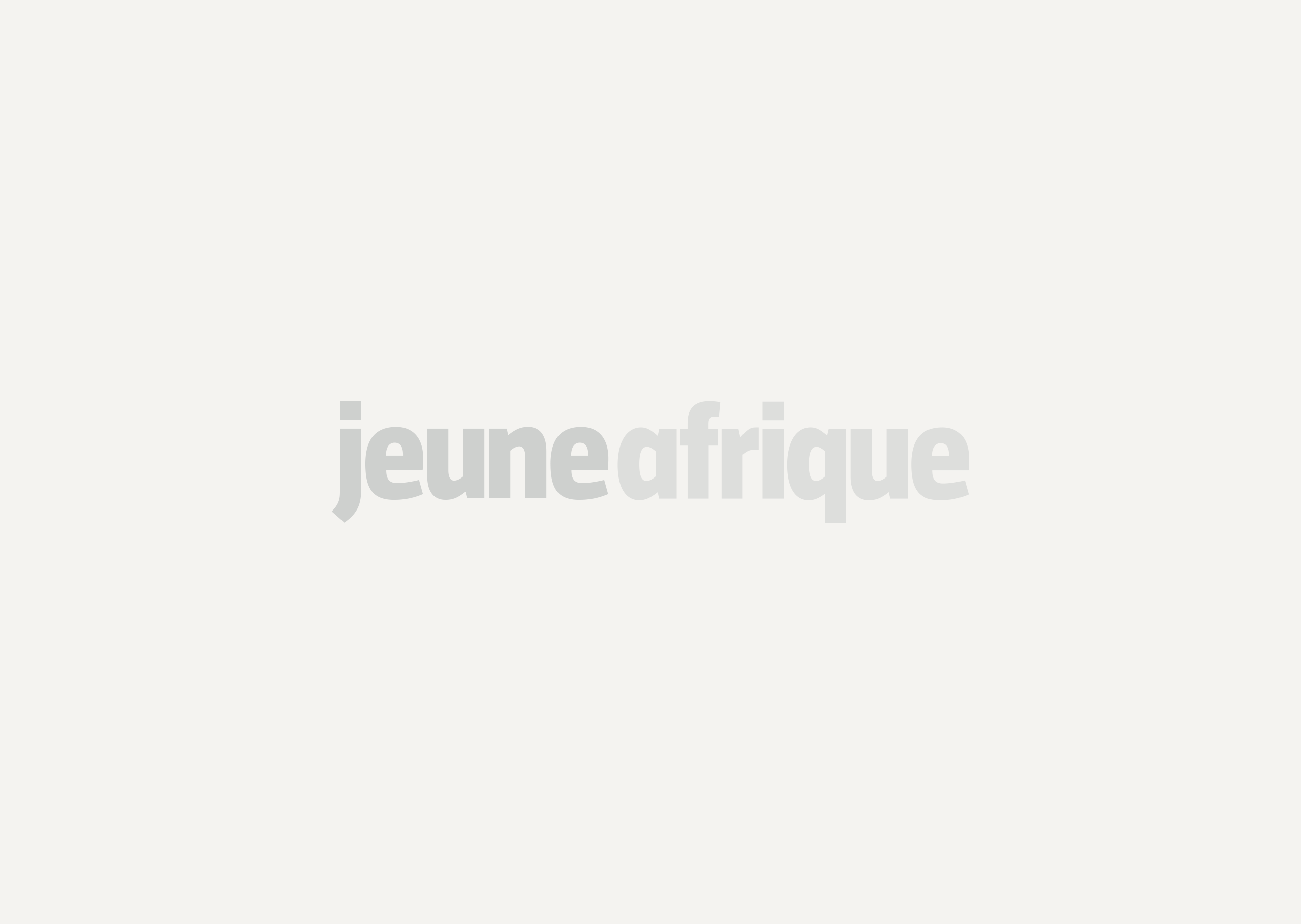
Chez Djamel Tatah, les corps sont tantôt debout, tantôt allongés, tantôt en train de chuter. Les lèvres ne sourient pas, les têtes sont baissées et, quand le regard se lève, il se charge d’un mélange indéterminé de défi, de tristesse, de résignation. « Les personnages de ses tableaux n’en disent pas plus, on ne sait pas qui ou ce qu’ils attendent, ni vers où ils marchent, ni pourquoi ils sont tristes, ni ce qui les attend à leur réveil ou à l’atterrissage, écrit le directeur du musée Berggruen de Berlin, Gabriel Montua, dans le catalogue de l’exposition. Libre à nous d’investir tous ces personnages et les sentiments qu’ils provoquent avec davantage de détails, de les faire passer de leur état premier au statut de protagonistes d’une histoire particulière, qu’il s’agisse de la nôtre ou d’une qui nous intéresserait. »
Mais que ce soient ces Femmes d’Alger qui se tiennent par la main, cette femme qui veille un corps allongé (Sans titre, 2010), cet enfant armé de pierres (Sans titre, 2016), ce corps étendu (Sans titre, 2010), tous semblent avoir affaire à un monde dans lequel « tout le monde peut chuter, à n’importe quel moment, pour n’importe quelle raison ».
Solitude au sein de la foule solitaire, une solitude au milieu des autres
« J’essaie de peindre la présence, la solitude des êtres humains pris dans la tragédie, déclare Tatah à Michel Hilaire. Je cherche à toucher ce qu’est un être humain dans un monde où la violence est toujours là et se répète. Je n’ai pas l’impression qui y ait eu un jour un monde en paix. On dirait que l’humanité est assignée à la souffrance. »
Au fond, il s’agit souvent de conduire le spectateur « à se poser la question de la violence dans le monde », et ce, « sans être démonstratif, sans agresser l’autre, seulement en lui donnant l’espace et le temps de toucher cette réalité ». Pour le philosophe Yves Michaud, « le dénominateur commun à ses personnages, c’est la solitude. Pas une déréliction à signification métaphysique mais une solitude au sein de la foule solitaire, une solitude au milieu des autres, une solitude profondément sociale, celle qu’on ne peut connaître qu’en société. »
Au-delà de l’Algérie
Connaissant les origines de Tatah, la tentation serait grande de faire une lecture « décoloniale » de ses œuvres, comme s’y prête notamment la professeure de la théorie de l’art Natasha Marie Llorens quand elle écrit : « Il m’est de nouveau impossible de réfléchir à cette question sans évoquer l’Algérie, la façon dont l’histoire partagée de part et d’autre de la Méditerranée a fait vivre à de si nombreux corps une suspension existentielle, une chute libre, un recroquevillement. »
Pourtant, les visages stylisés et souvent similaires des êtres humains peints par Djamel Tatah, qui s’inspire en partie des icônes byzantines, aiguillent vers une autre route. « Je cherche l’expression abstraite d’une représentation de l’homme, avec une volonté de dépouillement », affirme l’artiste. Même ses Femmes d’Alger, peintes dans le contexte des années de plomb et liées dans l’histoire de l’art à celles de Delacroix et à celles de Picasso, ne sont pas seulement des Algériennes : elles sont toutes les femmes du monde confrontées à l’oppression.
Le professeur d’histoire de l’art contemporain Erik Verhagen ne dit pas autre chose quand il écrit : « Les bras le long du corps, elles affichent leur dignité et leur fierté. En réaction à la situation algérienne ? Probablement, mais pas exclusivement. Les figures évoluent, il est vrai dans un espace indéterminé, nous rappelant qu’en dépit des rares allusions à sa « communauté », ses œuvres aspirent toujours à une forme d’universalité. »
Universalité
De son côté, Djamel Tatah raconte volontiers ses liens avec l’Algérie, cette langue kabyle qui reste celle de sa mère, ces tapis qu’elle brodait ou même cette rétrospective au musée d’Alger qui fit de lui « l’homme le plus heureux du monde ». Mais il se méfie de l’idée de « nation » qui « cautionne souvent les crispations identitaires, les comportements communautaristes et racistes ».
« La nostalgie ? Très peu pour moi, dit-il. Je ne regarde jamais en arrière. Si mon travail est habité par ce passé, je n’en fais pas un fonds de commerce. J’essaie d’universaliser. » Et il y parvient : ses toiles, dialoguant les unes avec les autres, n’évoquent rien d’autre que l’universelle humaine condition.
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus
- Bénin-Niger : dans les coulisses de la médiation de la dernière chance
- Au Togo, le business des « démarcheurs », ces arnaqueurs qui monnaient la justice
- Qui entoure Mele Kyari, président de la NNPC, l’État dans l’État au Nigeria ?
- Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo, sur les terres de Simone à Bonoua
- Alafé Wakili : « Aucun pays n’est à l’abri d’un coup d’État »





