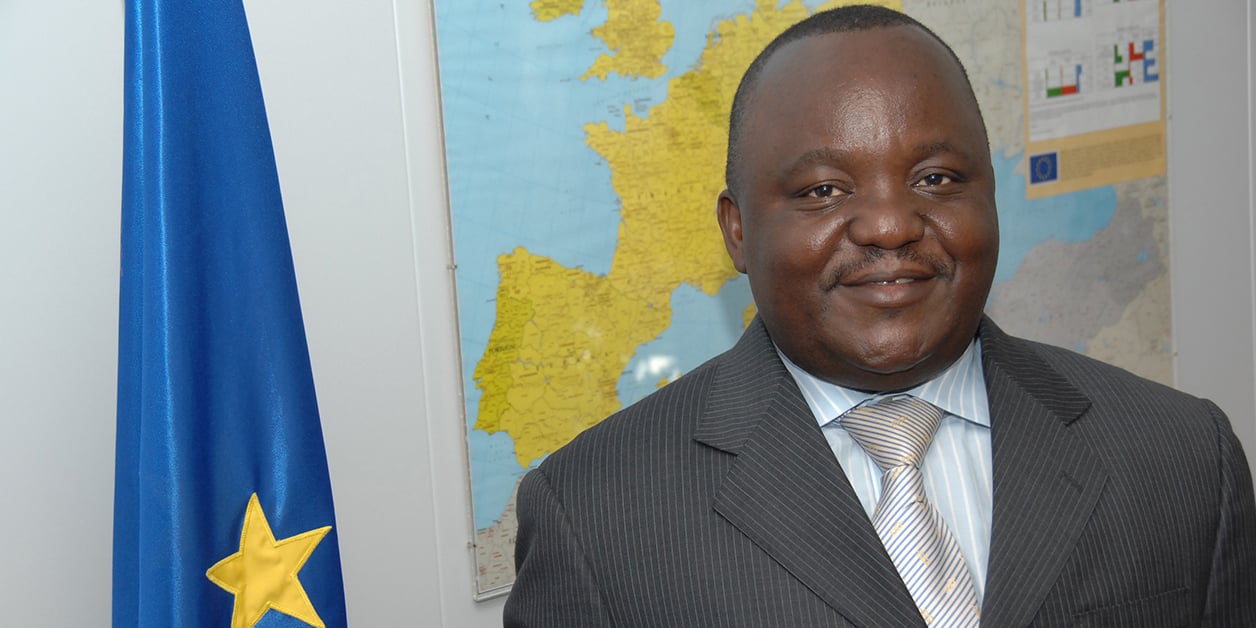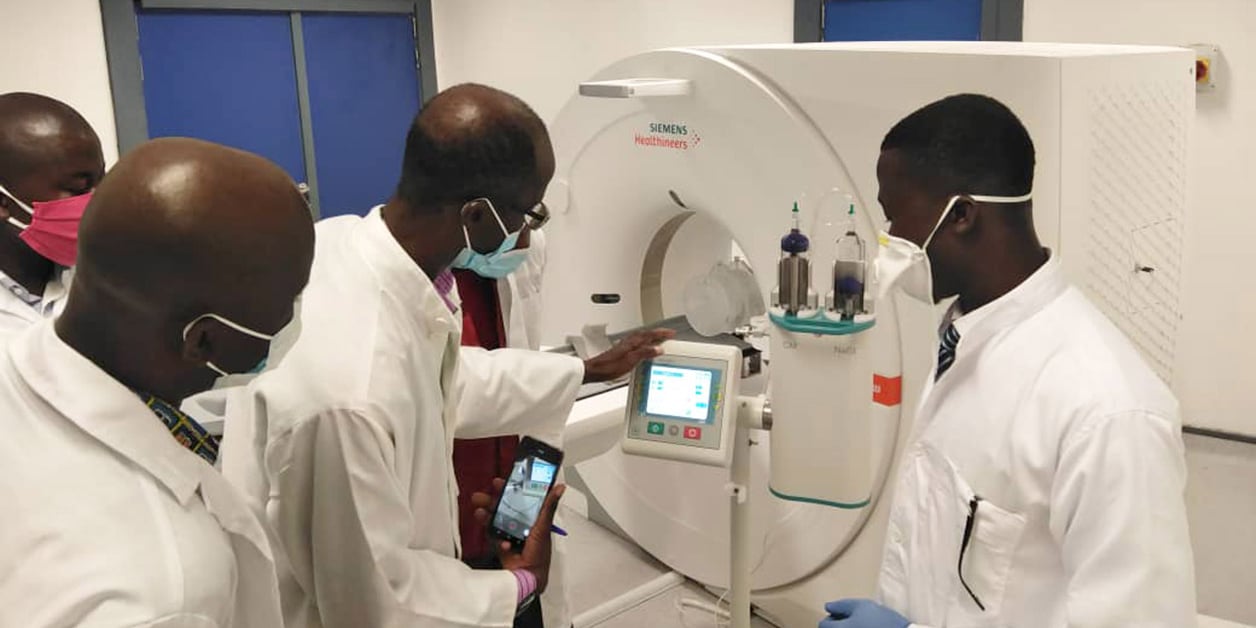Luis Martinez : « Le Bénin et le Togo sont clairement menacés par l’expansion jihadiste »
Alors que la menace jihadiste croît dans le Sahel et se propage aux pays limitrophes, et tandis que la Russie gagne de plus en plus de terrain, l’auteur de « L’Afrique, le prochain califat ? » pointe les erreurs stratégiques de la France.

L’universitaire français Luis Martinez.
L’actu vue par – Chercheur et enseignant au Centre de recherches internationales (Ceri) de Sciences-Po Paris, professeur invité à Columbia et à Montréal, observateur de l’Union européenne en Afrique subsaharienne, Luis Martinez a l’habitude de peser ses mots et de ne pas lancer à la légère des formules provocatrices ou caricaturales. Dès lors, le titre de son dernier livre, L’Afrique, le prochain califat ? (éd. Taillandier, 2023), et son sous-titre évoquant « la spectaculaire expansion du jihadisme » sur le continent ne peuvent qu’intriguer.
Si un spécialiste reconnu, grand connaisseur des pays d’Afrique du Nord et du Sahel, ose une telle formule, c’est visiblement que l’heure est grave. Ce que le chercheur nous confirme ici, en soulignant à quel point les pays occidentaux, France en tête, se sont trompés dans leur analyse du phénomène jihadiste au Sahel, et surtout dans la réponse – essentiellement militaire – qu’ils ont cru y apporter. Des erreurs dont les États concernés paient aujourd’hui le prix.
Jeune Afrique : Les groupes jihadistes occupent des pans de territoire au Mali, au Burkina Faso, au Nigeria, au Tchad, au Niger, et cherchent à étendre leur présence jusque dans le golfe de Guinée. Si la communauté internationale n’a pas vu venir cette expansion, est-ce d’abord parce qu’elle s’est trompée sur la nature même du phénomène ?
Luis Martinez : Quand les premiers groupes jihadistes sont apparus au Sahel, nombre d’observateurs extérieurs ont fait la même analyse que celle qui avait prévalu dans les années 1990 lorsque l’Algérie avait connu une explosion de violence. On a parlé de « combattants étrangers », d’un jihad importé et en partie financé ou soutenu par des pays du Golfe, d’alliances de circonstance avec des groupes locaux ou des trafiquants, on a expliqué cette colère par des raisons économiques et sociales…
Mais, en interrogeant des membres de ces groupes sur le terrain, des prisonniers, des repentis, on s’est aperçu que la réalité était bien différente : ces gens étaient des « locaux » ; une partie au moins du discours des chefs jihadistes faisait sens pour eux, notamment les références à une histoire du jihad, à l’époque pré-coloniale, dans les pays du Sahel. En refusant de voir cela, de nombreux pays ont cru pouvoir apporter une réponse essentiellement militaire, éventuellement accompagnée de quelques mesures sociales, ce qui était une grave erreur.
Vous vous montrez particulièrement sévère envers la France, et précisément envers celui qui fut ministre de la Défense et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Pourquoi ?
Je n’ai rien contre Jean-Yves Le Drian, dont on me dit qu’il est très compétent, mais, ce qui me choque, c’est la manière dont il s’est accroché pendant des années à une lecture des événements de toute évidence erronée. Déjà, j’aimerais que l’on m’explique pourquoi, en 2012-2013, il a été décidé de lancer l’opération Serval, d’envoyer des troupes au sol. Quel était le projet ? Les Français s’étaient beaucoup moqués de l’intervention des Américains en Irak, mais ils ont fait presque pire en Afrique ! Et puis, de 2014 à 2016, Jean-Yves Le Drian a continué à expliquer que la présence militaire était efficace, que les résultats étaient au rendez-vous alors que c’était manifestement faux. Les groupes jihadistes étendaient leur emprise, les attentats se multipliaient…
Vous expliquez cet entêtement par des raisons de politique intérieure française, voire européenne…
Je pense que Jean-Yves Le Drian a été traumatisé par les attentats commis à Paris en 2015. Ils l’ont convaincu que l’Afrique était en passe de devenir une base arrière pour des jihadistes déterminés à frapper la France, et même l’Europe, sur le modèle de Daesh. Ce discours a permis de justifier l’opération Barkhane auprès de l’opinion française, de tenter de mettre sur pied un embryon de force opérationnelle européenne avec la force Tabuka. Mais, en Afrique, l’effet a été dévastateur. Les troupes étrangères n’étaient pas là pour aider les pays ou les populations locales mais pour protéger l’Europe, à distance ?
Ce discours aberrant a placé les militaires dans une impasse et a complètement transformé la perception que les Africains pouvaient avoir de cette présence militaire. Le discours n’a commencé à évoluer que vers 2020, quand Paris a parlé de contribuer à stabiliser la région. Mais il était beaucoup trop tard.
Dans votre livre, vous soulignez que l’épicentre du jihadisme s’est déplacé du Mali vers le Burkina Faso, et que les groupes se répandent dans de nombreux autres États de la région, y compris sous la forme de cellules dormantes. Quels sont les pays menacés ?
Tant que le phénomène était limité au Mali, les observateurs avaient tendance à relativiser la nature « authentiquement jihadiste » de ces groupes en évoquant les revendications indépendantistes de l’Azawad, les conflits avec les Peuls, les Touaregs… Puis, les combattants se sont déplacés vers la zone « des trois frontières » et il est devenu évident qu’une véritable idéologie jihadiste était à l’œuvre, avec un projet transnational reposant sur l’idée d’une communauté des croyants.
On a vu éclore un peu partout des émirats non reconnus, ainsi que des entrepôts d’armes ou de médicaments à la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Les enseignants ont été chassés, puis certaines écoles ont rouvert mais avec un enseignement fondé sur la charia et souvent dispensé en arabe.
Aujourd’hui, le Bénin ou le Togo sont clairement menacés, même s’ils ont du mal à le reconnaître. Dans ces pays où les différentes communautés cohabitent pacifiquement une telle dérive paraît impensable… sauf qu’elle a eu lieu au Burkina ! Conséquence, hélas, les autorités commencent à s’en prendre à certains groupes (notamment aux Peuls) qu’elles assimilent à tort aux jihadistes. Ce faisant, elles sont en train de créer le problème.
Aujourd’hui, les Français disent qu’ils ont compris le point de vue des Algériens… Mais que de temps perdu !
Vous écrivez aussi que l’Algérie a été trop longtemps tenue à l’écart des initiatives menées contre les groupes jihadistes dans la région. Est-ce encore une erreur de la France ?
L’Algérie a 1 400 km de frontières avec les pays du Sahel. Lorsque le G5 Sahel a été constitué, elle n’y a pas été associée alors qu’Alger avait déjà établi un état-major conjoint avec le Mali, le Niger et la Mauritanie : le Cemoc [Comité d’état-major opérationnel conjoint]. Les Français ont, par ailleurs, fait d’Iyad Ag Ghaly l’un de leurs principaux ennemis alors qu’il a toujours été un partenaire de l’Algérie, qui considère qu’il fait partie de la solution et qu’il faut négocier avec lui.
Aujourd’hui, le grand rapprochement diplomatique que l’on observe entre Paris et Alger est en grande partie motivé par la volonté d’impliquer l’Algérie dans le processus. Les Français disent qu’ils ont compris le point de vue des Algériens, qu’ils partagent leur vision sur le Sahel… Mais que de temps perdu !
Que pourraient faire les Algériens pour contribuer à stabiliser la région ?
Ce qu’ils savent très bien faire : créer et héberger une plateforme de négociations entre les parties au conflit. Ils l’ont toujours fait pour les problèmes intérieurs maliens. Sur le fond, leur discours est en substance le suivant : « Nous sommes parvenus à éradiquer les groupes violents chez nous, mais, parallèlement, nous avons fait le deuil du caractère laïc de notre société. Faites comme nous ». C’est d’ailleurs un discours que l’on entend aussi au Nigeria à propos de Boko Haram. Tout le monde est conscient que la guerre ne peut être gagnée militairement. Pas même avec l’aide des Russes ou des Turcs…
En marge de cette zone, la Libye, dont vous êtes aussi un spécialiste, semble plongée dans un chaos sans issue. Quel regard portez-vous sur l’état de ce pays ?
Il se trouve dans une impasse constitutionnelle et politique. Il y a deux Premiers ministres, et il est impossible de fixer un calendrier politique de transition. La production et les exportations de pétrole ont repris, ce qui permet de réinjecter des devises dans ce système politique paralysé. Plus d’une décennie après la chute de Kadhafi, l’échec de la communauté internationale à soutenir et à accompagner la transition a favorisé la mainmise sur une partie de ce pays de puissances telles que la Turquie, la Russie, l’Égypte, les Émirats arabes unis, le Qatar… Un siècle après la colonisation italienne, la Libye est de facto redevenue un protectorat.
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus – Politique
- Sexe, pouvoir et vidéos : de quoi l’affaire Baltasar est-elle le nom ?
- Législatives au Sénégal : Pastef donné vainqueur
- Au Bénin, arrestation de l’ancien directeur de la police
- L’Algérie doit-elle avoir peur de Marco Rubio, le nouveau secrétaire d’État améric...
- Mali : les soutiens de la junte ripostent après les propos incendiaires de Choguel...