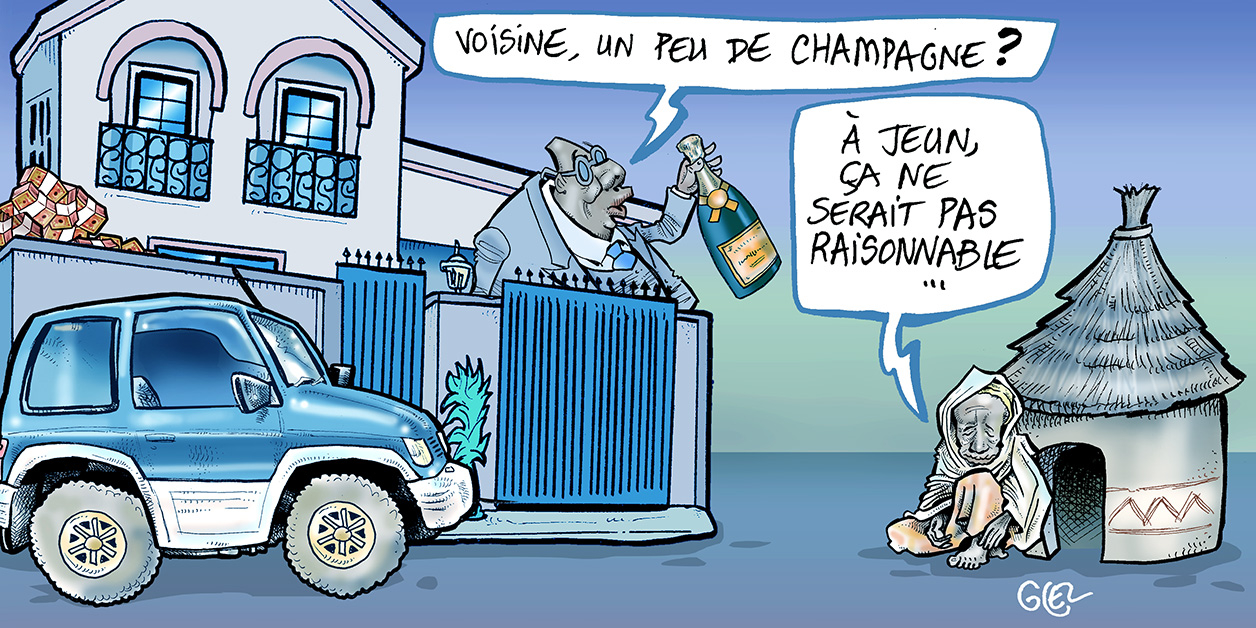En Tunisie, le jeu, une passion populaire
Chkobba, noufi, rami ou poker… Les Tunisiens sont un peuple de joueurs, même s’il n’est pas toujours facile de s’adonner à sa passion dans une société où l’islam en condamne, du moins en théorie, la pratique et où l’État adopte une position ambiguë.

Partie d’échecs dans un café de Redeyef, dans le Sud-Ouest. © Valentine VERMEIL/REA
À un Tunisien qui lui demandait ce qui l’avait étonné en Tunisie, un touriste allemand a répondu : « Vous avez du temps, vous jouez beaucoup aux cartes. » La pratique des jeux de société et des cartes en particulier est tellement répandue que personne n’y prête attention.
« Le jeu est une manière de sociabiliser », commente un historien, qui rappelle que de nombreux jeux de cartes sont des dérivés de jeux italiens, inspirés eux-mêmes de jeux introduits lors de la conquête musulmane en Espagne, puis diffusés par les Mamelouks égyptiens au XIVe siècle.
Il en va ainsi de la chkobba, dont on dit qu’elle a pour origine la scopa italienne, ou du noufi, le fameux neuf, qui « devrait être inscrit au patrimoine de l’humanité tant il a créé du lien et de la complicité entre joueurs qui ne se connaissaient pas », caricature Karim, un assureur qui ne boude jamais une partie en fin de journée. Il retrouve ainsi régulièrement les copains du quartier où il a grandi, « histoire de ne pas se perdre de vue et de partager un moment ensemble ». Une manière de préserver les liens sociaux, mais aussi de se prémunir contre l’ennui.
La pratique de ces jeux est si populaire qu’ils sont considérés comme « le sport le plus apprécié, après le football, par la population », et elle est vraiment vivace dans toute la société. Nantis ou démunis, ouvriers ou patrons, tous apprécient de jouer et se sentent égaux devant le jeu, ou devant la chance.
« On est comme dans une confrérie, les barrières n’existent plus », rapporte Sonia, qui remarque que dans les jeunes générations, filles et garçons se retrouvent pour une partie de cartes dans les cafés, ce qui n’était pas le cas il y a encore une dizaine d’année. « On peut considérer que c’est un signe d’émancipation », lance un cafetier, qui apprécie cette clientèle à laquelle il facture des consommations, mais aussi l’utilisation des jeux qu’il met à disposition. Un plus pour attirer le chaland. Faute de pouvoir miser de l’argent, celui qui perd règle les boissons et le paquet de cartes.
D’une certaine manière toutefois, la mixité existait déjà depuis longtemps, même si les femmes en général ne jouaient pas en public, puisqu’elles ne fréquentaient ni les cafés ni les clubs masculins, et que le jeu lui-même était en quelque sorte tabou dans certaines communautés.
Mais les femmes jouaient volontiers en famille : « Dans les années 1960, souvent les maîtresses de maison avaient leur propre table de jeu aux côtés de celle des hommes. Avec le temps, et aussi selon la disponibilité des joueurs, dans certaines familles, femmes et hommes se sont mis à jouer ensemble », explique un ancien joueur, qui se souvient de tout le soin apporté pour accueillir les hôtes d’une soirée de poker ou de rami.
Survivance de l’époque coloniale
Au tout début de l’indépendance, les cercles de jeu étaient nombreux, même si les jeux d’argent étaient interdits aux musulmans par la loi et le Coran. « Il y avait une survivance de ce qui existait du temps de la colonisation. À Carthage, au rond-point à côté du Palais, une Européenne a longtemps tenu une sorte de cercle. Elle mettait à disposition sa maison, pourvoyait aux boissons et à la nourriture, et prélevait une cagnotte, c’est-à-dire un pourcentage sur les mises. Elle gagnait sa vie ainsi », se souvient un habitué des clubs sélect culturels de Tunis et de sa banlieue.
Ceux-ci étaient organisés sur le principe des clubs anglais : les mises n’étaient pas importantes et la cagnotte servait à payer les frais de chaque cercle, dont les plus connus étaient ceux du Touring Club à Tunis et du Club de l’Ariana.
Pratiqué par tous, le jeu a cependant toujours mauvaise réputation, surtout dans les milieux citadins. « Il ne s’agit pas de morale, mais on a vu des familles détruites par les addictions aux jeux », justifie Fatma, dont le père s’était même fait interdire de casino en France où il allait jouer faute de pouvoir le faire en Tunisie. Ceux qui perdent et n’honorent pas leur dettes sont mis à l’index. En Tunisie, les mauvais payeurs ou les tricheurs sont écartés de la communauté des joueurs par le seul effet du bouche à oreille.
Les préjugés sur les joueurs sont tenaces. Qui s’adonne au jeu aurait de l’argent, mais aussi du temps à perdre. Ce serait donc un oisif, avec ce que cela comporte de connotation négative. Pourtant, les grands joueurs sont souvent également des capitaines d’industrie connus pour être de grands travailleurs, mais rien n’y fait : la société perçoit le jeu comme un péché capital de plus. Mais comme tout interdit, il est très attractif et génère des addictions sévères.
En Tunisie, seuls les étrangers ont accès aux six casinos implantés dans les zones touristiques de Hammamet, Sousse et Djerba. « On y joue en devises, et c’est un apport pour le tourisme », estime un hôtelier, qui note l’essor du secteur au Maroc, où le jeu est légal. La Tunisie a préféré adopter une position qui ménage le conservatisme ambiant, tout en sachant qu’il n’est que de façade, puisque le jeu est réellement un phénomène de société.
Une taxe de 25 % sur les gains des paris sportifs
« Imaginez ce que cela donnerait en Tunisie, sachant qu’un tournoi à Malte a attiré 4 500 personnes pour 48 heures », lance un agent de voyages de Hammamet, qui relève l’ambiguïté de l’État sur la question. D’un côté, il est en position de monopole sur la fabrication et la distribution des cartes, et contrôle leur prix de vente. De l’autre, il a mis en place une taxe de 25 % sur les gains des paris sportifs en 2016 qui a impacté sévèrement les courses hippiques. « Certains dirigeants islamistes se sont interrogés sur les retombées économiques du secteur des jeux », révèle un expert.
« Le jeu est toujours tabou, mais on est des joueurs dans l’âme », concède Fakher, un inconditionnel des parties clandestines de poker rami. Discrètement, dans les années 1980, certains se hasardaient à organiser des soirées dans des hôtels, mais ils prenaient des risques. D’autres jouaient dans une salle dédiée, comme au café El-Alia de La Marsa. Tout cela était toléré.
« La police savait que nous jouions, nous savions aussi qu’il ne fallait ni connotation politique ni scandales », se souvient un ancien habitué, qui a aussi joué à une table réservée au rami pour 5 ou 10 dinars la partie « dans le coin à gauche, en haut des marches du Café des Nattes de Sidi Bou Saïd « . Une époque révolue, mais l’omerta sur les joueurs et leur mise est toujours en vigueur.
« Dans les années 1980, des parties clandestines étaient organisées par les commerçants du marché du quartier de Carnoy (Tunis), ils venaient avec des sacs d’argent liquide et une arme cachée sous les liasses », confie un riverain.
Parmi les rares anecdotes qui filtrent, une concerne Imed Trabelsi. Le turbulent neveu de l’ancienne première dame, Leïla Ben Ali, avait un soir, dans une maison à Hammamet, lancé un tour de chkobba au bord d’un escalier où, en moins d’une minute, 1 000 dinars ont changé de main.
Jackpot… ou banqueroute
« Au jeu, l’argent ne compte plus, et il faut savoir s’arrêter », assure un repenti. D’autres évoquent des mises parfois extravagantes, mais aussi des terres et des fonds de commerce perdus en une soirée de poker, comme une des plus anciennes pizzerias de la rue de Marseille, à Tunis.
Il arrive cependant que des joueurs se comportent en grands seigneurs, comme le rapporte un témoin : « Un joueur s’était rendu compte que le jeu de cartes avait été marqué, il a remporté la partie mais a immédiatement rendu les chèques de ses adversaires en leur recommandant de ne plus venir jouer dans ce local. »
Mais c’est l’exception qui confirme la règle : le milieu du jeu n’en restait pas moins « glauque », de l’aveu même de ceux qui le fréquentaient. Les professionnels étaient impitoyables et les pigeons nombreux. Loin de l’ambiance bonne enfant des parties endiablées en famille.
Aujourd’hui, « le temps où on s’enfermait dans une maison de campagne pour jouer tout un week-end est révolu. Les tapis verts et les rideaux tirés pour simuler une nuit américaine, c’est devenu ringard. Les gens jouent sur internet et les pics d’adrénaline sont garantis avec plus de 200 000 joueurs en ligne en même temps sur les sites les plus réputés », explique Seif, qui pointe la fermeture du Club Nautique de Sidi Bou Saïd où les habitués jouaient.
L’appât du gain, l’anonymat des écrans favorisent la frénésie pour les jeux en ligne. « Comment contrôler un joueur quand il est devant son ordinateur ou son téléphone ? » dénonce la jeune épouse d’un addict. Sa famille a implosé après la pandémie quand elle s’est rendue compte qu’en fait de navigation sur internet, son mari a pendant des mois joué l’argent du ménage.
« Je ne sais pas comment il a fait pour convertir cet argent en devises, et je ne veux même pas le savoir », déplore celle qui estime que son mari courait après un Graal imaginaire. Pourtant, le jackpot existe, certains l’ont touché : « Tout joueur croit qu’un jour tous les astres seront alignés, et ce n’est pas plus absurde de jouer aux cartes, où les bons joueurs font en permanence du calcul mental pour savoir lesquelles n’ont pas encore été tirées, que de parier sur des courses de dromadaires en plein désert », justifie un Tunisien qui vit pleinement sa passion… au Maroc.
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus
- Au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga limogé après ses propos critiques contr...
- CAF : entre Patrice Motsepe et New World TV, un bras de fer à plusieurs millions d...
- Lutte antiterroriste en Côte d’Ivoire : avec qui Alassane Ouattara a-t-il passé de...
- Au Nigeria, la famille du tycoon Mohammed Indimi se déchire pour quelques centaine...
- Sexe, pouvoir et vidéos : de quoi l’affaire Baltasar est-elle le nom ?