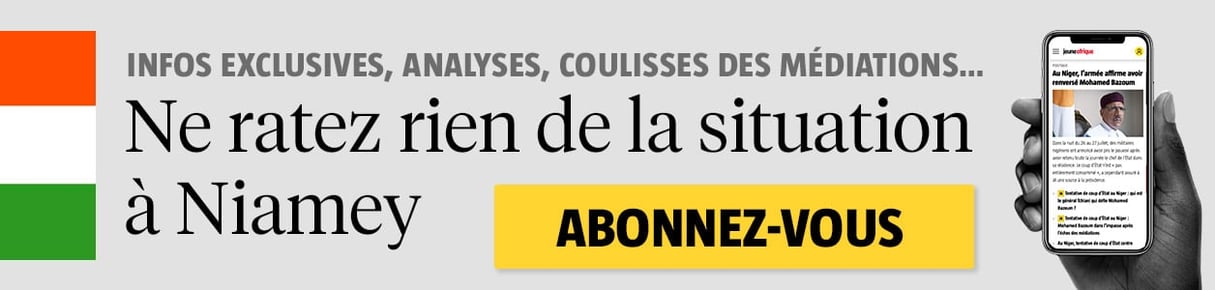Coup d’État au Niger : le grand gâchis
Crise de la démocratie, corruption galopante, affairisme débridé, divisons internes exacerbées, élections truquées… Ces maux qui minent les régimes africains alimentent largement les coups d’État militaires. Même si le coup de force contre Mohamed Bazoum reste incompréhensible, selon Jean-Pierre Olivier de Sardan.

De la fumée s’élève après que des partisans du coup d’État ont mis le feu au siège du Parti pour la démocratie et le socialisme au Niger, du président Mohamed Bazoum, à Niamey, au Niger, le 27 juillet 2023. © Balima Boureima / Anadolu Agency via AFP

-
Jean-Pierre Olivier de Sardan
Chercheur au Lasdel (Laboratoire d’études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local), directeur de recherche au CNRS.
Publié le 29 juillet 2023 Lecture : 5 minutes.
Un général mécontent de sa mutation se mutine et voilà la haute hiérarchie militaire qui fait un coup d’État par solidarité avec lui, afin de « préserver l’unité de l’armée » ! Tout cela est aussi absurde que déprimant, mais n’explique néanmoins pas tout. Prenons donc un peu de recul.
Le coup d’État au Niger est évidemment un mauvais coup de plus porté à la démocratie en Afrique. Il faut dire que celle-ci est en crise depuis longtemps du fait des pratiques des élites politiques. Partout, depuis une ou deux décennies au moins, les opinions publiques africaines sont devenues extrêmement critiques envers tout ce que ce type de régime aurait engendré – ou qu’il a plus exactement amplifié : corruption galopante, affairisme débridé, divisions internes exacerbées, élections truquées, services publics abandonnés, dépendance à l’aide occidentale accrue, la plupart des voyants sont au rouge aux yeux des citoyens, et l’actuelle série de coups d’État militaires (Guinée, Mali, Burkina Faso et maintenant Niger) est autant une conséquence de la crise démocratique qu’une cause de son aggravation.
Démocraties déconsidérées
La première vague de coups d’État des années 1970 tirait parti de la crise des régimes de partis uniques des débuts des indépendances (devenus illégitimes aux yeux des populations), la présente seconde vague tire parti de la crise des démocraties (devenues elles aussi illégitimes). Une des expressions de cette illégitimité est que les démocraties africaines sont non seulement déconsidérées pour les faillites internes de leurs dirigeants mais aussi pour leur occidentalo-centrisme supposé, car elles sont largement perçues comme promues, soutenues, voire imposées par les puissances occidentales, dont on sait qu’elles font désormais l’objet d’un rejet de plus en plus massif. Historiquement, ce n’est pourtant pas exact, l’émergence des démocraties en Afrique a d’abord été le produit de révoltes populaires contre les régimes militaires (à l’époque frappés à leur tour d’illégitimité), et elles ont débouché sur les conférences nationales des années 1990, matrices des démocraties sur le continent. Mais les multiples injonctions démocratiques occidentales qui ont suivi, et ce jusqu’à nos jours, ont abouti à l’effet inverse de ce qu’elles recherchaient (ce qui est vrai d’ailleurs pour à peu près toutes leurs injonctions) : elles ont discrédité encore un peu plus le système démocratique.
Une seconde crise est aussi impliquée, en ce qui concerne le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C’est bien sûr la crise sécuritaire sahélienne déclenchée par l’insurrection jihadiste. Elle s’alimente pour une part de la première car elle s’appuie fortement sur l’échec des régimes démocratiques : le califat est présenté comme supérieur à tous égards à ces derniers. Une grande partie des musulmans sahéliens, séduits par l’idéologie salafiste sans pour autant rallier les jihadistes, estiment d’ailleurs qu’un État islamique serait un progrès considérable par rapport aux démocraties actuelles.
En outre, les progrès un peu partout au Sahel de l’insurrection jihadiste sont imputés à la faiblesse des régimes démocratiques. Les militaires se présentent alors comme un recours et sont applaudis en tant que tels. On oublie que les haut gradés font partie de ces élites honnies, on oublie leur incompétence en matière de gestion de l’administration, on oublie que la corruption et l’affairisme reprochés aux gouvernements sont tout autant répandus au sein des armées nationales (et souvent plus), on oublie que ce sont ces armées elles-mêmes qui n’ont pas été capables de freiner l’avance jihadiste, on oublie que toute réforme de l’État devrait sans doute commencer par une réforme de l’armée. On pourrait parler d’une troisième crise, une crise militaire.
Durcissement du jeu politique
Ce fond de carte une fois dessiné, venons-en au Niger. Il est vrai que ce coup d’État n’est pas le premier de son histoire. Le premier s’en était pris au parti unique (Parti progressiste nigérien-Rassemblement démocratique africain – PPN/RDA) pour instaurer une dictature militaire (dont de nombreux Nigériens sont nostalgiques aujourd’hui, crise de la démocratie oblige). Les trois derniers sont intervenus en régime de démocratie, mais dans des situations de grave blocage de celle-ci, avec pour objectif de la rétablir moyennant une courte transition. Aujourd’hui, rien de tel, c’est au contraire une attaque frontale contre la démocratie, chose que le pays n’a jamais connue.
Considérons maintenant la gouvernance du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS), au pouvoir depuis dix ans : elle n’échappe certes pas aux reproches adressés un peu partout en Afrique à la démocratie. Sous les deux mandats du prédécesseur du président Bazoum, la corruption et l’affairisme ont, de l’avis général, nettement progressé, les services publics sont restés de faible voire de très faible qualité, le chômage des jeunes s’est amplifié, la régularité des élections a été fortement contestée, le jeu politique s’est durci considérablement.
On peut créditer Mohamed Bazoum de réelles capacités d’écoute et de véritables tentatives réformatrices (pour une réhabilitation des services publics, contre la corruption, pour l’apaisement du jeu politique, par exemple), même si sa marge de manœuvre était faible du fait de sa position minoritaire dans le PNDS et du poids important gardé par Mahamadou Issoufou. Il avait aussi réussi à récupérer une certaine popularité, ou en tout cas une certaine indulgence, au sein de la population de Niamey, pourtant nettement hostile au PNDS dans sa grande majorité. Qu’il n’ait pas la possibilité d’aller plus loin, qu’il soit destitué par une alliance improbable de dernière minute entre haut gradés est un coup très dur porté à la construction, au renforcement et à l’institutionnalisation de l’État nigérien.
Bazoum mieux que Issoufou
Quant à la lutte contre l’insurrection jihadiste, même si celle-ci a progressé dans la zone des trois frontières, même si l’armée affichait des failles et avait grand besoin d’être réorganisée, même si elle n’était pas suffisamment adaptée aux contraintes d’une guerre asymétrique, le Niger s’en est jusqu’ici tiré nettement mieux que ses deux voisins. Il y avait une claire volonté politique du chef de l’État de résoudre les conflits intercommunautaires ou de les contenir, certaines négociations étaient ouvertes avec des chefs jihadistes de terrain, et des tentatives prometteuses étaient menées pour restaurer la sécurité et faire revenir l’État au profit des populations dans les zones où les jihadistes font régner la peur. En ce domaine aussi Mohamed Bazoum avait fait nettement mieux que son prédécesseur, se rendant fréquemment sur le front, augmentant significativement le recrutement et l’équipement des forces armées nationales, diversifiant le recours à des soutiens internationaux, et affirmant le commandement nigérien sur l’aide militaire extérieure (en particulier française).
Le coup d’État militaire actuel en est d’autant plus incompréhensible. Il risque fort de faire reculer le pays, de bénéficier aux jihadistes, et d’aggraver les problèmes de gouvernance auxquels les mutins prétendent remédier.
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus – Politique
- Sexe, pouvoir et vidéos : de quoi l’affaire Baltasar est-elle le nom ?
- Législatives au Sénégal : Pastef donné vainqueur
- Au Bénin, arrestation de l’ancien directeur de la police
- L’Algérie doit-elle avoir peur de Marco Rubio, le nouveau secrétaire d’État améric...
- Mali : les soutiens de la junte ripostent après les propos incendiaires de Choguel...