Entre l’Algérie et la Tunisie, François Élie Roudaire et l’utopie de la mer intérieure
En Tunisie, le projet de ramener la mer depuis Gabès jusqu’à la région des lacs salés (chotts) est un vieux rêve qui a inspiré à Jules Verne son dernier roman « L’Invasion de la mer ». Mais qui se souvient de son premier promoteur, François Élie Roudaire ?
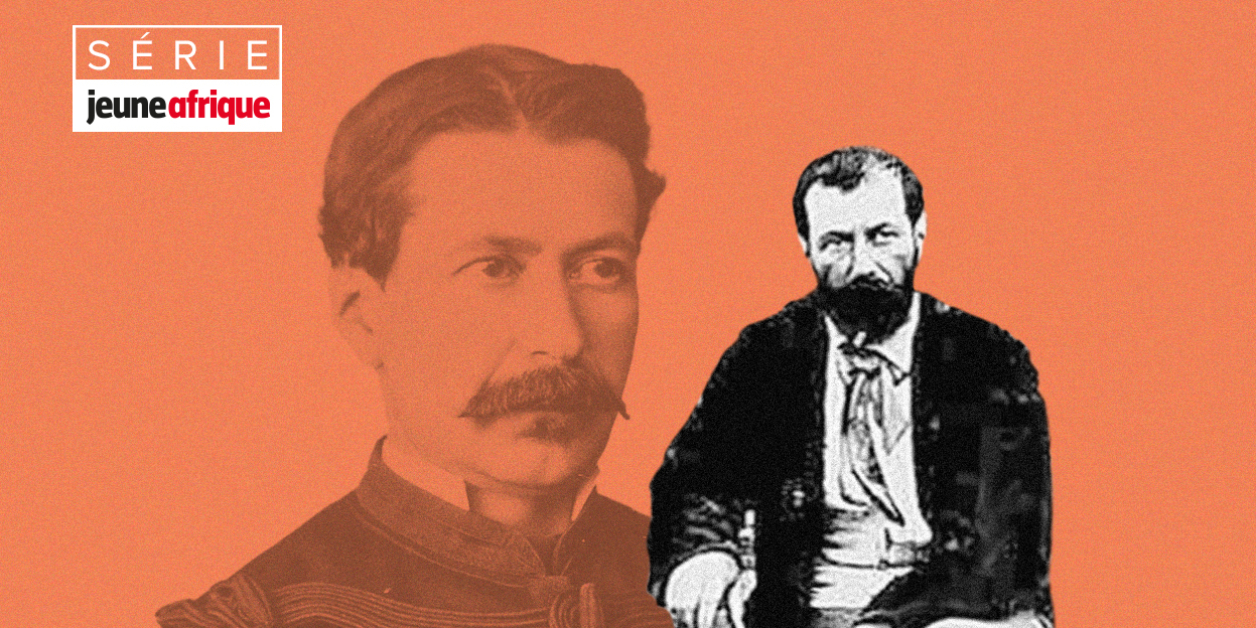
Francois Élie Roudaire. © Montage JA; DR
LE RÊVE MAGHRÉBIN DES AVENTURIERS EUROPÉENS (1/4) – François Élie Roudaire pose sa plume et regarde, avec une grande satisfaction mais également une profonde appréhension, le document qu’il vient d’écrire. Ce projet est celui d’une vie, la sienne. Il n’est pas loin de penser qu’il est aussi celui de l’humanité, enfin de ce que l’on appelle l’ancien monde. Il ferme les yeux et savoure l’instant. Au même moment, à des milliers de kilomètres, le succès de l’inauguration à Port-Saïd (Égypte) du canal de Suez le 17 novembre 1869 lui confirme qu’il est au diapason des avancées scientifiques et que son idée méritait d’être creusée.
Cela fait plusieurs années que ce projet de « mer intérieure » le taraude. Il lui a été inspiré par les explorations et les relevés topographiques qu’il a réalisés dans la région de Biskra à partir de 1864, à l’occasion de l’une de ses toutes premières missions. Issu de Saint-Cyr et de l’École d’application, le fils du directeur du Musée d’art et d’archéologie de Guéret, dans la Creuse, se destine à une carrière scientifique au sein de l’armée. Il sera géographe, géodésien et topographe, des spécialités qui le conduiront dans le sud de l’Algérie, colonie française depuis 1830 mais encore inexplorée.
En effectuant des relevés topographiques dans la région de Biskra, Roudaire note d’importantes dépressions salées et remarque que, sur les cartes, celles-ci se prolongent jusqu’en Tunisie. Il ne le sait pas encore, mais il vient d’amorcer une réflexion qui va changer sa vie. Dans ce paysage minéral, la présence de sel l’intrigue : plus il avance dans ses constatations, plus il fait le lien entre la dépression des chotts et le lac de Triton décrit par Herodote.
Les cartes anciennes, dont celles de Ptolémée, confortent son raisonnement autant que les écrits d’Ibn Chabbat, savant arabe du XIIIe siècle natif de Tozeur, au bord du Chott el-Jérid, en Tunisie. Des géographes, dont Conrad Malte-Brun, et des historiens ont aussi localisé la mythique Atlantide aux abords de l’Atlas et pensent qu’elle aurait été détruite par un tremblement de terre qui aurait asséché la « deuxième Méditerranée » qui la bordait au Sud.
Les cartes plus récentes et les relevés effectués par Roudaire montrent que la série de chotts situés entre l’Algérie et la Tunisie dessinent un lac intérieur. De là à imaginer qu’ils seraient la survivance du lac de Triton et qu’il suffirait de réaliser une jonction avec la mer du côté de Gabès, en Tunisie, pour créer une mer, il n’y a qu’un pas que le jeune officier franchit. À charge pour lui de développer ses recherches pour apporter les preuves de la faisabilité de ce projet.
Transformer le désert en enclave fertile
Si Suez relie deux mers l’une à l’autres, le projet Roudaire est encore plus ambitieux puisqu’il vise à créer – ou à ressusciter – une mer et transformer le désert en prairies verdoyantes. Une ambition à la hauteur d’un XIXe siècle curieux et avide de progrès. Franc-maçon et républicain, Roudaire fait la promotion de son projet à travers La Revue des Deux Mondes et entreprend de convaincre l’homme en vue du moment, Ferdinand de Lesseps, du bien fondé d’inonder « un bassin d’une surface égale à dix-sept fois environ celle du lac de Genève au moyen d’un canal débouchant dans le golfe de Gabès »… L’évaporation rendrait le climat humide et transformerait le désert en enclave fertile.
La perspective d’offrir à la France de nouvelles routes vers l’Afrique et l’Orient en modifiant la configuration de l’Algérie constitue aussi un argument utile à la réalisation d’une entreprise qui s’annonce colossale. Parmi les signes encourageants qui galvanisent Roudaire : l’intérêt des sociétés savantes et surtout celui de Ferdinand de Lesseps, diplomate et lobbyiste avant l’heure qui a conduit la réalisation du canal de Suez. Très vite, les deux hommes décident de travailler ensemble. Roudaire encadre la partie scientifique et technique, Lesseps use de son entregent auprès des pouvoirs publics et de l’Académie des sciences.
Les fonds, 10 000 francs, nécessaires à la réalisation des études préliminaires de reconnaissance et de nivellement sont octroyés par l’Assemblée nationale. Roudaire repart sur le terrain, enchaîne dès 1874 les missions et, à chaque fois, en 1876, 1878, 1883, il fait le même et terrible constat que confirme la Société de géographie : le niveau du Chott el-Jérid est de 15 à 33 mètres plus élevé que celui de la mer, et la partie située entre le golfe de Gabès et le Chott, qui aurait dû être l’embouchure de cette mer, culmine à 48 mètres au-dessus de la Méditerranée, rendant impossible le remplissage par la mer d’un bassin de 400 km de long et de 60 km de large et une superficie utile de 13 000 km².
Roudaire examine toutes les possibilités, envisageant même de surmonter l’écueil du dénivelé en modifiant l’emplacement du canal, qui serait plus long (240 km, contre les 18 prévus ) et plus coûteux. Il compte sur la puissance des masses d’eau qui vont s’engouffrer dans le canal pour contribuer à son creusement.
Le gouvernement français est tenté par le projet, dont le coût est initialement estimé à 73 millions de francs, mais seulement dans la mesure où il est réalisable. Une étude parallèle ordonnée par l’Académie des sciences confirme les écueils relevés par Roudaire, devenu professeur à Saint-Cyr, mais qui persiste à promouvoir son projet en vantant ses effets sur le climat, l’agriculture et le commerce dans le Sud tuniso-algérien. Las, le gouvernement français ne suit plus : en juillet 1882, il se désengage après la publication des conclusions d’une commission supérieure de la mer intérieure qui confirment que l’entreprise est hautement hasardeuse.
Nouvelle mission, nouvel obstacle
Le saint simonien Ferdinand de Lesseps, lui, ne veut pourtant pas renoncer à ce qu’il estime toujours être une bonne affaire, même avec des coûts plus élevés. Il se dit prêt à faire exécuter en cinq ans les travaux, jusqu’à hauteur de 200 millions de francs, et à en assumer les risques. En contrepartie, il réclame à l’État une partie des terres devenues fertiles. Ses détracteurs assurent qu’une forte évaporation impacterait le remplissage des chotts et s’interrogent sur le sort des autochtones, mais Lesseps persiste.
En 1881, la Tunisie devient un protectorat français. Lesseps, qui connaît le pays, s’assure du soutien des hommes en place, notamment celui de Joseph Allegro, un général tunisien d’origine génoise influent auprès des autorités coloniales et du bey. En 1882, il crée avec Roudaire la Société d’études de la mer intérieure africaine qui finance, en 1883, une nouvelle mission à partir de Tozeur. À l’issue de celle-ci, il s’avère que la nature calcaire du terrain par endroits est un obstacle rédhibitoire.
Cette fois, le projet s’effondre, d’autant que Lesseps, de son côté, est pris dans le scandale financier du canal de Panama. Mis en cause par la communauté scientifique et sa hiérarchie, Roudaire est épuisé. Il ne supporte pas les persiflages et meurt d’une maladie du foie en 1885. La Société d’études de la mer intérieure africaine survit quelques temps, gérant une exploitation agricole à Gabès. Dernier vestige de l’utopie du géographe-aventurier, elle disparaît à son tour en 1892.
Retrouvez les épisodes suivants de notre série :
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus
- [Enquête] Les disparus d’Ibrahim Traoré
- Après l’Algérie, le Maroc : nouvelles révélations sur les liens de Jordan Bardella avec le Maghreb
- En RDC, Jacquemain Shabani tutoie de nouveau les sommets
- RDC : Fulgence Muteba, un dur à cuire à la tête de l’épiscopat
- « Scandale KDS » en Côte d’Ivoire : le PDG placé sous mandat de dépôt pour escroquerie




