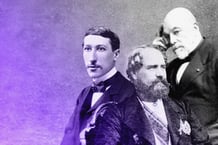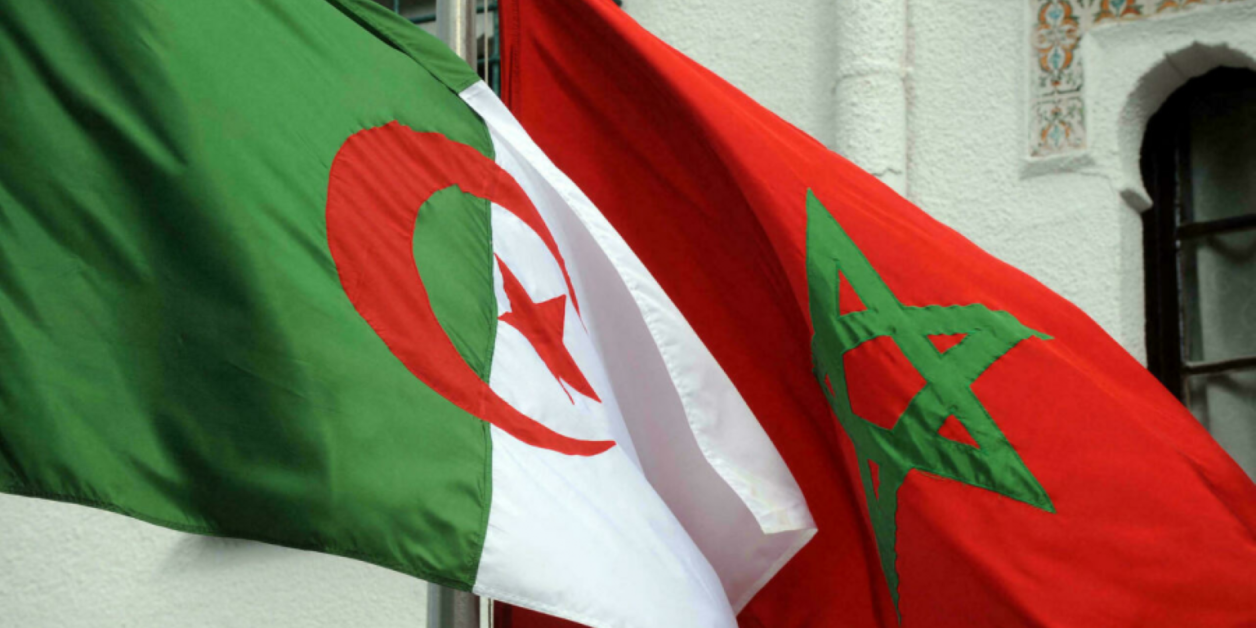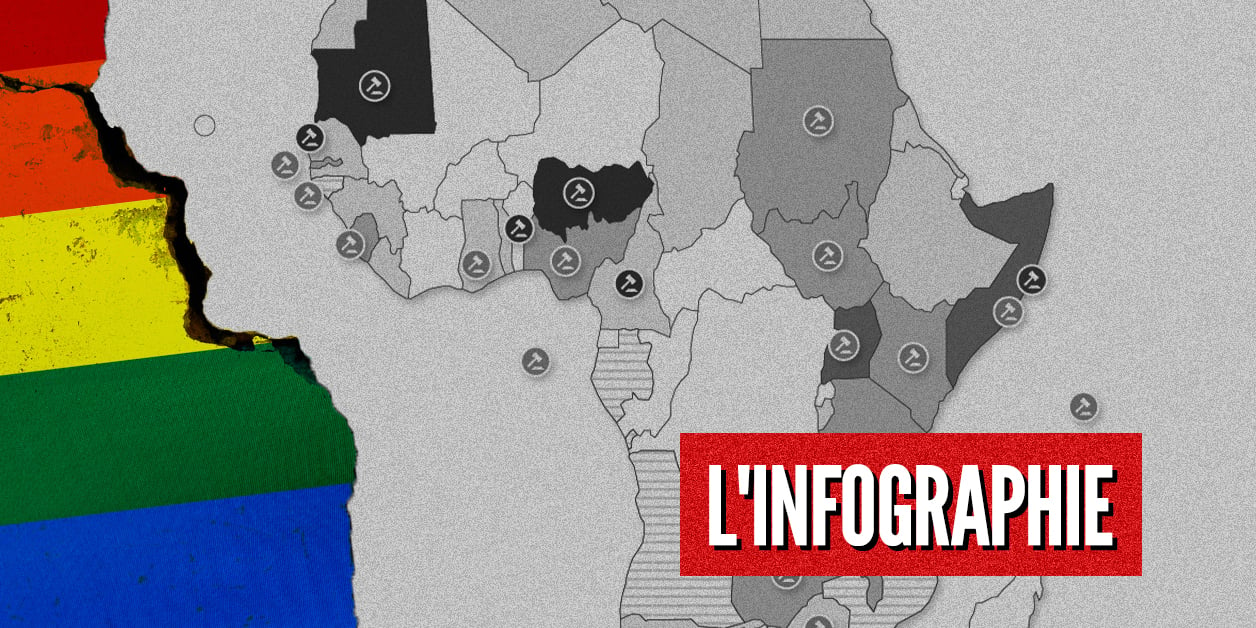Comment Isabelle Eberhardt a écrit sa légende en Algérie
Entre envie d’aventure et quête de spiritualité, l’écrivaine-voyageuse suisse d’origine russe a toujours suivi son instinct, lequel l’a conduite vers le Sud et les dunes d’El-Oued, dans le Souf, en Algérie.
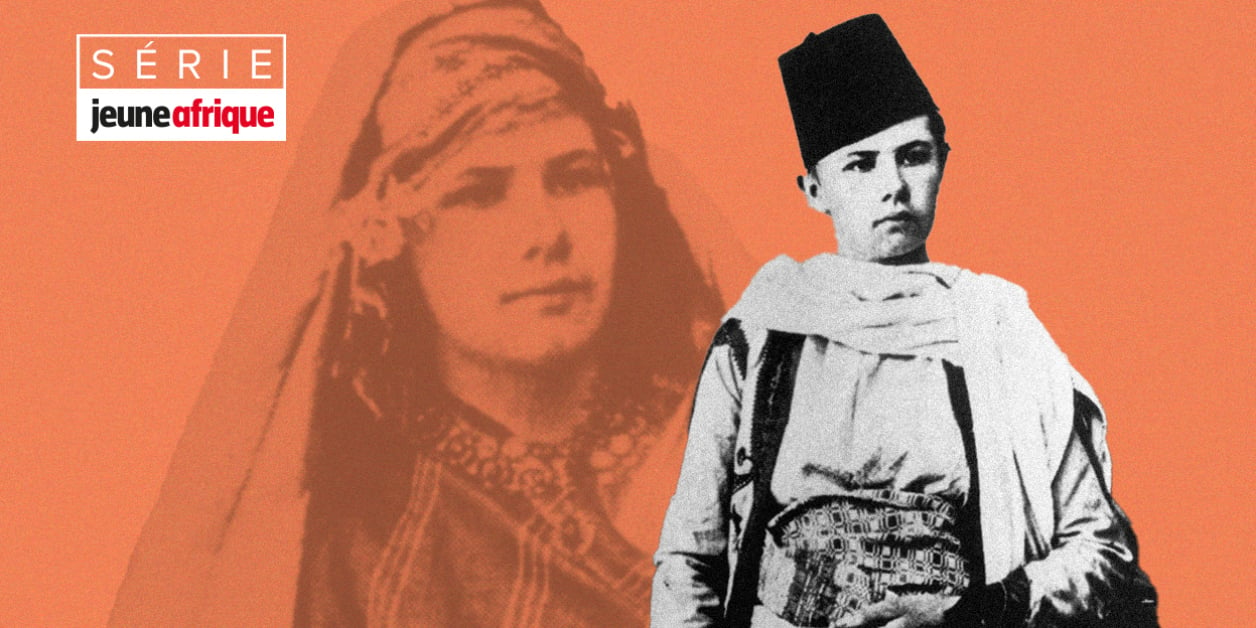
Isabelle Eberhardt. © Montage JA; PVDE/Bridgeman Images
LE RÊVE MAGHRÉBIN DES AVENTURIERS EUROPÉENS (3/4) – Sur les escaliers de la colline d’El-Gorjani, Isabelle Eberhardt contemple Tunis qui frémit sous les premières lueurs d’un lascif matin d’automne 1899. Un enchantement qui semble émaner du divin, avec l’appel à la prière qui s’élève, démultiplié par les voix qui s’élancent de chaque minaret.
À cet instant, Isabelle éprouve un sentiment de plénitude qui fait écho à la quête qu’elle entreprend, poursuivant comme elle l’écrit son « rêve de vieil Orient resplendissant et morne, dans les antiques quartiers blancs pleins d’ombre et de silence de Tunis ».
Descendante de Russes blancs élevée à Genève par un précepteur, Alexandre Trofinovski, dont on dit qu’il fut à la fois son père et sa mère, Isabelle est une jeune fille singulière aux prises avec une identité confuse. À 20 ans à peine, elle manie avec maestria le russe, le français, l’arabe, l’allemand, le grec et le latin, a fini l’écriture d’un roman, Rakhil, évolue dans un milieu éclectique où se mêlent anarchistes et Jeunes-Turcs, monte à cheval comme un fringant cavalier et s’habille volontiers en garçon depuis son plus jeune âge.
Ayant quitté l’Europe – où tout, dit-elle, ses goûts, ses relations, ses conquêtes, la ramène vers son « désir d’Orient » – pour s’installer en 1987 à Bône (l’actuelle Annaba, en Algérie, où est enterrée sa mère), elle y éprouve le sentiment exaltant mais fugace d’être chez elle. S’installant dans le quartier arabe pour fuir les regards inquisiteurs des Européens, nouant des liens avec un interprète, elle reste toutefois une étrangère sur le sol d’une colonie française, et sa conversion à l’islam en 1898 sous le nom de « Si Mahmoud el-Mouskouby » (le Moscovite), ainsi que son penchant pour le soufisme la marginaliseront davantage.
Son guide en spiritualité est alors un vieux lettré égyptien, le cheikh Abou Naddara, qui réside à Paris, rue Richet. C’est là que le fils aîné du gouverneur de Mahdia, Ali Abdelwaheb, de passage chez le vieux cheikh, dont il est l’ami, remarque sur un meuble la photographie d’un jeune matelot… qui est en fait la toute jeune Isabelle. Séduit, Ali entame avec elle un échange épistolaire.
Brève halte à Tunis
Lorsque Alexandre Trofinovski décède à son tour, Isabelle, qui continue à faire des allers-retours entre l’Algérie et la France, estime que plus rien ne la retient en Europe. Elle part alors pour Tunis, mais, taraudée par le désir du voyage, n’y fait qu’une brève halte. Très vite, elle repart pour le Sahel tunisien, région côtière du Centre-Est, qu’elle sillonne avec une caravane chargée de prélever l’impôt, El-Mejba. Revêtue de son habituel accoutrement masculin, elle leurre Si Larbi, le jeune représentant des autorités à Monastir, qui ne se doute pas un instant qu’elle est une femme.
La voyageuse, elle, observe, fascinée par les bourgades blanches, dont elle égrène les noms et qu’elle compare à « des perles dans un écrin sombre d’oliviers ». Elle s’extasie – « La beauté de ce pays est unique sur l’âpre et splendide terre d’Afrique » –, mais reconnaît aussi avoir le cœur serré face à des populations faméliques, dénuées de tout. Indignée par l’injustice des pratique coloniales révoltantes et barbares, marquée par cette traversée d’un Sahel bien loin du Tunis urbain et policé, elle se sent investie d’un devoir : celui de témoigner de cette situation. Ce sera l’un de ses premiers sujets de publication.
Au fil de cette errance qu’elle poursuit, la jeune femme s’ancre un peu plus dans cette région et dans la religion qui est la sienne. Dans ce microcosme, Isabelle a le sentiment d’avoir trouvé des racines qui lui donnent une autre identité, moins douloureuse, loin des questionnements sur ses origines réelles ou sur ses pères, puisqu’elle s’en remet désormais à l’unique, le seul : Allah.
Ces doutes et ces réflexions, elle les partage avec un Ali Abdelwaheb de plus en plus fasciné par cette jeune femme libre aux arguments subtils qui se drape dans un burnous clair, arbore avec culot un fez et chausse des bottes de cuir rouge pour l’accompagner au concert, sur la promenade de la marine, au centre du quartier colonial en cours de construction. Ali, auquel elle donne maintenant du « mon chéri », sera son confident, son cicérone, son ami et certainement son amant.
Brouillant les pistes, celle qui a toujours eu pour habitude d’utiliser maints prénoms – dont Nadia – pour répondre à ses correspondants, est maintenant le taleb Mahmoud. C’est-à-dire « l’étudiant » ou plus exactement, selon la terminologie arabe, « le quémandeur de savoir ». Née en Suisse de parents russes, la voici donc turque. Le personnage de Mahmoud – auquel elle adjoint le patronyme Saadi, le chanceux – vient enrichir la légende d’Isabelle et contribuer à sa postérité. Mais rien ne semble jamais la satisfaire tout à fait, pas même le kif qu’elle consomme sur la banquette de l’entrée de l’un des plus anciens cafés de la médina de Tunis, El-Mrabet, dans la moiteur sereine du souk El-Trok ou avec la bande d’amis qu’Ali lui avait présentée.
Ali et Slimane
La plupart du temps, Isabelle vit seule dans une « très vaste et très ancienne maison turque, dans l’un des coins les plus retirés de Bab Menara, presque au sommet de la colline », que son ami interprète – qui deviendra chef du protocole et accédera à de hautes fonctions – a mise à sa disposition, rue Boukhris. Elle ne se lasse pas d’écrire, se donnant de la peine comme s’il s’agissait de s’acquitter d’une « dette de cœur » envers Ali, qui l’a exhortée à reprendre son travail.
Ce seront les « heures de Tunis », introspectives et contemplatives, dont elle confie que « les souvenirs la hantent » et qui, plus tard, contribueront à lui conférer les galons d’écrivaine-voyageuse. Dans l’immédiat, l’écriture lui permet de survivre. Elle publie des articles, notamment dans les Nouvelles d’Alger de son ami et éditeur, Victor Barrucand.
Elle finit par se brouiller avec Ali, « son frère », l’un des trois hommes qu’elle a le plus aimés. Une stupide histoire d’argent et une indiscrétion d’un ami qui ébruite l’incident blessent Ali, avec lequel la relation est hautement narcissique. Il l’accable de reproches, elle ne le reconnaît plus. La bouderie se mue en lourd silence, puis en invitation à partir. Isabelle ne reverra plus Ali qu’elle ne reconnaît plus quand il l’invite à quitter Tunis. Privée de son ami, Isabelle, qui n’est pas femme à rendre des comptes, n’écoute plus que l’appel du Sud. Elle compte y approfondir sa démarche soufie avec la confrérie de la Qadiriyya, qu’elle a rejointe.
Dans le Sud, elle trouve d’abord la violence, échappe à une tentative d’assassinat, tout en poursuivant la quête l’exaltation qu’elle éprouve à travers le soufisme. Une exaltation qu’elle trouve dans un fiévreux amour pour Slimane, rencontré dans le Souf algérien début 1900 et qui devient son mari. Il la présentera comme « Isabelle Eberhardt, mon épouse. Mahmoud Saadi, mon compagnon… »
Une formule à l’image du parcours profondément atypique de la jeune femme, si déconcertant que beaucoup la suspecteront d’être une espionne au services du général Lyautey, qui éprouvait pour elle une belle amitié. De tout cela, Isabelle n’a cure : pour elle l’essentiel reste d’aller au bout d’elle-même et de « mourir avant de mourir, selon le vieil adage des soufis ». Elle meurt le 21 octobre 1904 dans les inondations qui frappent l’Ouest algérien, à l’âge de 27 ans.
Retrouvez le dernier épisode de notre série :
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus – Culture
- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...
- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...
- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?
- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés
- Bantous : la quête des origines