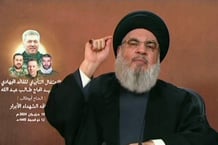France-Afrique : l’intégralité du discours de François Mitterrand à La Baule
Le 20 juin 1990, le président français invitait l’Afrique à se démocratiser tout en affirmant que Paris n’avait pas vocation à « intervenir dans les affaires intérieures » des États du continent. Un discours qui résonne encore aujourd’hui.

Ouverture du 16e Sommet franco-africain, à La Baule, le 19 juin 1990. © CHESNOT/SIPA
Prononcé il y a un peu plus de trois décennies, le discours de La Baule reste dans les mémoires comme l’une des plus célèbres prises de parole d’un président français. Écrit dans un contexte très particulier – celui de l’effondrement de l’Union soviétique et de la fin de la guerre froide, alors qu’un vent de liberté soufflait sur l’Europe de l’Est –, il appelait à une démocratisation de l’Afrique, jugée inéluctable.
En ce 20 juin 1990, François Mitterrand laissait ainsi clairement entendre qu’au moment d’accorder des aides budgétaires à ses partenaires africains, Paris tiendrait compte, et bien davantage que par le passé, de l’état de la démocratie et du respect des droits de l’homme. Nombreux ont alors été ceux qui ont salué cette prise de position, qui a marqué un tournant dans la relation entre la France et ses anciennes colonies du continent.
La révolution n’aura en réalité pas lieu. Le discours de La Baule s’est en effet fracassé sur la dure réalité : celle de la politique française au Rwanda, frappé, quatre ans plus tard, par le génocide des Tutsi. Certains observateurs ont également souligné qu’un tel discours, tenu depuis le sol français et à l’occasion d’un sommet France-Afrique, n’était qu’une parole néocoloniale et paternaliste de plus. Le débat se poursuit.
Ce 20 juin 2024, à l’occasion du trente-quatrième anniversaire de l’allocution de François Mitterrand, Jeune Afrique vous propose de relire ce célèbre discours dans son intégralité.
Majesté,
Laissez-moi vous remercier pour la présidence que vous avez exercée depuis la conférence de Casablanca.
Je salue ceux qui rejoignent notre conférence pour la première fois. Je ne ferai pas de distinction. Mais je noterai, cependant, la présence de la Namibie, ce qui marque bien qu’il y a aussi des évolutions heureuses : l’accession à l’indépendance est l’une des formes essentielles de la liberté, et la Namibie en est le meilleur symbole.
Depuis la conférence de Casablanca, beaucoup de choses se sont passées. Vous avez parlé, Majesté, des maux dont souffre l’Afrique. Chacun le sait, ils sont nombreux. Cela repose sur des réalités difficiles et parfois angoissantes. La crise est d’abord économique. Elle s’aggrave sans cesse. Vous savez que la production par tête diminue chaque année, que la part de l’Afrique dans la concurrence mondiale recule, que les investissements se font plus rares, qu’ici ou là la famine resurgit, que la dette s’alourdit.
Bref, on est installés cruellement dans le cycle infernal « dette-sous développement », tandis que la population croît. Comment voulez-vous que les systèmes scolaires et sociaux puissent résister à la poussée de la démographie dans de telles circonstances ?
Vous avez eu raison de le dire tout à l’heure, se tourner vers l’Afrique et porter accusation révèle une grande injustice de ceux qui, avec complaisance, parfois même avec satisfaction, dénoncent les mœurs, les traditions, le système politique, la manière de vivre de l’Afrique. Si j’ai moi-même des observations critiques à faire, comme je le ferai à l’égard de mon pays, je refuse de m’engager dans ce procès.
Je préfère examiner avec vous la manière dont on pourrait préparer l’avenir immédiat. Car je suis de ceux qui pensent que, si responsabilités il y a, on ne peut ignorer celles qui incombent à la société internationale, et particulièrement aux pays les plus riches. Sont-ils sans pitié ou simplement indifférents ?
Nous attendons encore, en dépit des efforts répétés de la France et de quelques autres, le plan mondial qui permettrait d’examiner, sur une distance de cinq à dix ans, la manière de parer aux maux successifs qui viennent, pour une large part, des pays riches pour atteindre les pays en voie de développement, pauvres ou moins pauvres, mais en tout cas très endettés.
Que penser de la fermeture des marchés en Occident ? Il y a là une spirale qui empêche les pays africains de retrouver un équilibre hors duquel tout leur est interdit.
Examinons par exemple, l’effondrement des cours des matières premières. Je me répète d’une année sur l’autre. Mais comment ne pas se répéter ? Nous sommes contraints de tenir le même discours, puisque les faits n’ont pas changé. Si on se met à la place des responsables africains, on se dit : « Comment faire ? » On établit un budget, on tente de planifier sur deux ans, trois ans, cinq ans et en l’espace d’une semaine, quand ce n’est pas au cours d’une simple séance d’un après-midi dans une ville lointaine, tout s’effondre.
L’Afrique, oubliée de la croissance
Les monnaies de base ont connu des évolutions qui ont constamment dérangé vos prévisions. Vos productions ont connu des évolutions saisissantes vers la baisse. On s’interroge : comment le financier le plus avisé du monde, pourtant si prêt à se faire donneur de leçons, agirait-il ? Quelle solution trouverait-il pour compenser les pertes, arrêter le désastre ? On s’étonne, après cela, de la fuite des investissements étrangers… Et que penser de la fermeture des marchés en Occident ? Faut-il s’étendre sur le débat au sein du GATT à propos du maintien du protectionnisme, sur les produits agricoles, les produits textiles et combien d’autres ? Il y a là une spirale qui empêche les pays africains de retrouver un équilibre hors duquel tout leur est interdit : le développement, bien entendu, la prospérité, l’équilibre politique, le temps et l’espace nécessaires pour procéder aux réformes politiques attendues.
Il est vrai que l’Afrique est l’oubliée de la croissance, la laissée-pour-compte du progrès ; je dis ceci d’une façon rapide, car, dans tel ou tel pays, on observe des efforts récompensés par le succès.
Nous n’allons pas nous attarder pour tenter de désigner le coupable. Les responsabilités sont partagées. Dans mon esprit, elles commencent par l’insouciance ou l’irresponsabilité des pays, qui par solidarité internationale et dans leur intérêt, devraient comprendre qu’une large et audacieuse politique Nord-Sud s’impose. Elles continuent par les défaillances de nombreux pays africains, qui n’ont pas pu ou qui n’ont pas su prendre à temps les mesures qui pouvaient leur convenir. Prenons-en acte. Posons-nous ces questions.
La première question est sous-jacente dans les campagnes qui se développent, un peu partout dans le monde, contre la politique de la France : faut-il que la France renonce, afin de ne plus être exposée aux critiques nombreuses qui la frappent ? Faut-il qu’elle rapatrie chez elle tous les moyens et qu’elle les consacre à ses ressortissants nationaux ? Faut-il qu’elle se replie, faut-il qu’elle cherche en elle-même ses seules ambitions ?
Je vous dirai ce que je pense de la politique de la France et de la manière dont elle est conduite. Mais je répondrai par avance à cette question : la France est décidée à poursuivre sa politique, et donc à aider l’Afrique, quoi qu’il en soit et quoi qu’on en dise. Elle ne se retirera pas de l’œuvre engagée depuis si longtemps et qui, sous des formes différentes au travers de l’Histoire, l’a associée à un grand nombre de ces pays.
La France restera fidèle à son histoire dont, d’une certaine manière vous êtes, et à son avenir, dont vous serez, je l’espère aussi.
France et aide au développement
Permettez-moi quelques rappels simples. La France est toujours le premier des pays industriels avancés dans l’aide aux pays en voie de développement. Le premier, nettement, devant tous les autres. C’est vrai que des pays comme le Canada ou l’Allemagne font un effort tout à fait estimable. Mais c’est vrai que d’autres grandes puissances restent à quelque distance, et même parfois à une longue distance.
Notre aide à l’Afrique, en 1990, est supérieure à celle de 1989, qui, elle-même, était en accroissement par rapport aux années précédentes. La quatrième Convention de Lomé, à laquelle nous avons pris une part si évidente, a permis d’augmenter de 45% les engagements financiers de la Communauté. Dans toutes les enceintes internationales, j’ai plaidé pour le développement, que je considère comme un élément indissociable des progrès de la démocratie.
Nous sommes allés partout – le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Économie et des Finances, le ministre de la Coopération, le ministre de la Francophonie notamment – pour plaider le dossier de l’Afrique.
Et nous devons répéter, encore une fois, les mêmes choses simples. À Toronto, nous avons mis au net un plan qui permettrait de réduire ou d’abolir la dette des pays les plus pauvres et nous avons préconisé trois façons de faire en annonçant aussitôt celle que nous avions choisie. À Dakar, peu de temps après, nous avons annulé nos créances publiques à l’égard de trente-cinq pays d’Afrique. Cet exemple a été suivi par quelques-uns.
Il convient de ne plus faire que des dons à 100% aux pays les moins avancés.
À la tribune des Nations unies, j’ai demandé qu’un plan fût élaboré et décidé en faveur des pays dits intermédiaires, ceux qui sont peut-être moins pauvres mais si endettés que le bénéfice de leur travail est absorbé par le service de la dette. À Toronto, à Dakar, à New York j’avais déjà indiqué que la France ne s’en tiendrait pas là.
Je pense que, dès maintenant, il convient de ne plus faire que des dons à 100% aux pays les moins avancés. Une conférence de ces pays se tiendra à Paris cet automne, j’aurai l’occasion d’y revenir. Je pense qu’il convient de limiter à 5%, ce qui revient à une réduction de 50%, les taux d’intérêt de tous les prêts publics aux pays dits intermédiaires de l’Afrique subsaharienne. C’est une décision unilatérale de la France. Elle n’a été négociée ni avec vous ni avec nos partenaires de ce fameux club des pays les plus riches qui se réunira dans quelques semaines à Houston.
Mais j’ai l’intention, à Houston précisément, de demander à nos partenaires, aux six autres pays industrialisés, d’aller plus loin. J’ai l’intention de leur demander d’abord s’il leur est possible de reprendre à leur compte des dispositions du type de celles que je viens d’énoncer ; ensuite, d’allonger de toute façon les délais de remboursement des pays les plus endettés par des moyens divers qu’il conviendra de choisir.
Et j’en reviens à ce projet dix fois traité et dont il faudra bien comprendre qu’il est nécessaire, celui d’un fonds spécial mondial. J’avais proposé qu’il fût financé par des nouveaux droits de tirages spéciaux. Je pense que les pays peuvent renoncer à certains de leurs droits pour alimenter une sorte de fonds mondial de garantie, qui servirait à amorcer la pompe, pour que, désormais, un nouveau cours des choses préside à la marche des affaires internationales.
Mais rien ne se fait au hasard. Peut-être, à certaines époques, l’argent se répandait avec prodigalité, sans contrôle. Moi, je n’ai pas connu ce temps-là. Je veux dire que je n’étais pas responsable au temps où ces pratiques ont pu exister. Vous savez bien, Madame et Messieurs, comment les choses se passent, comment les décisions sont prises. Il peut même arriver que des difficultés naissent à ce propos entre nous. Pas exactement entre vous et moi, mais entre nos hauts fonctionnaires, lorsqu’ils discutent âprement de la valeur de tel projet, de son financement, de ses modalités.
Il vous arrive même parfois de reprocher à la France, par ses exigences et par sa rigueur, d’exprimer je ne sais quel relent de l’époque coloniale, bien que nous ne prétendions pas, et vous le savez bien, dicter la politique que vous avez à faire.
Les crédits du Fonds d’aide et de coopération, qui sont placés sous la tutelle du ministre de la Coopération et qui servent à développer des projets, font l’objet d’une instruction interministérielle, avec un luxe de précautions de toutes sortes. Les crédits sont alloués au fur et à mesure des réalisations. On constate, sur place, ce qui se fait, en collaboration avec les responsables de chacun de vos pays.
Il en est de même pour les crédits, prêts et dons gérés par la Caisse centrale de coopération économique. Ce sont des institutions sévères ou des organismes parfois rébarbatifs qui accumulent les étages administratifs, mais qui sont quand même bien nécessaires. Ils permettent, en tout cas, d’avoir la conscience tranquille. Pour vous comme pour nous, cette aide est menée avec la rigueur nécessaire, pour qu’elle soit utile à vos peuples.
L’indifférence des pays riches
À tout cela, Madame et Messieurs, vos États participent et contribuent. Ils font entendre leur voix, ils font connaître, aussi, leurs objections, et ils acceptent parfaitement tout ce qui leur permettra de mener leur action sous le contrôle de chefs d’État, dont je peux dire que j’ai souvent constaté le scrupule sur la manière dont ils devaient gérer les crédits qui doivent servir au développement de leur peuple.
Si l’on doit constater un certain nombre de défaillances à travers le temps, je ne vois pas, ayant fait un examen approfondi de cette situation, ce qui pourrait être vraiment remarqué au cours de ces dernières années.
Pour la balance des paiements, il arrive qu’une contribution soit consentie par la France aux États lorsqu’ils ont constaté que leur programmation se heurte à des décisions souvent spéculatives, qui ruinent, en l’espace de quelques heures, la patience et la prévision de plusieurs années. Là encore, c’est notre ministère des Finances qui intervient. Il a des instructions financières pour chaque pays. Le ministère des Affaires étrangères et celui de la Coopération y prennent part : dans un système aussi précis, par où serait passée cette « évaporation », dont on parle sans arrêt dans un procès de type cartiériste, comme une sorte d’invitation en sourdine à voir la France arrêter, cesser de pratiquer la politique qui nous rassemble aujourd’hui et qui fait de nous des pays amis et solidaires – nous qui représentons ensemble, sur la scène internationale, un front de quelque trente-cinq pays.
Mais, sur ces trente-cinq pays, presque tous sont sous-développés. Peut-on dire que c’est de leur faute, et oublierait-on cette indifférence des peuples riches, ou plutôt de leurs dirigeants, cet oubli de leur responsabilité et de leur intérêt, car c’est du développement des termes de l’échange qu’eux mêmes tireront les moyens de leur prospérité ?
Je n’ignore pas les interrogations que suscitent, chez vous, les événements qui ont bouleversé l’Est de l’Europe. Vous craignez que bien des capitaux ne se détournent de l’Afrique. C’est une inquiétude que l’on peut comprendre, car les moyens des pays qui sont vos amis ne sont pas illimités. Eh bien, il dépend de nous qu’il n’en soit pas ainsi. La France fait son devoir. C’est vrai que si l’on ne rétablit pas un climat de confiance dans la marche en avant des pays de l’Afrique, il est difficile d’espérer la venue d’investissements étrangers, privés. On peut prendre des mesures de toutes sortes, notamment fiscales, mais ne s’agit-il pas aussi d’un problème politique ?
Je crois que l’on peut considérer que la zone franc est un facteur de stabilité pour l’Afrique noire.
Si l’on veut redonner confiance dans les chances de l’Afrique, ce sera par une stabilité retrouvée, avec des administrations en bon état de marche, avec une gestion scrupuleuse et un certain nombre de dispositifs, soit anciens, soit nouveaux, qu’il conviendra de déterminer au cours des heures de travail que nous aurons cet après-midi et demain.
Prenons un cas : celui de la zone franc. Je crois que l’on peut considérer que cette zone franc est un facteur de stabilité pour l’Afrique noire. Je crois que les pays qui y participent y sont très attachés. Eh bien, la France aussi.
Périodiquement, l’idée d’une dévaluation du franc CFA est relancée par de grandes institutions internationales. On dit que vous y êtes hostiles, moi aussi. Cela ne règlerait aucune de vos difficultés. Je crains que cela ne puisse aboutir qu’à alourdir les charges de vos dettes et à renchérir vos importations.
Certains d’entre vous se posent la question de savoir si l’Union économique et monétaire européenne ne modifierait pas la relations du franc CFA avec les autres monnaies de l’Europe. Je vous dis, dès maintenant, que ce qui vaut pour le franc CFA par rapport au franc vaudra demain par rapport à la monnaie européenne si celle-ci, comme nous l’espérons, voit le jour. Je puis m’en porter garant.
Ainsi disposerez-vous d’une vaste zone, qui vous apportera certaines formes de sécurité dans le trouble général qui s’empare de l’Afrique. Vous savez que l’Europe dispose d’un marché commun et qu’elle est à la recherche d’une monnaie unique. Or la zone franc a une monnaie, mais elle n’a pas de marché commun. Il y a, pour l’instant, d’un côté un marché commun sans monnaie, et, de l’autre, une monnaie sans marché commun. Il y a là peut-être une situation dont la contradiction pourrait toucher à l’absurde. Ne devriez-vous pas, Madame et Messieurs, rechercher l’unification de vos marchés et l’harmonisation de règles administratives, juridiques, fiscales et douanières dans des ensembles suffisamment vastes ?
Il serait peut-être trop ambitieux de considérer l’ensemble de l’Afrique noire. La réalité historique et géographique devrait aboutir à plusieurs ensembles, et ce serait déjà un grand progrès. En tout cas, nous sommes prêts à vous aider pour mettre en œuvre ce mouvement que je crois indispensable si l’on veut pouvoir disposer de l’instrument politique, géographique, économique qui nous permettra d’avancer dans la lutte contre la crise.
Mais je tiens à dire ceci : de même qu’il existe un cercle vicieux entre la dette et le sous-développement, il existe un autre cercle vicieux entre la crise économique et la crise politique. L’une nourrit l’autre. Voilà pourquoi il convient d’examiner en commun de quelle façon on pourrait procéder pour que, sur le plan politique, un certain nombre d’institutions et de façons d’être permettent de restaurer la confiance – parfois la confiance entre un peuple et ses dirigeants, le plus souvent entre un État et les autres États, en tout cas la confiance entre l’Afrique et les pays développés.
Afrique et démocratie
Je reprends à mon compte l’observation, à la fois ironique et sévère, de Sa Majesté le roi du Maroc lorsqu’il évoquait la manière dont la démocratie s’était installée en France. Cela n’a pas été sans mal, ni sans accidents répétés. Élargissant le propos, je reprendrai les termes de l’un des chefs d’État avec qui nous dînions hier soir : l’Europe dont nous sommes, nous Français, avait à la fois le nazisme, le fascisme, le franquisme, le salazarisme et le stalinisme. Excusez du peu ! Étaient-ce les modèles à partir desquels vous aviez à bâtir vos États, vous qui n’avez disposé, dans la meilleure hypothèse, que d’un quart de siècle, et, pour certains, beaucoup moins ? Il nous a fallu deux siècles pour tenter de mettre de l’ordre, d’abord dans notre pensée, et ensuite dans les faits, avec des rechutes successives – et nous vous ferions la leçon ?
Il nous faut parler de démocratie. C’est un principe universel, qui vient d’apparaître aux peuples de l’Europe centrale et orientale comme une évidence absolue, au point qu’en l’espace de quelques semaines les régimes considérés comme les plus forts ont été bouleversés. Le peuple était dans les rues, sur les places, et le pouvoir ancien, sentant sa fragilité, cessait toute résistance comme s’il était déjà, et depuis longtemps, vidé de substance et qu’il le savait.
Et cette révolution des peuples, la plus importante que l’on eût connue depuis la révolution française de 1789, va continuer. Je le disais récemment à propos de l’Union soviétique : cette révolution est partie de là, et elle reviendra là. Celui qui la dirige le sait bien, qui conduit avec courage et intelligence une réforme qui, déjà, voit se dresser devant elle toutes les formes d’opposition, celles qui s’y refusent, attachées au système ancien, et celles qui veulent aller plus vite. Si bien que l’Histoire reste encore en jeu.
Il faut bien se dire que ce souffle fera le tour de la planète. Désormais, on le sait bien : que survienne une glaciation ou un réchauffement sur l’un des deux pôles, et voilà que le globe tout entier en ressent les effets.
Cette réflexion ne doit pas rester climatique, elle s’applique à la société des hommes ! Enfin on respire, enfin on espère, parce que la démocratie est un principe universel. Mais il ne faut pas oublier les différences de structures, de civilisations, de traditions, de mœurs. Il est impossible de proposer un système tout fait. La France n’a pas à dicter je ne sais quelle loi constitutionnelle qui s’imposerait de facto à l’ensemble des peuples qui ont leur propre conscience et leur propre histoire, et qui doivent savoir comment se diriger vers le principe universel qu’est la démocratie.
Et il n’y a pas trente-six chemins vers la démocratie. Comme le rappelait M. le président du Sénégal, il faut un État, il faut le développement et il faut l’apprentissage des libertés… Comment voulez-vous engendrer la démocratie, un principe de représentation nationale avec la participation de nombreux partis, organiser le choc des idées, les moyens de la presse tandis que les deux tiers d’un peuple vivraient dans la misère ?
Pour nous, cette forme subtile de colonialisme qui consisterait à faire la leçon en permanence aux États africains, c’est une forme de colonialisme aussi perverse que toute autre.
Je le répète, la France n’entend pas intervenir dans les affaires intérieures des États africains amis. Elle dit son mot, elle entend poursuivre son œuvre d’aide, d’amitié et de solidarité. Elle n’entend pas soumettre à la question, elle n’entend pas abandonner quelque pays d’Afrique que ce soit. Ce plus de liberté, ce ne sont pas simplement les États qui peuvent le faire, ce sont les citoyens : il faut donc prendre leur avis ; et ce ne sont pas simplement les puissances publiques qui peuvent agir, ce sont aussi les organisations non gouvernementales, qui, souvent, connaissent mieux le terrain, qui en épousent les difficultés, qui savent comment panser les plaies.
Nous ne voulons pas intervenir dans les affaires intérieures. Pour nous, cette forme subtile de colonialisme qui consisterait à faire la leçon en permanence aux États africains et à ceux qui les dirigent, c’est une forme de colonialisme aussi perverse que toute autre. Ce serait considérer qu’il y a des peuples supérieurs, qui disposent de la vérité, et d’autres qui n’en seraient pas capables, alors que je connais les efforts de tant de dirigeants qui aiment leur peuple et qui entendent le servir, même si ce n’est pas de la même façon que sur les rives de la Seine ou de la Tamise. Voilà pourquoi il faut procéder à une étude méthodique de tout ce qui touche à la vie économique.
Il faut mettre en place des dispositifs douaniers qui empêcheront des évasions de capitaux, qui viennent souvent justifier les critiques entendues. De ce point de vue encore, la France, si vous le souhaitez, est prête à vous apporter l’aide humaine et technique, à former des fonctionnaires, à se trouver auprès d’eux.
Frontières héritées de la colonisation
J’ai vu naître la plupart de vos États, j’ai connu vos luttes pour en finir avec l’état colonial. Ces luttes vous opposaient souvent à la France, et seule la sagesse des dirigeants français et africains a évité, en fin de compte, le drame d’une guerre coloniale en Afrique noire. Il fallait bâtir un État, une souveraineté, avec des frontières garanties internationalement, telles que les avaient dessinées les compas et les règles des pays coloniaux dans les salons dorés des chancelleries occidentales, déchirant les ethnies sans tenir compte de la nature du terrain. Et voilà que ces États nouveaux doivent gérer les anciennes contradictions héritées de l’Histoire, doivent bâtir une administration centrale, nommer des fonctionnaires après les avoir formés, gérer des finances publiques, entrer dans le grand circuit international, souvent sans avoir reçu des anciens pays coloniaux la formation nécessaire.
Et on aurait à raisonner avec ces États comme on le ferait à l’égard des nations organisées depuis mille ans, comme c’est le cas de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Espagne ou du Portugal ! Les mœurs, les traditions aussi respectables que les vôtres, l’histoire et la nature de ces peuples, leur propre culture, leur propre façon de penser, tout cela pourrait se réduire à une équation décidée dans une capitale du Nord ?
Vraiment, je fais appel à votre raison et je pense que nous nous connaissons assez pour savoir que rien ne sera fait entre nous en dehors du respect et de la considération que nous nous devons. S’il y a contestation dans tel État particulier, eh bien ! que les dirigeants de ces pays en débattent avec leurs citoyens. Lorsque je dis « démocratie », lorsque je trace un chemin, lorsque je dis que c’est la seule façon de parvenir à un état d’équilibre au moment où apparaît la nécessité d’une plus grande liberté, j’ai naturellement un schéma tout prêt : système représentatif, élections libres, multipartisme, liberté de la presse, indépendance de la magistrature, refus de la censure : voilà le schéma dont nous disposons.
Je vous parle comme un citoyen du monde à d’autres citoyens du monde : c’est le chemin de la liberté sur lequel vous avancerez en même temps que vous avancerez sur le chemin du développement.
Nous en avons discuté plusieurs fois, et hier soir encore en particulier. Je sais combien certains défendent scrupuleusement leur peuple et cherchent le progrès, y compris dans les institutions. Plusieurs d’entre vous disaient : « Transposer d’un seul coup le parti unique et décider arbitrairement le multipartisme, certains de nos peuples s’y refuseront ou bien en connaîtront tout aussitôt les effets délétères ». D’autres disaient : « Nous l’avons déjà fait, et nous en connaissons les inconvénients ». Mais les inconvénients sont quand même moins importants que les avantages de se sentir dans une société civiquement organisée. D’autres disaient : « Nous avons commencé, le système n’est pas encore au point, mais nous allons dans ce sens ».
Je vous écoutais. Et, si je me sentais plus facilement d’accord avec ceux d’entre vous qui définissaient un statut politique proche de celui auquel je suis habitué, je comprenais bien les raisons de ceux qui estimaient que leurs pays ou que leurs peuples n’étaient pas prêts. Alors, qui tranchera ? Je crois qu’on pourra trancher en disant que, de toute façon, c’est la direction qu’il faut prendre.
Pays du Sud, pays du Nord
Certains ont pris des bottes de sept lieues, soit dans la paix civique soit dans le désordre, mais ils ont fait vite. D’autres marcheront pas à pas. Puis-je me permettre de vous dire que c’est la direction qu’il faut suivre ? Je vous parle comme un citoyen du monde à d’autres citoyens du monde : c’est le chemin de la liberté sur lequel vous avancerez en même temps que vous avancerez sur le chemin du développement. On pourrait, d’ailleurs, inverser la formule : c’est en prenant la route du développement que vous serez engagés sur la route de la démocratie.
À vous peuples libres, à vous États souverains que je respecte, de choisir votre voie, d’en déterminer les étapes et l’allure. La France continuera d’être votre amie, et, si vous le souhaitez, votre soutien, sur le plan international comme sur le plan intérieur.
Vous lui apportez beaucoup. Quand je constate, par exemple, que le flux de capitaux qui va du Sud pauvre vers le Nord riche est plus important que le flux de capitaux qui va du Nord riche au Sud pauvre, je dis qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Le colonialisme n’est pas mort. Ce n’est plus le colonialisme des États, c’est le colonialisme des affaires et des circuits parallèles.
Chaque fois qu’une menace extérieure poindra, qui pourrait attenter à votre indépendance, la France sera présente à vos côtés.
Nous parlons entre États souverains, égaux en dignité, même si nous ne le sommes pas toujours en moyens. Il existe entre nous des conventions de toutes sortes. Il existe des conventions de caractère militaire. Je répète le principe qui s’impose à la politique française : chaque fois qu’une menace extérieure poindra, qui pourrait attenter à votre indépendance, la France sera présente à vos côtés. Elle l’a déjà démontré plusieurs fois et parfois dans des circonstances très difficiles. Mais notre rôle à nous, pays étranger, fût-il ami, n’est pas d’intervenir dans des conflits intérieurs. Dans ce cas-là, la France, en accord avec les dirigeants, veillera à protéger ses concitoyens, ses ressortissants ; mais elle n’entend pas arbitrer les conflits.
C’est ce que je fais dans le cadre de ma responsabilité depuis neuf ans. De la même manière, j’interdirai toujours une pratique qui a existé parfois dans le passé et qui consistait, pour la France, à tenter d’organiser des changements politiques intérieurs par le complot ou la conjuration. Vous le savez bien, depuis neuf ans, cela ne s’est pas produit et cela ne se produira pas.
Je respecte trop vos peuples et je respecte trop les personnes dès lors qu’elles se comportent conformément à ce que l’on peut attendre de chefs d’État soucieux du bonheur de leur peuple et soucieux de rester fidèles au comportement de tout citoyen digne de ce nom.
Que ce soit sur le plan économique, technique ou militaire – ce cas est quand même minoritaire –, j’ai défini les voies choisies par mon pays : économiquement et techniquement, nous resterons à vos côtés, dans un cadre de gestion contrôlée honnêtement et mutuellement, par des contrats eux-mêmes passés au crible des spécialistes, comme cela se fait déjà depuis des années et des années.
S’il faut améliorer les moyens d’empêcher des évasions de capitaux illicites, il reste à mettre en place, dans un certain nombre de cas, les systèmes correspondants.
Je conclurai, Madame et Messieurs, en disant que la France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté. Il faut, pour cela, que l’on vous fasse confiance. Il faut avoir confiance dans le temps. Pour investir, il faut du temps. Il faut du temps pour accroître la productivité, pour améliorer la qualité, pour installer des industries de transformation qui vous permettront de ne plus assister, impuissants, à l’évasion, parfois au vol, de vos matières premières sans que vous ayez la possibilité de tirer profit de la valeur ajoutée qui est ajoutée ailleurs que chez vous.
Zones franches en Afrique
Il faut des codes, des règles claires et stables pour faciliter les investissements étrangers. Pourquoi pas des zones franches, par exemple ? Certains d’entre vous l’on fait.
Voilà pourquoi je vous parlais avec insistance d’une taille minimum à acquérir entre vous pour regrouper et harmoniser les marchés. Nous l’avons fait nous-mêmes avec la Communauté européenne. Nous nous sommes dotés de structures contraignantes, nous avons accepté certains renoncements à notre souveraineté, dont nous étions, croyez-moi, aussi orgueilleux que vous.
Il faut avoir confiance dans la liberté. Elle sera, croyez-moi, votre meilleure amie.
Je le répète : confiance dans la liberté. La démocratie, nous l’avons vécue, c’est une belle aventure, mais elle est longue, difficile, hérissée de périls et de contradictions. Moi, j’ai confiance dans votre sol et dans les vertus de vos peuples. Voilà pourquoi je ne crois pas l’Afrique perdue. Et j’espère que l’on m’entendra à Dublin et à Houston. La voix de la France clamera une fois de plus que là est le salut de l’espèce humaine sur la Terre, et que si l’on abandonne en chemin tel ou tel peuple, c’est une amputation pour le monde entier. Souvenez-vous de ce titre de l’ouvrage d’Hemingway Pour qui sonne le glas : on croit qu’il sonne pour l’autre, il sonne toujours pour soi.
Un peuple d’Afrique laissé en perdition sur le bord du chemin de l’Histoire, c’est l’humanité tout entière pour qui le glas viendrait à sonner. Eh bien nous, Français, nous le comprenons. Nous croyons dans les vertus de votre sol et de vos peuples nourris de ce sol. Nous croyons dans la nécessité de compter sur le temps. Il faut avoir confiance dans votre capacité de bâtir un espace conforme à vos intérêts, et nous vous y aiderons. Il faut avoir, Madame et Messieurs, confiance dans la liberté. Il ne faut pas la considérer comme un ennemi caché, prêt à abattre ceux qui l’auront choisie. Elle sera, croyez-moi, votre meilleure amie.
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus – Politique
- Sexe, pouvoir et vidéos : de quoi l’affaire Baltasar est-elle le nom ?
- Législatives au Sénégal : Pastef donné vainqueur
- Au Bénin, arrestation de l’ancien directeur de la police
- L’Algérie doit-elle avoir peur de Marco Rubio, le nouveau secrétaire d’État améric...
- Mali : les soutiens de la junte ripostent après les propos incendiaires de Choguel...