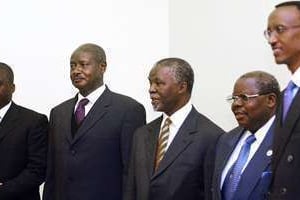Yoweri Museveni l’inusable
Au pouvoir depuis vingt-quatre ans, le chef de l’État ougandais briguera un nouveau mandat lors de la présidentielle de février 2011. Les attentats qui ont ensanglanté son pays il y a un mois l’ont replacé au centre du jeu diplomatique dans la région. Et bien au-delà. Portrait d’un habile va-t-en-guerre.

En terme de longévité, il est le doyen des dirigeants d’Afrique de L’Est. © Reuters

Yoweri Museveni l’inusable
Jamais sans mon rwitabagomi ! Ce petit nom d’amour qui signifie « celui qui flingue les plus têtus », le président ougandais, Yoweri Museveni, l’a donné à l’AK-47 qu’il conserve toujours à portée de main et que l’un de ses aides de camp huile méthodiquement chaque jour. Arrivé au pouvoir en 1986 par les armes et après des années de maquis, l’homme qui a mis fin aux cauchemars successifs que furent les dictatures d’Idi Amin Dada (1971-1979) et de Milton Obote (1966-1971 puis 1980-1985) ne s’est pas vraiment policé avec les quelque vingt-quatre années passées au pouvoir. Apparaissant de temps à autre en treillis et armé, il demeure prompt à la métaphore guerrière. Ainsi, confronté aux attentats commis par les Chabaab somaliens à Kampala le 11 juillet (76 morts), il a entonné un refrain antiterroriste que ne renierait pas l’ancien président et actuel Premier ministre russe, Vladimir Poutine.
« Qui sont ces gens qui osent s’attaquer au drapeau de l’Union africaine ? Quels intérêts servent-ils, ceux-là qui ne nous respectent pas ? Ces terroristes seront défaits. Comme vous le savez, j’ai une longue expérience de la lutte et de la guerre. Mais je n’ai que mépris pour ceux qui utilisent la violence de manière non discriminatoire. Boutons-les hors d’Afrique ! Qu’ils retournent en Asie et au Moyen-Orient ! C’est de là qu’ils viennent, si je comprends bien. Je n’accepterai pas cette nouvelle forme de colonialisme qu’est le terrorisme », déclarait-il avec emphase, le 25 juillet, lors de l’ouverture du 15e sommet de l’Union africaine (UA). Et, joignant le geste à la parole, il promettait dans la foulée, malgré les menaces, d’accroître la présence ougandaise au sein de la mission de l’UA en Somalie (Amisom), qui tente tant bien que mal de protéger le gouvernement fédéral de transition contre les insurgés islamistes.
Pourtant, au regard de ce qu’était l’Ouganda en 1986 – tant sur le plan politique qu’économique – et de ce qu’il est devenu sous le règne de Museveni, nul n’oserait réduire celui qui fut parfois surnommé « le Bismarck des Grands Lacs » à un va-t-en-guerre compulsif dont la longévité ne tiendrait qu’aux équipées martiales, que ce soit contre Joseph Kony, le chef sanguinaire de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), ou loin en avant au cœur du riche territoire congolais. Mais certains esprits chagrins auront raison de dire que les tristes événements de juillet représentent une aubaine pour l’animal politique qui s’apprête, une fois de plus, à se porter candidat à sa propre succession lors de la présidentielle prévue en février 2011. Face à une opposition désarmée, il pourra de nouveau se présenter comme l’unique garant de la sécurité nationale et de la paix. Une recette qui lui a jusque-là plutôt réussi. Jackson, serveur dans un restaurant de Jinja : « Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, il sera réélu de toute façon. »
Précoce en politique
Homme à poigne, Yoweri Kaguta Museveni a une longue expérience de la lutte armée. Il vient au monde pendant la Seconde Guerre mondiale, autour du 14 août 1944, à Ntungamo, dans le sud-ouest de l’Ouganda. Le pays est alors sous protectorat britannique, et ses parents – Amos Kaguta et Esteri Kokundeka – le nomment Museveni en l’honneur des « Abaseveni », ces Ougandais qui ont combattu avec le septième bataillon des King’s African Rifles, les fusiliers royaux. Successivement élève de la Kyamate Elementary School, de la Mbarara High School et de la Ntare School, le jeune homme s’intéresse tôt à la politique. Notamment parce que, dans sa région d’origine – le royaume Ankole, où l’élevage revêt une importance primordiale –, le colonisateur et ses alliés locaux forcent les éleveurs à quitter leurs terres traditionnelles. Mais c’est durant les trois années qu’il passe dans l’atmosphère progressiste, voire radicale, de l’université de Dar es-Salaam (1967-1970), en Tanzanie, que le jeune homme décide de s’engager. À l’époque, politique rime avec lutte armée. Il forme le University Students’ African Revolutionary Front (Usarf) et conduit une délégation étudiante au Mozambique, où il reçoit une formation à la guérilla auprès du Front de libération du Mozambique (Frelimo). À en croire sa biographie officielle, disponible sur le site de la présidence ougandaise, « ses nombreuses lectures couvrent Fanon, Lénine, Marx, Rodney, Mao ainsi que des penseurs occidentaux libéraux comme Galbraith ».
L’exil
De retour au pays en 1970, Museveni rejoint les services secrets du président ougandais Milton Obote. Pour peu de temps : en janvier 1971, le colosse kakwa Idi Amin Dada s’empare du pouvoir. « M7 » – autre surnom – rejoint de nouveau la Tanzanie voisine et, avec d’autres exilés, crée le Front for National Salvation (Fronasa), après qu’une première attaque lancée contre les forces d’Idi Amin Dada, en septembre 1972, eut tourné au cauchemar. Pendant cinq ans, un accord de paix signé entre l’Ouganda et la Tanzanie le contraint au statu quo. Mais quand Idi Amin Dada décide d’envahir la Tanzanie, les exilés ougandais, soutenus par l’armée de Julius Nyerere, s’unissent pour renverser l’ubuesque major général, en avril 1979.
Dans l’Ouganda instable de l’après-Idi Amin Dada, Museveni occupe les postes de ministre de la Défense, de ministre chargé de la Coopération régionale et de vice-président du conseil militaire. Lors des élections de 1980, son parti, l’Uganda Patriotic Movement, est laminé par l’Uganda People’s Congress de l’ancien président Milton Obote. Considérant que les élections étaient truquées, Museveni reprend le maquis, où il forme la National Resistance Army (NRA) « avec seulement 26 fusils », et son aile politique, le National Resistance Movement (NRM). Le combat contre le régime d’Obote – qui, en matière d’atrocités, n’a rien à envier à celui d’Idi Amin Dada – dure cinq ans et s’achève par le coup d’État du lieutenant général Tito Okello, le 26 juillet 1985. Okello est renversé six mois plus tard par la NRA, le 26 janvier 1986. Trois jours après, Yoweri Museveni devient président.
Converti au libéralisme, le nouvel homme fort du pays suit à la lettre les recommandations du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Apparaissant comme un « bon élève » dans la région troublée des Grands Lacs, il séduit les Occidentaux – en particulier les États-Unis –, qui ne ménagent pas leur soutien. L’aide coule à flots, la croissance suit. Stabilité économique, paix : les Ougandais sont reconnaissants, qui n’oublient pas les horreurs des années précédentes. Sa popularité, réelle, lui permet de maintenir longtemps en place le système politique du « Mouvement », une forme de parti unique censé mettre fin aux dérives ethniques du passé et qui permet, surtout, de réduire à néant l’opposition.
Au nord, les populations paient le prix fort
Même dans ce contexte, Museveni ne lâche pas son rwitabagomi. En région acholie, dans le nord du pays, la rébellion mystique d’Alice Lakwena – le Mouvement du Saint-Esprit, qui enfantera par la suite la LRA conduite par Joseph Kony – constitue une menace crédible contre le pouvoir central, qui réagit avec force. Au début des années 1990, le Soudan est considéré comme la principale menace à la stabilité ougandaise, puisqu’il finance la LRA. En réponse, Museveni s’engage auprès de l’Armée de libération des peuples du Soudan (SPLA) de son comparse John Garang, un temps fréquenté à l’université de Dar es-Salaam. Les populations du nord de l’Ouganda paient le prix fort.
En 1996, un an après la promulgation d’une nouvelle Constitution, Museveni est reconduit avec 75,5 % des votes face à Paul Ssemogerere et devient le premier président élu de l’histoire de l’Ouganda. Communicateur hors pair, orateur à l’humour ravageur, il maîtrise l’anglais, le luganda, le runyankole et le swahili, et sait utiliser avec habilité les comparaisons imagées et populaires – voire populistes. Cinq ans plus tard, il remporte l’élection suivante contre son ancien médecin, le docteur Kizza Besigye, avec 69 % des voix. La Cour suprême ougandaise a beau statuer que l’élection n’était ni équitable ni loyale, elle se refuse à l’annuler. Museveni peut entamer ce qui doit être – s’il respecte la Constitution – son dernier mandat.
Se considérant comme seul apte à assurer la stabilité de son pays, il prend le taureau par les cornes en 2005 et met fin à la limitation des mandats quelques mois avant le scrutin. Pour faire bonne mesure vis-à-vis des Ougandais et des bailleurs de fonds, il promet un référendum « pour ou contre le multipartisme ». Le 23 février 2006, il est réélu dans un fauteuil avec 59,3 % des voix (contre 37,4 % pour son rival), après une élection entachée de fraudes et marquée par une véritable cabale destinée à affaiblir Kizza Besigye. La Cour suprême reconnaît une nouvelle fois les faits, mais valide tout de même l’élection. C’est reparti pour cinq ans. Et, dès juillet 2008, Museveni laisse entendre qu’il sera candidat à sa propre succession en… 2011.
L’allié des occidentaux
Pas étonnant, dans ces circonstances, que certains craignent une dérive monarchique. Et ce d’autant que le président continue de placer ses proches au plus haut sommet de l’État. En août 2008, son fils Muhoozi Kainerugaba a été promu lieutenant-colonel chargé des Forces spéciales. Fin février dernier, ses prérogatives ont été accrues et il est désormais chargé de l’unité d’élite de la garde présidentielle. Rien d’extraordinaire… sauf que le frère de Museveni, Salim Saleh, est son conseiller pour les questions de défense, que son beau-frère, Sam Kutesa, est ministre des Affaires étrangères, que sa fille, Natasha Karugire, est sa secrétaire personnelle, et que sa femme, Janet, est chargée de la région du Karamoja.
Dans le Boston Globe du 1er mai 2005, un ancien ambassadeur américain en Ouganda ne mâchait pas ses mots à propos de Museveni. « Sa soif de pouvoir et sa quête controversée d’un troisième mandat pourraient renvoyer l’Ouganda à son passé dictatorial », écrivait-il. Aujourd’hui, le secrétaire d’État adjoint pour les questions africaines, Johnnie Carson – puisque c’est de lui qu’il s’agit –, a revu son jugement : « Je ne pense pas que le président Museveni soit un dictateur. C’est un président élu de manière libre et juste. » À l’instar du Premier ministre éthiopien Mélès Zenawi, le président ougandais reste un allié incontournable des Occidentaux, notamment dans leur volonté de barrer la route au terrorisme. Même si son homophobie ultramédiatisée peut choquer, même si ses méthodes sont parfois musclées…
En décembre 2008, l’opération Lightning Thunder (« éclair de tonnerre »), menée par les armées ougandaise et congolaise, permettait de réduire la LRA de Kony à la portion congrue. Depuis, le chef rebelle, sous le coup d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), erre entre la RD Congo, le Soudan et la République centrafricaine, accompagné d’une poignée d’hommes. C’en est fini, ou presque, de l’ennemi public numéro un. À moins que les milices Chabaab ne reprennent ce rôle. En tout état de cause, Museveni ne donne pas l’impression de vouloir ranger son rwitabagomi…
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Yoweri Museveni l’inusable
Les plus lus – Politique
- Sextapes et argent public : les Obiang pris dans l’ouragan Bello
- À Casablanca, la Joutia de Derb Ghallef en voie de réhabilitation
- Présidentielle en Côte d’Ivoire : la stratégie anti-fake news d’Alassane Ouattara
- En RDC, la nouvelle vie à la ferme de Fortunat Biselele
- Gabon : 10 choses à savoir sur la première dame, Zita Oligui Nguema