« Le Pays des autres », de Leïla Slimani : l’identité en dehors des cases
L’auteure franco-marocaine aborde la question des origines et des identités mêlées, qu’elle avait jusqu’alors choisi d’éviter. Et elle tombe juste : sans perdre de son acuité, elle épouse le point de vue de chacun avec la finesse qu’on lui connaît. Sa plume n’en prend que plus d’épaisseur.

Leïla Slimani lors d’une séance de dédicace après la conférence « La littérature, une révolte au féminin ? » à l’Opéra Garnier, à Paris, le 24 septembre 2017 © ZIHNIOGLU KAMIL/SIPA
Et si Leïla Slimani avait raison contre elle-même ? Lors d’une interview à France Inter en 2016, l’écrivaine franco-marocaine avait affirmé : « Je suis très lucide sur ce qu’on pouvait attendre de moi en littérature, que je raconte l’identité, les femmes, la douleur, l’honneur, les Arabes, le sang. » Le Pays des autres évoque précisément ces questions. Elle prend la tangente par rapport à ses deux précédents romans, Dans le jardin de l’ogre et Chanson douce, prix Goncourt 2016. Un virage à 90 degrés heureux : la saga familiale qui se déploie de 1944 à 1955 est passionnante.
Jamais tout à fait chez eux
Le pays des autres, c’est l’identité tiraillée de Mathilde et Amine Belhaj, mariés après la seconde guerre mondiale et venus s’installer à Meknès, au Maroc. Ni l’un ni l’autre ni leurs enfants ne seront jamais tout à fait chez eux nulle part. Amine est un « Mohamed » aux yeux des Français tandis que son frère lui reproche d’avoir fait la guerre pour la France, Mathilde est traitée en paria par les autres colons français et quand elle retourne dans son Alsace natale, elle est accueillie en étrangère.
Aïcha et Selim, leurs enfants, font figure d’anomalies. Slimani résume l’environnement où ils évoluent à travers le regard de la mère d’Amine : « Pour Mouilala, le monde était traversé par des frontières infranchissables. Entre les hommes et les femmes, entre les musulmans, les juifs et les chrétiens, et elle pensait que pour bien s’entendre il valait mieux ne pas trop souvent se rencontrer. La paix demeurait si chacun restait à sa place. »
Métissage
Bien s’informer, mieux décider
Abonnez-vous pour lire la suite et accéder à tous nos articles
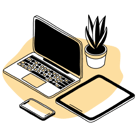
Les plus lus – Culture
- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...
- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés
- Trick Daddy, le rappeur qui ne veut pas être « afro-américain »
- Au Bénin, « l’opposant sans peur » à Patrice Talon emprisonné
- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?





