Breyten Breytenbach : « L’héritage de Mandela n’est pas honoré » en Afrique du Sud
Il écrit ses poèmes en afrikaans, rédige ses essais en anglais et s’exprime dans un français parfait. Auteur rare, peintre confirmé, cet opposant de longue date à l’apartheid garde un œil critique sur l’Afrique du Sud de Jacob Zuma.
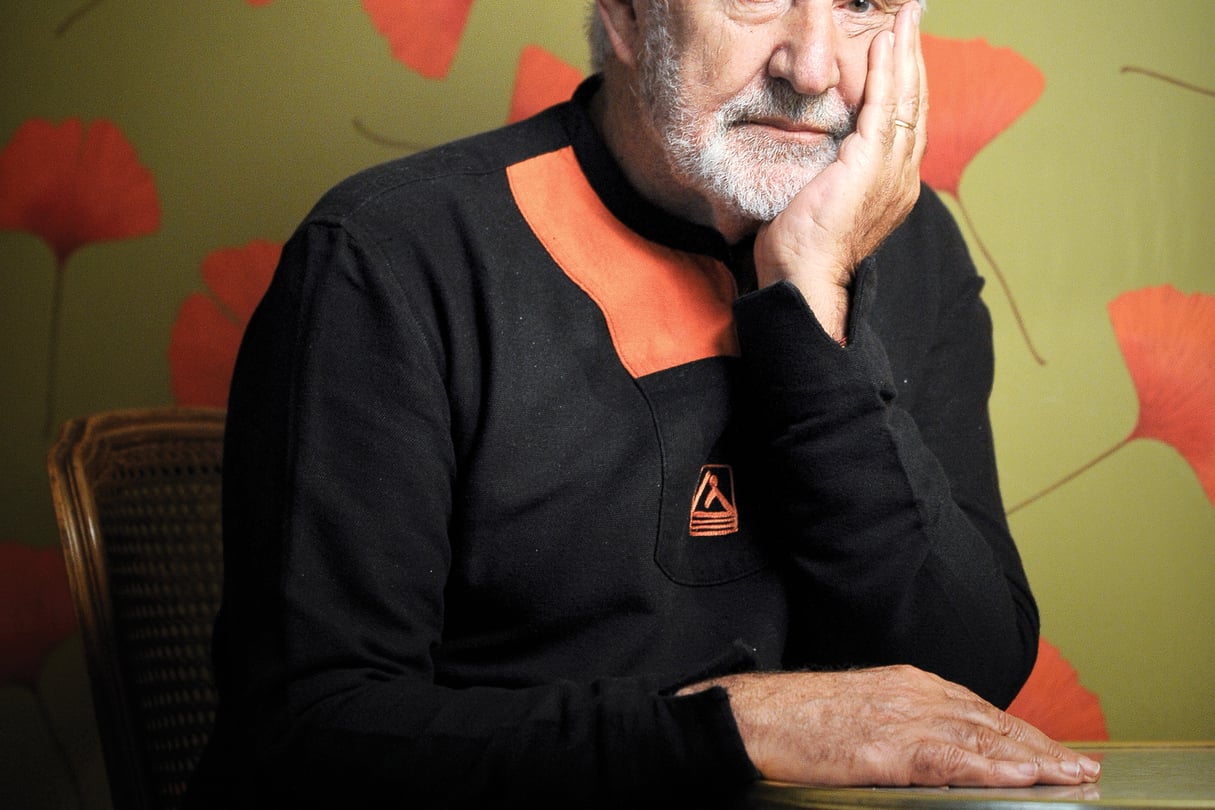
Breyten Breytenbach. © VINCENT FOURNIER/J.A.
Poète, peintre, écrivain, essayiste, le Sud-Africain de 75 ans publie un recueil de textes sous le titre La Femme dans le soleil. Entre 1975 et 1982, son engagement contre l’apartheid lui vaut un long séjour en prison. Depuis, son pays natal a bien changé, mais ce Français d’adoption qui partage son temps entre Paris, Gorée et Le Cap n’a rien perdu de sa faculté d’indignation. Rencontre à Paris.
Jeune Afrique : Vous écrivez vos poèmes en afrikaans. C’est votre langue de prédilection ?
Breyten Breytenbach : Quand il s’agit de poésie, oui. Ce que l’on véhicule à travers les poèmes est très intime, de l’ordre de l’exorcisme, de l’incantation. Certains attributs de la langue comme le rythme, les couleurs, la texture, permettent d’établir un lien direct avec ce que l’on est à un moment donné qui ne peut passer que par la langue maternelle. Durant les années d’éloignement, l’afrikaans a été mon seul lien avec l’Afrique du Sud, et c’est devenu une langue presque privée, adaptée à ma démarche. En outre, l’afrikaans se prête formidablement bien à la poésie, parce que c’est une langue créole, très adaptable, très souple, très inventive.
On a pourtant tendance à associer l’afrikaans à la population blanche d’Afrique du Sud…
Les gens au pouvoir ont pendant longtemps entretenu un mythe au sujet de cette langue, se l’accaparant comme un marqueur d’identité. Et ils ont désespérément essayé de faire croire que c’était une langue européenne, alors même qu’elle est majoritairement parlée par une population métisse. Le premier livre en afrikaans a été écrit en phonétique avec des caractères arabes et imprimé en Turquie, à l’usage des croyants fréquentant les mosquées du Cap. L’afrikaans, à ses origines, s’appelait « le néerlandais de la cuisine ». C’était la langue parlée par les travailleurs, les ouvriers agricoles, une langue construite sur la nécessité pour les différentes composantes de la population de communiquer entre elles. C’est la seule du continent, à ma connaissance, qui se dise elle-même « africaine ». Les premiers métis s’appellent les Afrikaners !
En revanche, vous écrivez vos essais en anglais…
J’ai enseigné à New York pendant douze ans, et pour ce qui est de l’ordre des idées et des concepts, j’utilise l’anglais… Quand j’ai écrit Le Cœur-Chien sur la région d’où je viens, nombre de personnes ont pensé que, même si c’était en anglais, on entendait l’afrikaans dans le rythme et la diction. J’essaie pourtant de me couler comme un caméléon dans la langue que j’utilise.
Vous parlez aussi français.
Pour tout ce qui est de la vie intellectuelle, j’ai été formé à Paris. Même quand je travaille en anglais, je le fais probablement du point de vue d’un Français et même d’un Parisien ! Les questions qui m’intéressent – conscience, identité, engagement – relèvent d’une formation à la française.
La question linguistique est importante en Afrique du Sud ?
Oui. Si l’on adopte une langue que l’on maîtrise mal et qu’on utilise essentiellement avec ses clichés et ses vides, les idées qu’on va essayer de véhiculer vont en pâtir. En Afrique du Sud, 40 % de la population urbanisée, c’est-à-dire arrachée de ses racines, utilise l’anglais comme pis-aller, comme langue refuge, alors qu’elle reste en cinquième position comme langue maternelle. Tout le monde s’en sert dans une sorte d’aspiration pour se hisser au niveau mondial, mais on la parle très mal. Vous n’avez qu’à l’écouter telle qu’elle est parlée au Parlement, c’est une abomination.
On est tellement sous pression quand on écrit à propos d’un pays compliqué et qu’on vit dans un monde très bavard.
Vous êtes aussi peintre. C’est une autre manière de dire ?
Chaque forme d’expression artistique a ses spécificités. On ne peut pas dire qu’on écrit comme on peint ou qu’on peint comme on écrit, mais on retrouve la même volonté d’appréhender le monde dans lequel on vit, de le modifier, de le transformer. Il y a beaucoup de correspondances entre l’écriture et la peinture : notions de texture, de rythme, de perspective, de narration, de couleur…
Vous êtes avant tout peintre ou poète ?
Je me vis d’abord comme peintre. Pendant longtemps j’ai vécu avec cette idée qu’on écrit ce qu’on ne peut pas dire et qu’on peint ce qu’on ne peut pas écrire. Je crois finalement que ce n’est pas tout à fait exact : les deux sont complémentaires. La notion même de métaphore est commune : prendre ce qui est pour en faire autre chose, avec tout ce que cela peut enclencher. Maintenant, on est beaucoup plus heureux comme peintre que comme écrivain.
Vraiment ?
La peinture est beaucoup plus physique, plus gestuelle. Elle permet de mieux respirer. On est tellement sous pression quand on écrit à propos d’un pays compliqué et qu’on vit dans un monde très bavard, où tout passe par la parole, où tout le monde essaie de couvrir ses lacunes et de remplir les vides par le bavardage. La peinture c’est différent : on ne peut pas se cacher.
Vous vivez toujours entre Paris, Gorée et Le Cap ?
Oui, Paris reste le point d’ancrage. J’y ai une maison d’édition, un certain nombre de copains, ma belle-famille… Cela reste néanmoins une ville froide et dure dont on s’échappe autant que possible. C’est à partir d’ici que je vais ailleurs. Même si j’ai beaucoup d’attaches instinctives au Cap, ne serait-ce que par la langue et peut-être par la passion avec laquelle on y subit les conditions d’évolution politique, ce n’est pas chez moi. Gorée, c’est le lieu d’un engagement concret à travers l’Institut Gorée – lequel remonte aux années 1980 et ne s’est jamais démenti depuis. C’est là qu’il y a un véritable frottement avec les problèmes du continent. Nous y abordons les questions d’intégration, de société civile, de citoyenneté, de nation, de langues, de frontières, de néocolonialisme… Mais aussi le problème du pillage orchestré par nos élites.
Vous y abordez des questions littéraires ou artistiques ?
On a un programme qui s’appelle Imaginer l’Afrique, qui vise à rassembler toutes les bonnes volontés pour faire vivre la diversité à travers la créativité, mais aussi tout ce que nous partageons : les espoirs, les valeurs, leur redéfinition, le panafricanisme, etc. L’imagination est fondamentale pour trouver ou retrouver des voies d’engagement profondes pour les sociétés qui nous concernent, dans cette recherche de ce que l’on pourrait appeler le modernisme africain ou la modernité africaine.
Vos écrits récents sur l’Afrique du Sud sont assez pessimistes…
De ce point de vue, je suis entièrement noir ! Pour l’instant, nous avons lamentablement échoué, vu d’où nous venons, vu les sacrifices concédés par ceux qui nous ont précédés, vu la générosité et la qualité même de la lutte. Le parti au pouvoir se dit majoritaire, mais draine seulement 30 % de la population et nie les révoltes généralisées. Pouvait-on prévoir que ça allait arriver ? Est-ce que le mouvement n’a pas été assez préparé à prendre les rênes de ce pays complexe, convoité par tellement de monde, exploité par tellement de forces, porteur d’une histoire sanglante qu’on ne peut pas défaire ? L’Afrique du Sud n’est pas l’Algérie, les Blanchâtres – puisqu’ils ne sont plus blancs depuis longtemps – ne sont pas des pieds-noirs, il n’y a pas de nation mère où ils pourraient se réfugier. Ce constat ne vaut pas seulement pour l’Afrique du Sud. Est-ce que l’Égypte a trouvé la solution pour intégrer et valoriser ses différentes composantes ? Est-ce que le Kenya va pouvoir faire l’économie de cette réflexion étant donné les tensions entre ses différents groupes ? En Libye, en Somalie, va-t-on recoller les morceaux ou laisser ces États en faillite parce que certains en profitent ? L’Afrique du Sud n’est pas la seule à affronter ce genre de difficultés, mais elle aurait pu être exemplaire étant donné la pensée qui a accompagné sa reconstruction.
Le seul facteur qui fédère l’ANC, c’est le partage du pouvoir, l’occupation de tous les postes du pouvoir.
Comment expliquez-vous une situation si difficile ?
Les affres par lesquelles nous passons actuellement en Afrique du Sud sont en partie dues au fait que la notion d’Afrique du Sud reste une notion en creux, qui n’est pour l’instant pas porteuse de valeurs positives. Nous sommes vaguement conscients de vivre à l’intérieur des mêmes frontières, de partager une histoire et un certain nombre d’idées communes après des années de mélanges, de confrontations, de guerres, de résistances, de libérations. Mais on a oublié que dès qu’on cesse de transformer ou de construire un pays il risque de se fragmenter à nouveau selon les composantes qui préexistaient. Les vieilles rancunes remontent à la surface, les causes d’insatisfaction sont nombreuses, la sud-africanité en souffre. L’héritage de Mandela, le sens même et la portée de sa vie ne sont pas honorés. Pas du tout.
Le bilan de Jacob Zuma n’est pas bon ?
On a comme chef d’État quelqu’un qui se réclame d’une certaine pureté, si tant est que cela existe, puisque c’est un traditionaliste zoulou, avec tout ce que cela comporte – ses femmes, ses enfants, son incapacité à faire la distinction entre richesse personnelle et pouvoir d’État. S’il a de bons côtés, comme un certain paternalisme, il ne comprend sincèrement pas pourquoi tout le monde n’est pas comme lui. Quand on pense que toute sa carrière est axée sur la volonté de ne pas aller en prison ! Ceux qu’il nomme auprès de lui pour le protéger lui sont redevables et se remplissent les poches… On donne à chacun la possibilité de bouffer le plus possible pendant qu’il est là et d’en faire profiter autour de lui afin d’établir une base clanique ou familiale. Le seul facteur qui fédère l’ANC, c’est le partage du pouvoir, l’occupation de tous les postes du pouvoir.
L’ANC est néanmoins de plus en plus fragmenté…
Avec la Numsa, l’effritement du Cosatu et la démission du secrétaire général Zwelinzima Vavi, il existe aujourd’hui une formation située idéologiquement à gauche de l’ANC. Il y a aussi un certain nombre de penseurs, de militants de la société civile qui commencent à se fédérer, mais vont-ils pouvoir se constituer en partis pour se présenter lors des prochaines élections ? C’est une possibilité. Pour beaucoup de ces militants qui sont sortis de la mouvance de l’ANC, c’est dur, c’est comme quitter la maison et se couper de sa famille. Mais c’est en train de se faire, et cela se fera, sur des bases idéologiques. L’ANC devra se défendre et se redéfinir, donnant peut-être naissance à un grand parti centriste, gestionnaire. Mais aujourd’hui, l’ANC est encore profondément stalinien, et le véritable lieu du pouvoir se trouve à Luthuli House, au sein du comité exécutif national. Ce n’est pas le peuple qui choisit le président, c’est l’ANC qui décide.
Le Black Economic Empowerment était-il un bon choix ?
Les secteurs privés sont des animaux de proie. La mondialisation est le petit nom pour dire « capitalisme d’exploitation international ». Moi, je n’ai pas de problème pour qu’on prenne ces moyens et qu’on les donne à d’autres, mais il faut savoir ce que d’autres vont en faire. Si c’est pour faire la même chose, est-ce la peine ? Dépenser des centaines de milliers d’euros pour s’acheter un buffle sur une vente publique comme le feraient de grands capitalistes blancs, ce n’est pas sauver une espèce animale, c’est un signe d’opulence extérieure !
Vous regrettez les choix qui ont été faits ?
Il ne s’agit pas de remettre en question la nécessité absolue de repartir autrement, mais a-t-on donné la priorité à l’éducation et à la formation ? A-t-on su inculquer les valeurs qui étaient nécessaires pour reconstruire la société ou est-on là pour s’enrichir soi-même ? Que reste-t-il de ces responsabilités civiques qui étaient portées par les mouvements d’indépendance et de libération ? On continue de se draper dans les mêmes habits, mais quel est le pays d’Afrique qui se préoccupe de ses citoyens échoués sur les côtes européennes ? Comment se fait-il qu’il n’y ait pas un seul pays qui dise : « Oh, ça suffit comme ça ! Ce sont les nôtres, putain ! » Qu’est-ce que ça veut dire, pour nous, ces gens qui finissent comme des loques ? Est-ce qu’on n’a pas honte ?
Vous avez la nationalité française et vous votez en France. Que vous inspire le climat politique français ?
Comme disait Shakespeare, appelez une rose par n’importe quel nom, elle aura toujours la même odeur. Le fascisme gentiment présenté par une dame blonde ou son vieux borgne de père, c’est toujours du fascisme. On peut le décanter dans toute sa complexité, mais le fait est que l’extrême droite est le premier parti de France.
Le racisme rampant qui revient en force vous effraie ?
Il y a une pression terrible de la part de nos penseurs publics et de nos médias pour diaboliser tout sentiment de mal-être dans un monde qui a changé très rapidement. Il me semble que la réponse n’est pas uniquement de dire : « Oh là là ! c’est vilain d’être raciste. » Il faut regarder plus loin. La France s’est construite par mélanges, créations, recréations, regroupements. Dans un monde violent, face à des gens puissants qui croient que la vérité est une et simple et qui s’attachent à détruire un certain nombre de valeurs, il y a un travail à faire qui passe par le questionnement, le doute, la créativité. Se forger comme citoyen ne peut passer ni par la discrimination ni par l’ignorance du passé. Mais imaginer autre chose est un travail très difficile.
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
