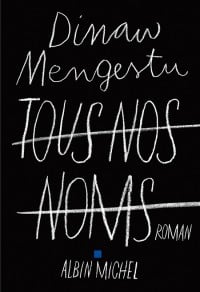« Tous nos noms » : rencontre avec l’écrivain américain d’origine éthiopienne, Dinaw Mengestu
New-Yorkais né à Addis-Abeba, Dinaw Mengestu n’est pas seulement éthiopien, noir ou américain. Une identité complexe qui l’a amené à l’écriture. À l’occasion de la sortie de son dernier roman, Jeune Afrique l’a rencontré.

Dinaw Mengestu. © Eli Meir Kaplan/AP/SIPA

L’Afrique au cœur de la rentrée littéraire
Branle-bas de combat chez les éditeurs et les libraires de France. La rentrée littéraire approche. Et les auteurs du continent sont au rendez-vous. À découvrir en avant-première dans J.A.
Le pas est rapide et décidé, l’allure un rien dégingandée, les cheveux impossibles à domestiquer. Détendu, l’écrivain américain d’origine éthiopienne Dinaw Mengestu, qui publie aujourd’hui son troisième roman, Tous nos noms, parle un français exotique et chantant : le débit est rapide, parfois même saccadé. Marié à une Française avec qui il a deux enfants, il a vécu pendant cinq ans à Paris et y revient régulièrement pour rendre visite à sa belle-famille.
La trajectoire qui l’a conduit du quartier de Mexico, à Addis-Abeba, jusqu’à New York, où il enseigne la littérature, est des plus classiques. La prise du pouvoir par le Derg, au début des années 1970, et la terreur rouge qui s’ensuivit poussèrent son père à quitter l’Éthiopie pour rejoindre le calme démocratique mais néanmoins discriminatoire des États-Unis. Engagée contre la révolution communiste portée par Mengistu Haile Mariam, la famille Mengestu en a payé le prix du sang. « Dinaw, c’est un nom qui n’existe pas en Éthiopie, dit-il. C’est mon père qui l’a construit pour moi – de manière que je puisse changer le cours de l’Histoire dans mon pays ! »
Ce n’est pas du racisme, mais les Africains-Américains issus de l’esclavage considèrent qu’ils ont fait tout le travail pour nous
S’il est bien né à Addis-Abeba, en 1978, son pays sera avant tout les États-Unis, où ses parents ont chacun trouvé un emploi : lui travaille pour Caterpillar, elle est secrétaire de direction. « On a perdu la langue, confie l’écrivain, mais gardé la culture, la religion, une certaine façon de parler avec les aînés. La guerre ayant coûté la vie à plusieurs membres de ma famille, on ne pouvait pas se permettre de retourner en Éthiopie. La contrainte économique jouait aussi, bien entendu. »
Pas du genre à se plaindre, Dinaw Mengestu n’évoque qu’à demi-mot les difficultés de l’adolescence : « J’étais presque le seul Éthiopien dans l’église que nous fréquentions, et, à l’époque, mon pays d’origine était associé à l’extrême pauvreté. Vers 12-13 ans, j’ai été confronté au racisme, je ne voulais pas être éthiopien, je disais « je suis américain ». »
La question, pourtant, se révèle bien plus complexe qu’une simple opposition entre noir et blanc. Le racisme, bien sûr, est assez aveugle aux différences entre Africains-Américains issus de l’esclavage ou de l’immigration. Mais dans la population noire, il en va autrement. « Pour moi, ce n’est pas du racisme, mais les Africains-Américains issus de l’esclavage considèrent qu’ils ont fait tout le travail pour nous. Ils pensent qu’on a de la chance d’arriver aujourd’hui aux États-Unis, et je comprends qu’ils nous regardent avec un peu de scepticisme. »
Une identité complexe matrice de l’écriture
La naissance à l’écriture du jeune Éthiopien est concomitante de cette prise de conscience d’une identité complexe qui ne peut se réduire aux clichés qu’on lui colle à la peau. « J’ai commencé à sentir que je n’étais pas seulement éthiopien, pas seulement noir ou pas seulement américain, explique-t-il. J’ai beaucoup lu pour essayer de comprendre l’histoire de ma famille, et l’écriture a été une manière de me construire et de trouver ma place. »
Ce n’est pas un hasard s’il attendra d’avoir publié Les Belles Choses que porte le ciel pour retrouver son pays natal. « Je suis de près l’évolution politique de l’Éthiopie, mais ce n’est qu’après la publication de mon premier livre que j’ai pu y retourner. J’y avais passé beaucoup de temps en imagination, j’étais prêt. Dans notre petite maison familiale, vingt-cinq années plus tard, j’ai tout retrouvé, y compris mes petits jouets dans ma chambre. Plein de choses sont restées telles quelles. »
Je préfère passer plus de temps à essayer de comprendre les sentiments humains plutôt que la chose politique
Si les questions identitaires constituent le fondement des romans de Mengestu, il serait hasardeux de les y réduire. Styliste fin qui se méfie des effets de manches et des coups d’éclat, l’auteur de Ce qu’on peut lire dans l’air privilégie la légèreté et l’allusion. Même quand il s’agit d’aborder les sujets les plus graves, comme la guerre ou le racisme. « J’ai choisi la fiction parce que je veux jouer avec mon imagination, soutient-il, mais aussi parce que je préfère passer plus de temps à essayer de comprendre les sentiments humains plutôt que la chose politique. »
L’un, pourtant, n’empêche pas l’autre, et Tous nos noms est à la fois diablement humain et férocement politique. En partie inspiré par un séjour de l’auteur en Ouganda, ce roman d’amour – parce que c’en est un – et d’amitié croise les destins de deux hommes et d’une femme dans deux espaces géographiques distincts que l’Atlantique sépare.
Deux points de vue : celui d’Isaac, immigré africain installé à Kampala, et celui de Helen, jeune Américaine altruiste de Laurel (Maryland). À la fin de chaque chapitre, le lecteur traverse le passage du milieu dans un sens ou dans un autre pour s’en aller rejoindre l’un des deux protagonistes.
Du côté de Kampala domine l’histoire d’amitié, complexe et ambiguë, entre Isaac et Isaac, jeunes idéalistes pétris de rêves révolutionnaires hantant, malgré leur condition de non-étudiants, le campus de l’université de Makerere. Du côté de Washington domine l’histoire d’amour, impensable et dissimulée, entre l’un des deux Isaac et Helen. Sans avoir besoin d’appuyer le trait, Dinaw Mengestu parvient ainsi à raconter le destin contrarié des indépendances et à disséquer la difficulté des amours métisses dans une Amérique où la discrimination n’a pas disparu.
C’est pour cette raison que les gens deviennent révolutionnaires – pour avoir des gens qui font reluire leurs parquets”»
Attentif à ses personnages, l’écrivain n’a pas besoin de plus de quelques lignes pour incarner une idée avec force. Ainsi, de la révolution, il écrit : « Un jour, je lui ai demandé : “Quel genre de révolutionnaire peut bien avoir une bonne pour astiquer son parquet ?” Il s’est moqué de moi. Il a répondu: “C’est pour cette raison que les gens deviennent révolutionnaires – pour avoir des gens qui font reluire leurs parquets.” »
Que dire de plus ? De même, il lui suffit de deux phrases pour dire la pression subie par un couple mixte : « J’embrassai ma mère sur la joue et déclarai dans un murmure qu’il était temps de partir. Elle me saisit le poignet et me répondit sur le même ton: “Helen, veille à ce qu’on ne vous voie pas. Sinon pour toi, du moins pour lui.” »
Après son passage à Paris, Dinaw Mengestu s’apprêtait à s’envoler pour la République centrafricaine avec Médecins sans frontières. En septembre, il se rendra en Éthiopie pour rendre visite à sa famille. Ses parents, eux, parlent parfois de rentrer, mais pour l’heure ils restent aux États-Unis – l’Atlantique est si profond de tant d’histoires singulières.
Tous nos noms, de Dinaw Mengestu, traduction de Michèle Albaret-Maatsh, éd. Albin Michel, 338 pages, 21,50 euros, à paraître le 20 août.
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles