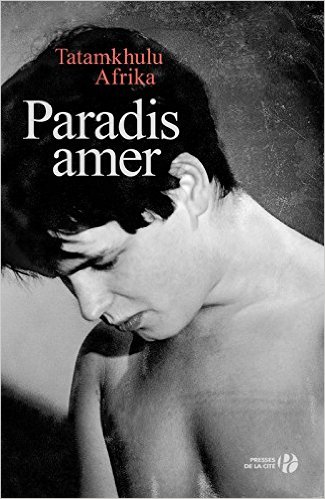Littérature : les amours interdits d’un soldat sud-africain pendant la Seconde guerre mondiale
Écrivain aux vies multiples, le Sud-Africain Tatamkhulu Afrika évoque dans « Paradis amer » ses années de captivité lorsqu’il fut soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l’affection, trouble, qu’il éprouva pour l’un de ses codétenus.

Comment survivre à l’horreur du champ de bataille et des camps ? Seul, l’on ne peut rien. © BETTMANN/CORBIS
Qui était-il, Tatamkhulu Afrika ? L’écrivain sud-africain à la vie rocambolesque et aux multiples identités l’a-t-il jamais su lui-même ? Né Mogamed Fu’ad Nasif en 1920 en Égypte, d’un père égyptien et d’une mère turque, et décédé en 2002 au Cap, il aura, en plus de quatre-vingts ans, changé de nom à quatre reprises, été aussi bien soldat, mineur, barman, comptable que batteur dans un orchestre de jazz, et connu l’emprisonnement lors de la Seconde Guerre mondiale en Libye, en Italie, en Allemagne et, sous l’apartheid, en Afrique du Sud. Là même où ses parents avaient émigré en 1923 alors qu’il n’avait pas encore 3 ans et où ils sont décédés de la fièvre quelques mois après leur arrivée. Recueilli par des amis méthodistes de la famille, le jeune orphelin sera baptisé John Carlton. La vérité lui sera tue jusqu’à sa majorité.
Quelques années plus tard, en 1942, alors qu’il combat au sein de l’armée sud-africaine contre le fascisme européen, qui déploie ses tentacules jusque sur les terres africaines, il est fait prisonnier à Tobrouk. À la Libération, il s’installe en Namibie, pris en charge par une famille sud-africaine. Nouvelle vie, nouvelle identité. Jouza Joubert exerce différents petits métiers, puis s’établit au Cap en 1964, en pleine « saison blanche et sèche ». Le régime d’apartheid le classe parmi les Blancs, il refuse, se convertit à l’islam, opte pour un nouveau prénom, Ismail. Mais l’ancien soldat qui avait pris les armes contre la folie nazie n’accepte pas de voir son pays étouffé par la terreur raciste.
Enfant d’Afrique, profondément épris de liberté, il entre en résistance une nouvelle fois. Et fonde en 1967 une organisation musulmane, Al-Jihaad, avant de rejoindre l’Umkhonto we Sizewe (« le fer de lance de la nation ») dans les années 1980. Nouvelle vie, nouvelle identité : les combattants de la branche armée de l’ANC le surnomment Tatamkhulu Afrika (« grand-père Afrique », en xhosa), un nom qu’il adoptera jusqu’à sa mort. L’homme révolté n’échappera pas à son destin et se retrouvera de nouveau emprisonné, condamné pour terrorisme et banni, ce qui lui interdit de s’exprimer publiquement. À sa sortie de prison en 1992, Tatamkhulu Afrika publie Nine Lives, un recueil d’une poésie profondément ancrée dans un réel des plus sordides. Il recevra plusieurs prix sud-africains. Dix ans plus tard paraît Paradis amer, salué par la critique et dont les Presses de la cité viennent de publier la traduction française. Las, renversé par une voiture, l’écrivain meurt deux semaines après la sortie de son roman, inspiré de sa captivité lors de la Seconde Guerre mondiale.
Lucidité crue et pudeur
Texte puissant empreint d’une poésie sombre, Paradis amer est le récit d’un survivant qui reçoit d’un ancien prisonnier de guerre un bien étrange colis accompagné de quelques mots. Longtemps repoussés, les souvenirs affluent et brisent une fragile digue qu’une culpabilité voilée avait érigée tant bien que mal. Paradis amer est un roman de guerre mais pas seulement. L’écriture, classique, s’étire, traduisant la langueur qui s’abat sur les corps et dans les esprits emprisonnés. Avec une lucidité crue, Tatamkhulu Afrika dessine, à la manière d’un Goya peignant Saturne dévorant l’un de ses fils, l’enfer sur terre : la guerre, la défaite, la vie dans les camps, la déchéance physique et mentale quand la famine et la peur prennent le contrôle des corps et des esprits. Quand l’on n’est plus homme mais ce « déchet » dont le vainqueur ne veut s’encombrer. Quand toute humanité nous quitte pour nous livrer à notre plus basse animalité. Quand la raison nous abandonne aux griffes de la folie et qu’on en vient à « pense[r] alors qu’il aurait mieux valu qu’ils nous aient fusillés là-bas et enterrés, ou qu’ils nous aient laissés pourrir tant que nous possédions encore les derniers lambeaux d’une dignité que nous n’avons jamais méritée ».
Seul, l’on ne peut rien. Même les âmes solitaires sont condamnées à supporter l’autre et à accepter toute aide lorsqu’elle se présente à elles.
Comment survivre alors ? Seul, l’on ne peut rien. Même les âmes solitaires comme Tom Smith, le narrateur, sont condamnées à supporter l’autre et à accepter toute aide lorsqu’elle se présente à elles. Jeune officier « au tout début de la vingtaine », ce « macho faiblard » se retrouve presque malgré lui à nouer une amitié avec deux prisonniers, Douglas, aux manières efféminées, et Danny, au caractère plutôt viril. Avec pudeur, Tom Smith s’interroge sur la nature véritable des liens qui les unit. Quand la fraternité devient si fusionnelle, si dense, n’est-ce pas de l’amour ? Empli de préjugés et conscient de baigner dans une culture où l’homophobie quotidienne a répandu son fiel et ses clichés grotesques dans tous les pans de la société, Tom Smith peine à sortir de « la confortable camisole de force » dans laquelle il a été « élevé depuis sa naissance ». Mais face à Danny, doit reconnaître le jeune homme, « j’écarte couche après couche de conservatisme et de prétention, voire de véritables mensonges, pour atteindre enfin un ultime noyau aimanté qui m’attire et me force à le regarder en face, à mon corps défendant ». Nourri de doutes, de crainte, mais lucide, Tom est tantôt dans le déni, tantôt dans l’acceptation.
Avec beaucoup de pudeur, Tatamkhulu Afrika décrit ces amours interdites et la découverte d’une sexualité qui peine à s’assumer et à se vivre pleinement. Il faudra attendre le retour à la vie civile pour qu’elle s’impose. « Là-bas, observe Danny, t’as passé ton temps à me mentir et à te mentir à toi-même sur ce qui se passait, en prétextant ceci ou cela et en faisant semblant que rien n’avait changé, mais lui, ajoute-t-il en faisant se dresser complètement mon pénis du pouce et de l’index, te dit ce que toi et moi avons toujours su. » Les deux hommes parviendront-ils pour autant à vivre leur amour et à assumer cette partie d’eux-mêmes qu’ils ont tenté tant bien que mal de refouler ? À se déprendre des on-dit, à affronter le regard des autres et à échapper à une vie bien rangée avec femme et enfants ainsi que le conçoivent les bien-pensants ? La société le leur permettra-t-elle ? Rien n’est moins sûr.
Paradis amer, de Tatamkhulu Afrika, traduit de l’Anglais (Afrique du Sud) par Georges-Michel Sarotte, éd., Presses de la cité, 304 pages, 21,50 euros.
Extrait
« L ‘obscurité est aussi intérieure qu’extérieure au moment où, cédant à la force de la marée des souvenirs qui, croyais-je, avait reflué et s’était perdue à jamais dans l’oubli, je me tourne vers le paquet et commence à le déballer. Puis je m’arrête, refusant de recevoir cette chose de lui et ayant aussi peur du paquet que s’il contenait sa main coupée.
Ou bien tout cela n’est-il que le fruit de mon imagination ? Est-ce que j’accorde à un fantôme un pouvoir qui n’appartient qu’à moi ? Quel sens peuvent conserver une guerre qui aujourd’hui est devenue, comme toutes les autres, un simple pétard mouillé, et un amour dont l’étrangeté devrait rester ensevelie là où elle gît ?
Hélas, incapable de résister à la tentation, je tends l’oreille pour écouter le rossignol qui ne chantera plus et je n’entends que le hurlement de la sirène d’une ambulance ou d’une voiture de police, le cri d’une femme qu’on tue ou qu’on viole dans quelque ruelle et à qui personne ne répond. Je baisse la tête et enfouis mon visage dans la vacuité de mes mains. »
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles