Reportage : Douala, en roues libres
Douala compte près de 100 000 motos-taxis. Un nombre qui dit tout à la fois la faiblesse des infrastructures de transport et l’échec des politiques de lutte contre le chômage dans une ville traditionnellement contestataire, où aucun suffrage n’est à négliger.

Personne n’a oublié que les émeutes de 2008 sont parties d’un mouvement de grogne des « motomen ». © MOTO ACTION
Au Cameroun, le cauchemar des urbanistes a le visage de ces motards dépenaillés qui ont envahi les rues des grandes villes du pays. Il a l’odeur âcre de l’essence frelatée, la couleur des huiles toxiques qui noircissent les trottoirs et le bruit pétaradant d’une moto chinoise. Comme dans une nuit sans fin, des milliers de ces engins squelettiques, sans chromes ni cuirs, prolifèrent à grande vitesse. Ils colonisent les rues, pas même découragés par les fortes pluies de Douala, le grand port de la côte camerounaise.
Selon les représentants des syndicats, la ville compterait plus de 100 000 chauffeurs de motos-taxis – bien plus qu’à Yaoundé, cité essentiellement administrative. Ici, comme dans le reste du Cameroun, ils sont affublés du surnom désobligeant de « bend-skin », en référence à une danse bamilékée qui, comme les deux-roues, met le postérieur des dames en valeur. Avec ses plus de deux millions d’habitants et un service de transports publics qui n’a pas suivi l’explosion démographique de ces dernières années, la capitale économique du pays n’a pas eu d’autre choix que de laisser le phénomène se développer.
Pour ne rien arranger, la révolte des années 1990 a donné à Douala une réputation de chaudron de la contestation et, pendant plusieurs années, les mairies d’arrondissement ont été tenues par des élus de l’opposition. Elles ont fait de leur mieux, mais Yaoundé s’est appliqué à leur savonner la planche et à leur imposer une diète budgétaire. Difficile, dans ces conditions, de développer des infrastructures urbaines dignes de ce nom ou d’absorber tous les demandeurs d’emploi affluant des campagnes et même du Nigeria voisin.
Douala ou le Hô Chi Minh-Ville des années 1970
Depuis, les populations sont revenues à de meilleurs sentiments et ont réappris à voter pour les candidats du parti au pouvoir. Trop tard, cependant, pour enrayer le lent mais inexorable déclassement de la ville naguère élégante de Douala Manga Bell, le fier nationaliste douala pendu par le colon allemand. « Ces motos qui transportent parfois trois à quatre personnes sans casque me rendent malade, se plaint Josyane, une Camerounaise récemment rentrée au pays après une expatriation de quinze ans en Afrique du Sud. Je ne m’attendais pas à ce que Douala ressemble à Hô Chi Minh-Ville dans les années 1970 ! »
Les chauffeurs de motos-taxis n’en ont cure. Ils se savent mal aimés mais nécessaires. Impossible de les rater, quand ils s’agglutinent par dizaines sur un trottoir, l’air de dire qu’ils n’ont pas l’intention de raser les murs alors qu’ils sont les victimes de l’échec des politiques de l’emploi. C’est « l’irruption des pauvres » que décrivait le sociologue camerounais Jean-Marc Ela dans son livre publié en 1994.
Les chauffeurs ont monté une mutuelle qui a signé des conventions avec les grands hôpitaux pour que les soins des blessés soient immédiatement pris en charge
Dans cette fourmilière moite, on se serre les coudes. On ne se dit pas bonjour, mais « C’est comment ? ». En cas d’accident, les chauffeurs accourent, solidaires, pour relever le blessé ou le conduire à l’hôpital. Ils ont monté une mutuelle qui a signé des conventions avec les grands hôpitaux pour que les soins des blessés soient immédiatement pris en charge et, quand ils se confient, leurs histoires se ressemblent. Steve Lamine Moungam était étudiant en deuxième année de sciences économiques quand il a enfourché sa première moto-taxi. « Elle appartenait à un copain, se souvient-il. Par la suite, j’ai acquis un engin en exploitation-vente, avant d’en acheter un autre, que j’ai réglé en un seul paiement de 400 000 F CFA [environ 609 euros]. »
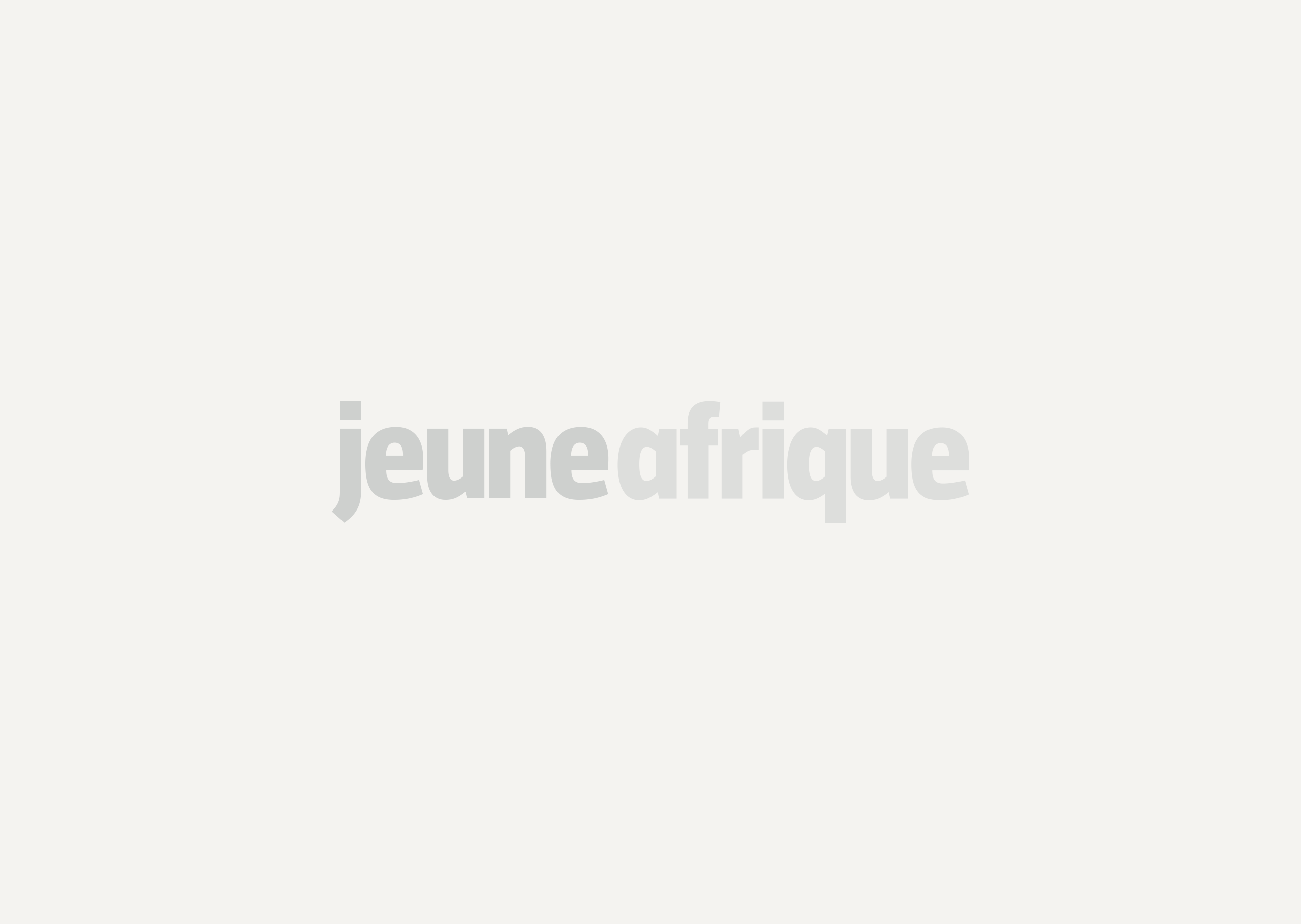
Peu de temps après, le voici reçu au concours de l’école des instituteurs, mais cela fait quatre ans qu’il est « en attente de contractualisation » dans l’Éducation nationale. À 35 ans, ce père de trois enfants s’est donc résolu à enfourcher de nouveau sa moto, renouant ainsi avec le seul emploi qu’il ait jamais exercé. Son véhicule lui rapporte entre 5 000 et 6 000 F CFA par jour. « C’est peu, dit-il, mais ça permet de survivre. » Aujourd’hui, il dirige un syndicat qui compte plus de 160 adhérents, mais maintient que cet emploi n’est que passager. Un jour, il sera instituteur.
Le gouvernement prêt à organiser la profession
Longtemps, le gouvernement a détourné les yeux devant le spectacle de ces naufragés de l’État-providence. Puis il a tenté de lutter contre la prolifération des motos-taxis. « À défaut de pouvoir offrir une autre solution, les autorités ont fait preuve d’une certaine tolérance avant de travailler à l’éradication d’une activité dangereuse, incontrôlable et non conforme à l’image d’une ville moderne », résume Maïdadi Sahabana, ingénieur à la Communauté urbaine de Douala. Mal leur en a pris : les chauffeurs se sont organisés, bien décidés à défendre leurs intérêts. Ils ont refusé de se plier à l’obligation du port de casque et, aujourd’hui encore, préfets et forces de maintien de l’ordre préfèrent éviter leurs colères. Aucun n’a oublié que les émeutes de 2008 (40 morts selon le bilan officiel, près de 100 selon l’antenne locale de l’ONG Acat) sont parties d’un mouvement de grogne des motos-taxis contre la hausse du prix des carburants.
Les chauffeurs sont désormais assujettis à l’impôt libératoire (10 500 F CFA par an), au paiement d’une police d’assurance (22 000 F CFA par an), à une taxe de stationnement (5 000 F CFA par an) et à une vignette (entre 2 000 et 15 000 F CFA par an
Résultat, le gouvernement se montre moins intransigeant. Mieux : il est désormais conscient du danger qu’il y a à laisser s’épanouir dans le maquis de l’informel une activité (et une catégorie sociale) regroupant des centaines de milliers de personnes à travers tout le pays. Le 10 février 2013, dans un discours adressé aux jeunes, le président Paul Biya met du baume sur les plaies : « Prenons, par exemple, le cas des conducteurs de motos-taxis […], déclare-t-il. N’est-on pas heureux de la possibilité offerte d’atteindre rapidement et à moindre coût des destinations difficiles d’accès ? » En juillet de la même année, le Premier ministre prend un décret destiné à organiser la profession.
« Mais sortir de l’informel a un coût », soupire Ferdinand Fongang, la quarantaine, président d’un groupement qui compte douze associations et quatre syndicats de motos-taxis. Les chauffeurs sont désormais assujettis à l’impôt libératoire (10 500 F CFA par an), au paiement d’une police d’assurance (22 000 F CFA par an), à une taxe de stationnement (5 000 F CFA par an) et à une vignette (entre 2 000 et 15 000 F CFA par an, selon que l’on possède une moto à deux ou à trois roues). Les « motomen » ne sont pour autant pas devenus des transporteurs comme les autres. Ils restent cantonnés en lisière du centre-ville, réservé, lui, aux taxis. Bonanjo, le quartier des affaires et des ministères, leur est interdit, tout comme Bonapriso, Bali ou Deido, les quartiers résidentiels et historiques de la vieille ville.
Être ami des « motomen » est gage de popularité
Des personnalités ont compris, depuis des années, l’intérêt qu’il y avait à s’attirer les faveurs de cette catégorie socioprofessionnelle. « Le président Biya n’est pas le premier à essayer de récupérer cette force politique, estime Manassé Aboya Endong, enseignant en sciences politiques à l’université de Douala. Certains, à l’instar de feu Françoise Foning [la maire du 5e arrondissement de Douala, décédée en janvier], avaient déjà instrumentalisé ce vivier électoral. » Populiste et proche du pouvoir, cette femme d’affaires était parvenue à infiltrer le milieu en s’offrant un parc de près de 7 000 motos pour autant de protégés. Elle tirait d’eux sa légitimité et affichait sa popularité par sa capacité à rassembler des milliers de transporteurs dans des cortèges pétaradants. Le contrat était clair : une moto, une voix.
La reconnaissance des puissants sonne comme une revanche pour ces hommes souvent considérés comme des traîne-savates
Le 1er mars 2013, une manifestation inédite de motos-taxis en soutien au président Paul Biya fut opportunément autorisée et dirigée vers l’esplanade habituellement interdite du palais d’Etoudi, à Yaoundé. Là, leurs conducteurs furent cordialement accueillis par le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh. La reconnaissance des puissants sonne comme une revanche pour ces hommes souvent considérés comme des traîne-savates. Seul le temps dira si cette alliance de circonstance garantit la tranquillité des uns et des autres.
Fiers de ce qu’ils font et de ce qu’ils sont
Yves Manga et Valérie Sandres ont fondé, en 2006, Moto Action Cameroun – une organisation qui, en étroite collaboration avec Moto Action France, créée un an plus tôt, veut prévenir et sensibiliser sur le sida. Ce n’est donc pas un hasard s’ils pilotent actuellement une étude sur les caractéristiques et l’organisation des motos-taxis au Cameroun, et sur leur vulnérabilité au VIH.
« Leur profession les amène à des contacts fréquents avec des personnes à risque, telles que les prostituées, explique Valérie Sandres. Et ce n’est pas propre au Cameroun. Une étude réalisée à Kampala en 2011 montre que le taux de prévalence est de 7,5 % chez les motos-taxis, contre 4,1 % en moyenne chez les hommes. Nous, nous leur disons : « Sortez couverts, et avec un casque ! » » L’association a soutenu aussi la création d’une mutuelle ainsi que la fondation d’un pavillon de traumatologie à l’hôpital Laquintinie de Douala… « Ce que nous voulons, c’est qu’ils réapprennent à avoir confiance en eux. Qu’ils soient fiers de ce qu’ils font et de ce qu’ils sont. »
L'éco du jour.
Chaque jour, recevez par e-mail l'essentiel de l'actualité économique.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
