Sénégal – Felwine Sarr : « L’Afrique n’est toujours pas décolonisée »
Refusant la nostalgie d’un passé traditionnel mais cherchant à construire un futur ancré dans les cultures locales, l’essayiste sénégalais dénonce l’aliénation intellectuelle des élites qui pensent le continent à l’aune du modèle occidental.

Image174865.jpg © LÉO-PAUL RIDET/HANSLUCAS.COM POUR J.A.
Économiste, philosophe, musicien, éditeur et libraire aux côtés de Boubacar Boris Diop et de Nafissatou Dia Diouf, Felwine Sarr n’est jamais là où on l’attend. Qui aurait la paresse de le qualifier de penseur africain découvrirait au fil de ses ouvrages un défenseur exigeant de l’universel. Qui en conclurait hâtivement que le natif de Niodior a rompu avec ses racines serait étonné de lire dans Afrotopia ses arguments en faveur du « spécifiquement africain ». C’est que Felwine Sarr est un libre penseur et un indiscipliné. Un homme qui remet en question les connaissances établies et les certitudes, un intellectuel dont la pensée se situe à la croisée des savoirs disciplinaires et dont la réflexion cultive un champ des possibles fertile.
Dans son dernier essai, le Sénégalais entend fonder une « utopie active », celle d’une Afrique qui « réalise ses potentialités heureuses ». Il s’agit là d’un « projet de civilisation qui met l’homme au cœur de ses préoccupations en proposant un meilleur équilibre entre les différents ordres : l’économique, le culturel, le spirituel ». Mais pour ce faire, prévient Felwine Sarr, il faut parvenir à se libérer de la domination mentale et intellectuelle occidentale afin d’ancrer ce projet dans les cultures locales. Loin d’être un repli identitaire, c’est à cette seule condition, explique-t-il, que chacun pourra se réaliser pleinement, que l’on construira « des sociétés qui font sens pour ceux qui les habitent » et que le continent pourra être « coproducteur et cohéritier du patrimoine intellectuel et culturel de toute l’humanité ». Une position qui l’amène à revoir entre autres les notions de développement, de progrès, d’économie informelle, de richesse, de modernité, de créolité, de démocratie… Autant de thèmes qui font débat.
Jeune Afrique : Avec Afrotopia, vous appelez à transformer positivement les sociétés africaines pour mettre l’homme au cœur d’un projet de civilisation. Comment les citoyens peuvent-ils s’emparer de leur propre destin ?
Felwine Sarr : Pour qu’ils puissent exercer un contrôle sur la gestion de la cité, sur les orientations à prendre et sur le sens qui est donné à l’aventure collective, la révolution devra être intelligente. Cela suppose une réelle réflexion sur le type de citoyen que l’on forme et que la société, l’école, l’université, la culture en règle générale produisent. Prenons le temps de réfléchir à qui l’on est et surtout à qui l’on veut devenir. Et revoyons l’éducation, les savoirs et la manière dont on les transmet.
Faut-il, par exemple, que les enseignements se fassent dans les langues locales ?
C’est fondamental. Des expériences menées au Sénégal montrent que si les enfants apprennent en wolof, en peul ou en sérère, ils sont plus performants que les autres, y compris en français et en anglais. Si l’on veut que l’enseignement se fasse dans nos langues, cela nécessite au préalable un travail de traduction des concepts et la mise à disposition d’outils didactiques (ouvrages, dictionnaires…) pour que les langues soient prêtes à accueillir ces savoirs. Le politique n’a pas pris la mesure des enjeux ni de l’importance de ne pas obliger nos jeunes enfants à faire le détour par une langue étrangère pour acquérir un savoir universel.
Il faut faire preuve de créativité en observant les dynamiques géographiques et linguistiques
Mais comment s’y prendre dans les pays où il n’y a pas de langue dominante ?
Il faut faire preuve de créativité en observant les dynamiques géographiques et linguistiques. En Afrique de l’Ouest, il y a plus de 30 millions de Peuls. Le peul pourrait être une langue véhiculaire tout comme le kiswahili en Afrique centrale, le lingala en RD Congo, le yoruba et le haoussa autour du Nigeria. Nous apprenons bien l’anglais, le français, l’arabe, le chinois tout en étant africains. Pourquoi ne pourrions-nous pas apprendre le kiswahili ?
Vous appelez à une décolonisation des savoirs, tout comme l’ont fait nombre de philosophes dans les années 1970. Est-ce à dire que depuis rien n’a changé ?
Absolument rien ! Je suis désolé d’être aussi radical. Ça reste une proposition théorique que l’on aime reprendre dans des colloques autour du décentrement épistémologique, mais les cadres théoriques de la recherche sont les mêmes, les disciplines également. Nous répétons les mêmes antiennes, les mêmes auteurs, les mêmes réflexes bien que nous voyions que la réalité que nous appréhendons est changeante. Regardons nos universités, ce sont les mêmes que celles laissées par le colon. Il n’y a aucune innovation.
De nombreux chercheurs africains enseignent à l’étranger, notamment aux États-Unis dans des universités prestigieuses. Faut-il regretter une fuite des cerveaux ?
Oui et non. Évidemment, on peut comprendre les démarches individuelles même si, collectivement, c’est sous-optimal pour nous. La pensée décoloniale – je ne dirais même pas postcoloniale – se trouve principalement en Amérique latine et dans les universités nord-américaines. Les chercheurs africains qui naviguent dans ces espaces bénéficient d’une plus grande distance critique et d’un environnement beaucoup plus ouvert et fécond sur ces idées. Mais il manque l’enracinement de leur regard dans les critères gnoséologiques issus des sociétés africaines. Et leur influence est homéopathique. Leur impact pourrait être tout autre s’ils étaient en prise avec les universités africaines et s’ils pouvaient influer sur les orientations de la recherche.
Quelles peuvent être la place et le rôle des diasporas dans ce futur à construire ?
On a besoin de tous nos bras, de tous nos cerveaux et de toutes les forces constructives, peu importe où elles se trouvent. Nous sommes dans un siècle de mouvement, l’Afrique est aussi déterritorialisée. De là où elle est, cette diaspora peut injecter de nouvelles idées, proposer de nouvelles dynamiques. Maintenant, il ne faut pas romantiser cette contribution. Il y a des formes de circularité qui n’apportent pas grand-chose. Il faut que l’engagement soit concret.
Et les élites africaines, quel peut être leur rôle ?
On parle beaucoup de la faillite des élites, mais ce faisant on mêle élites politiques, économiques et intellectuelles. Les élites politiques et économiques ont le plus failli. Les politiques n’ont été ni à la hauteur de leurs responsabilités ni assez entreprenants et audacieux pour oser rendre féconde la rencontre avec soi-même qu’a été la période des indépendances. Quant aux élites économiques, elles n’ont pas assez foi dans le continent pour y investir et y garder leurs avoirs. Du côté des intellectuels, il y a eu de réelles tentatives de penser l’Afrique. Je suis plus indulgent avec eux car ils sont tributaires de cadres mis en place par d’autres, les politiques, qui ont plus d’influence et de poids. Il y a un vrai problème : il manque un pont entre la recherche et le politique pour que l’action soit éclairée par la pensée.
Il est primordial de recouvrer l’estime de soi en retrouvant dans nos référents culturels ce qui fait grandir notre humanité
Dans votre essai, il est question de repenser les identités africaines, de se repenser soi à partir de soi. Comment intégrer les autres dans ce projet ?
C’est une histoire d’étapes et de stratégie. Pendant des siècles, nos cadres de référence et nos systèmes de signification ont été détruits ou minorés. On nous a convaincus que tout ce qui émanait de notre histoire n’avait aucune valeur et que pour être, on devait être des photocopies d’autrui. Il y a encore une telle haine de soi qu’on évalue les différentes options qui s’offrent à nous en choisissant systématiquement ce qui vient de l’Occident. Si c’est le meilleur choix, d’accord ! Mais ce n’est pas toujours le cas. Il est primordial de recouvrer l’estime de soi en retrouvant dans nos référents culturels ce qui fait grandir notre humanité. Cela ne veut pas dire qu’on exclut l’autre, mais il est important de rebâtir le regard que l’on porte sur nos références intellectuelles, culturelles, linguistiques, spirituelles. À partir de là, on aura une plus grande liberté de choisir, d’accueillir ce qui nous enrichit. L’emprunt doit être un acte de liberté et non le produit d’un impérialisme culturel. C’est pourquoi je conclus mes chapitres sur l’idée de synthèse, car elle ouvre sur l’autre et sur ses apports.
La synthèse, dites-vous, mais vous vous méfiez pourtant des notions de métissage, d’hybridité, de créolité et revalorisez le « spécifiquement africain », qui a été suspecté d’enfermement identitaire. Pourquoi ?
Je m’en méfie car j’y lis une sorte de ruse, de piège intellectuel. Si on veut prendre ces notions et en faire des notions phares qui éclairent la destinée humaine, alors elles devraient être valables pour tout le monde. Si nous relisons l’histoire des civilisations, nous nous apercevons que celles qui ont pu rayonner sont celles qui ont pu intégrer tous les mondes qui s’offraient à elles. Toute civilisation est fondamentalement créole et hybride originellement. Elle ne le devient pas. Mais les hommes apportent des réponses particulières en fonction de la géographie et de l’Histoire. Il n’y a rien de problématique à dire qu’une trouvaille est spécifiquement asiatique ou japonaise. C’est reconnaître l’égale dignité de tous dans la contribution à l’humanité. Pourquoi cette spécificité ne serait-elle pas africaine ? Le cousinage à plaisanterie comme tissage du lien social est spécifiquement africain, et nous pouvons nous en inspirer. En disant que c’est hybride ou créole, au fond, on perpétue le même discours qu’il y a plus de cinquante ans mais sous d’autres formes insidieuses en refusant que quelque chose du continent ait de la valeur.
Afrotopia-felwine-Sarr-Anne-et-arnaud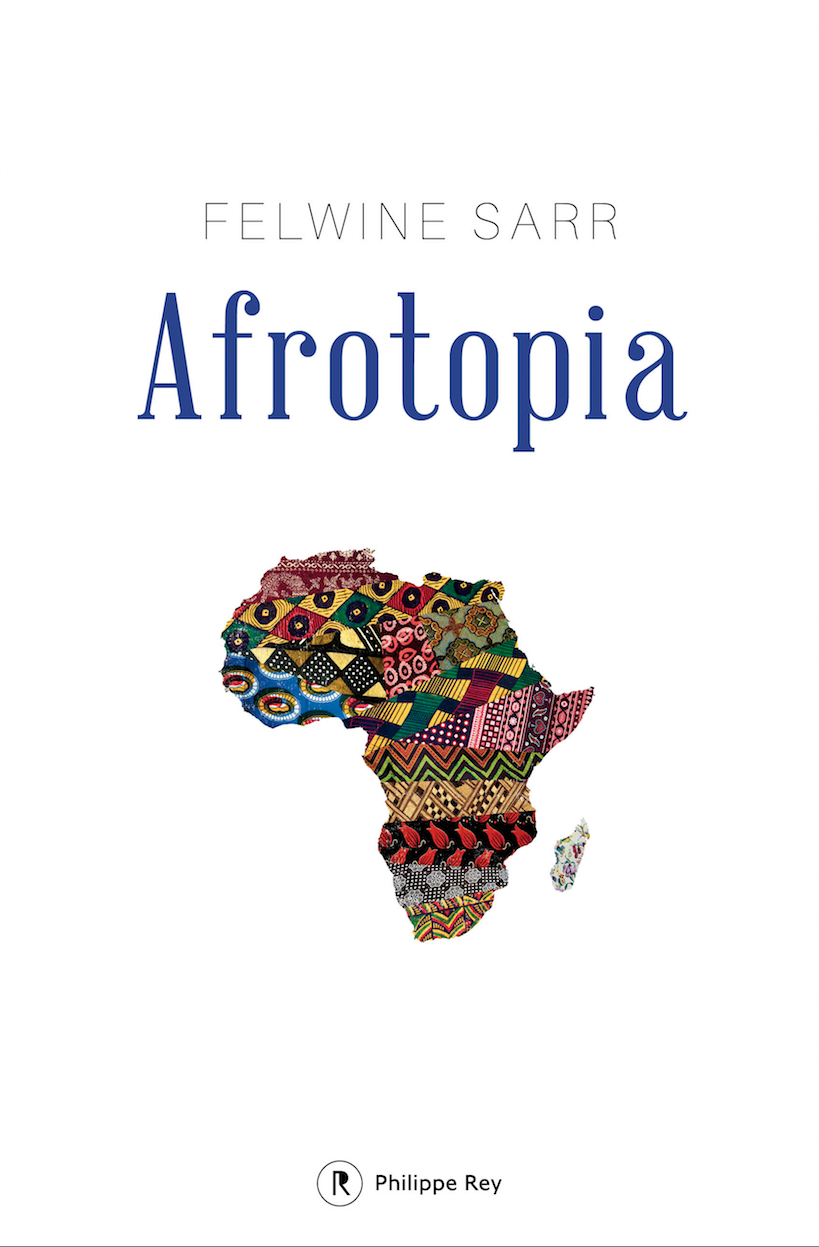
Afrotopia, de Felwine Sarr, éd. Philippe Rey, 160 pages, à paraître le 10 mars.
Être africain en 2016, ça veut dire quoi ?
C’est considérer que l’identité n’est pas derrière soi mais qu’elle est devant soi. C’est porter des héritages et décider de qui on veut devenir ; et ce de manière décomplexée. Être africain, c’est être coproducteur et cohéritier du patrimoine intellectuel et culturel de toute l’humanité et s’adosser à une histoire longue, riche et complexe. À partir de là, interrogeons-nous : comment vivre ensemble ? comment construire la mutualité ? comment articuler les altérités ?
Vous appelez à repenser des concepts issus des cultures africaines qui disent « le mieux-être et le mieux-vivre ensemble », comme l’ubuntu, la teranga… Ces concepts peuvent-ils être opérants hors d’Afrique ?
Bien sûr ! J’ai la faiblesse de croire que si l’on pense l’Afrique, on pense du même coup le monde. On a là des notions intéressantes qui pourraient nous aider à concevoir la manière dont on réarticule notre vivre-ensemble. Certains systèmes de représentation, dans le Rwanda ancien ou dans l’empire ife, par exemple, étaient fondés sur une assemblée dite des sages, qui était une sorte de conseil constitutionnel garantissant la stabilité et la représentativité des différentes couches sociales et des intérêts divergents. Même en les changeant, on peut s’inspirer des traditions pour les traduire dans des formes qui sont beaucoup plus adaptées aux mentalités actuelles et on peut obtenir ainsi un espace dans lequel on crée des manières de négocier la transmission du pouvoir et la prise en compte des intérêts des différents groupes, afin de garantir de la stabilité. Cela nous permettrait de sortir du mimétisme peu fécond dans lequel nous sommes.
Est-ce une manière d’africaniser la démocratie et de repenser le modèle fondé sur les élections ?
Il faut absolument repenser ce modèle. Le temps électoral est une question technique et formelle qui vide l’action démocratique de toute sa substance si l’on est exclusivement focalisé sur la technologie électorale. L’expression populaire ou des choix individuels n’est pas garantie par les modes d’élection que nous mettons en place. Au second tour, par exemple, l’on choisit rarement le candidat que l’on préfère mais on reporte son choix vers le moins mauvais. Faisons plutôt preuve de créativité, d’innovation sociale en nous inspirant de notre culture, de notre histoire, et construisons des formes adaptées qui font sens pour les populations qui les produisent. Et qui garantissent la participation du plus grand nombre sans épouser forcément ces formes institutionnelles qui sont nées d’une histoire et d’une géographie particulières.
N’y a-t-il pas aussi un risque de manipulation de la tradition lorsqu’il s’agit de refuser certaines valeurs ou réalités, comme les droits de l’homme ou l’homosexualité ?
Si. On s’en sert parfois pour refuser l’autocritique en disant : « Nous sommes comme cela, point barre, inutile de se remettre en question. » Mais l’idée, au contraire, c’est d’être au meilleur de soi-même et non pas d’être tout court. Il y a un travail de tri et d’élagage à faire au sein de la tradition.
Vous dénoncez deux phénomènes de domination sur le continent : la « recolonisation économique » des anciennes puissances impérialistes et la « colonisation des terres » par la Chine. Rien n’a donc vraiment changé depuis 1960 ?
J’aime bien le terme d’« indépendance ». Les indépendances ont été accordées mais le continent n’est toujours pas décolonisé. La décolonisation est un processus qui s’installe dans la durée. On ne peut pas imaginer qu’après cinq siècles de domination, cinquante ans suffisent à libérer totalement le continent. Les réseaux d’influence et certaines pratiques demeurent. On dit que l’Afrique est l’avenir puisqu’il y a de la croissance démographique, des terres arables, des ressources minières et naturelles… En fait, on veut répliquer ici le même système économique et civilisationnel qui a montré ailleurs ses limites en matière d’empreinte écologique, d’économie et de choix de société. Reprenons l’initiative en affirmant : « Si vous comptez sur ces ressources, il faudra le faire à travers des modèles sociétaux que nous, Africains, allons décider et mettre en œuvre. » Et ces modèles devront trouver un équilibre entre l’économique, le culturel et le symbolique.
La France est de plus en plus présente militairement sur le continent au nom de la lutte contre le terrorisme. Est-ce un bien pour un mal ou un mal pour un bien ?
J’évite d’être cynique, mais ça tombe bien pour certains intérêts stratégiques et géopolitiques français. Au Nord-Mali, les individus sont heureux d’avoir été libérés de l’oppression jihadiste. C’est normal. Mais on oublie que cette situation est le résultat de l’intervention française en Libye. Paris a envie de garder un no man’s land où il a des intérêts, comme avec Areva au Niger, et il entend contenir le péril jihadiste dans un espace loin de l’Hexagone. Les attentats récents nous montrent que nul n’est à l’abri et que le conflit s’est internationalisé.
Dans ce contexte, à quoi servent les institutions panafricaines politiques comme l’UA ?
Hélas, pas à grand-chose ! Elles font preuve d’inaction et d’un manque de leadership incroyable !
Et que dire des institutions économiques comme la BCEAO ? Faut-il par exemple renoncer au franc CFA pour gagner son indépendance ?
La BCEAO pourrait être plus ambitieuse dans son projet de politique monétaire, car elle a tout à fait les moyens de gérer la monnaie toute seule. La question du franc CFA est complexe : il faut peser les avantages et les inconvénients. Si l’on choisit d’abandonner le franc CFA, comme je le soutiens, il faut penser à tout un tas de préalables techniques pour une sortie efficiente et éviter de nous retrouver dans une situation pire que celle dans laquelle nous sommes. Je comprends la dimension souverainiste selon laquelle il faut avoir sa monnaie et pouvoir la contrôler soi-même. C’est une lecture politique. Mais, d’un point de vue économique, la question monétaire n’est pas toujours centrale. Elle l’est pour les économies d’exportation comme la Chine, l’Asie du Sud-Est. Dans notre cas, ce n’est pas toujours évident.
Vous estimez que les études économiques portant sur l’Afrique tiennent peu compte de l’informel et de l’économie relationnelle.
La première difficulté est dans le choix sémantique et terminologique. On a une économie qui est populaire, fondée sur un agir économique issu des sociocultures, qui nourrit actuellement 70 % des Africains. On la qualifie d’informelle car ce qui nous intéresse c’est de pouvoir prélever des impôts dessus. Mais on oublie que l’acte économique est d’abord un acte social qui permet de nouer un lien avec l’autre. Prenons l’exemple des mourides au Sénégal. Ce groupe a développé une économie fondée d’abord sur la confiance entre les membres de la confrérie. Nous devrions explorer les ressorts de ce modèle qui permet de raffermir le lien entre les individus pour l’agrandir et le dynamiser. Tant qu’on ne réenchâssera pas nos économies dans nos sociocultures, on passera beaucoup de temps à tester des modèles qui ne fonctionneront pas. Les pays asiatiques l’ont fait, pourquoi pas nous ? Depuis Adam Smith, on nous fait croire que ce qui est efficient en économie, c’est l’égoïsme et non la générosité, l’abondance, la prodigalité. Mais l’être humain ne cherche pas toujours à maximiser son profit, à avoir le meilleur rapport qualité-prix. Dans le choix économique, il y a aussi des logiques de don et de contre-don. Il y a du sens et de la signification. L’homme est complexe. Il ne se réduit pas à l’« homo economicus ». On peut élargir les frontières de l’économie en s’inspirant de ce qui se fait dans la réalité africaine.
Vous êtes impliqué dans la vie culturelle au Sénégal et avez, entre autres, fondé la maison d’édition Jimsaan. Pourquoi publier Afrotopia en France ?
Philippe Rey m’a proposé qu’on le coédite. Mais c’est une question de crédibilité. Nous avons une maison d’édition, on a quelques titres pour l’instant et on veut asseoir un message de non–complaisance. Je ne peux pas être l’éditeur de mon propre texte.
L ‘INDÉPENDANCE ? OUI, MAIS À QUEL PRIX ?
Les critiques régulières contre le franc CFA appellent à abandonner cette monnaie garantie par la France afin de défendre les intérêts africains. Felwine Sarr estime que la question est plus complexe qu’il n’y paraît . Qu’en pense Edoh Kossi Amenounvé, le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières ?
«Quand on se fonde sur l’évolution de l’économie mondiale au cours de ces dix dernières années et sur la situation économique des pays africains, notamment ceux de la zone franc, il y a plus d’avantages à conserver le franc CFA qu’à l’abandonner. Dans un monde en pleine turbulence où les modèles économiques classiques ont pour la plupart montré leurs limites, la zone CFA a affiché une résilience et une stabilité qu’il faut attribuer aux accords économiques et monétaires actuels, qui obligent à une certaine discipline. S’il fallait abandonner le franc CFA, cela devrait être bien préparé. Il faut réunir les conditions préalables qui permettent à une économie de soutenir sa monnaie : régulation monétaire et financière stable, diversification, transformation-production, exportation et compétitivité, liberté des échanges, forte bancarisation, taux d’épargne élevé, etc. Nous n’en sommes pas là. Avoir une monnaie indépendante ne rime pas nécessairement avec développement. Je crois aux vertus de l’épargne et de l’investissement. Une économie qui veut se développer doit pouvoir mobiliser l’épargne intérieure et extérieure pour financer les investissements, accroître la richesse de ses populations et garantir aux agents économiques un bon pouvoir d’achat. L’instrument monétaire doit être utilisé pour procéder aux ajustements nécessaires lorsque la situation économique l’exige. Le vrai débat aujourd’hui n’est pas monétaire. Il doit être autour de la vision de développement de nos pays, du type de modèle économique à adopter, des ressources financières et humaines dont nous avons besoin pour soutenir ce modèle et l’ajuster en cas de besoin. »
PENSER AFRICAIN
13 décembre 2013, stade de Soweto. Barack Obama rend hommage à Nelson Mandela décédé huit jours plus tôt. Et déclare : « En Afrique du Sud, il existe un mot, « ubuntu », qui décrit son plus grand talent : sa reconnaissance du fait que nous sommes tous liés d’une manière qui peut être invisible à l’œil ; qu’il y a une unité dans l’humanité ; que nous nous réalisons en partageant avec les autres et en prenant soin de ceux qui nous entourent. » Issu de la culture zouloue, ce concept peut être traduit par « je suis parce que nous sommes ». Il « invite en toutes circonstances à privilégier l’intérêt commun sur celui de sa seule individualité, mais aussi à chercher toujours à s’identifier aux autres, y compris à leurs sentiments hostiles, pour régler sa propre vie », explique Jean-Paul Jouary dans Mandela. Une philosophie en actes (éd. Le Livre de poche, 2014). Une notion qui implique le refus de la vengeance et qui inspira à Madiba sa politique de réconciliation nationale. Sur ce modèle, Felwine Sarr invite à explorer d’autres concepts issus des cultures africaines, comme ceux de jom (« dignité »), de teranga (« hospitalité »), de kersa (« pudeur, scrupule »), de ngor (« sens de l’honneur »), d’imihigo (« engagement envers la communauté »)… afin de penser le vivre-ensemble.
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
