Littérature : à maux couverts
Après le génocide rwandais, l’écriture s’est imposée comme une urgence. Pour exorciser la souffrance et fixer la mémoire. Ainsi, les écrivains restent marqués par le massacre, même si peu à peu certains sont tentés par la fiction…

Beata Umubyeyi Mairesse lit un extrait de son livre, Ejo, lors du festival Bulles d’Afrique, à Bordeaux, en 2015. © ANNE-LAURE BOYER
Lorsqu’elle a vu le film germano-britannique Shooting Dogs, en 2005, Scholastique Mukasonga a dû quitter la salle. La romancière rwandaise savait, bien sûr, ce qui s’était passé dans son pays en 1994, elle qui a perdu 37 membres de sa famille dans le génocide. Des témoignages de rescapés, elle en a lu et entendu des quantités. Mais voir les tueries ainsi représentées, sans la médiation des mots et de l’imaginaire, lui était insupportable.
« On aurait cru que les génocidaires allaient sortir de l’écran pour nous massacrer », se souvient, les yeux écarquillés, l’écrivaine, qui tout au contraire a la préoccupation constante de ne pas effrayer. En France, où elle vit depuis 1992, elle est allée jusqu’à dissimuler sa nationalité rwandaise pour cette raison. « Quand on me demandait d’où je venais, j’avais un blocage. Je voyais aussitôt la machette. Je pensais que cela inquiéterait les gens, qu’ils allaient s’enfuir. » Beaucoup la croyaient originaire de Guadeloupe. Elle ne rectifiait pas.
Cette île française des Caraïbes, Scholastique Mukasonga l’a finalement découverte en 2013. Elle y a trouvé l’inspiration pour son nouveau roman, Cœur tambour, qui raconte l’histoire de Kitami, chanteuse prodigieuse périodiquement possédée par Nyabinghi, un esprit mythique de la tradition rwandaise.
Dans ses livre, elle livre un Rwanda paisible, un pays crépusculaire où l’extermination n’est pas encore survenue, mais où sa famille se savait condamnée
Mais, en Guadeloupe, la crainte d’effrayer l’a de nouveau saisie. « Je sais que, pour les Antillais, l’attitude des Africains pendant l’esclavage reste une douleur. Ils nous en veulent. On peut le comprendre. » Cette fois, c’est en revendiquant ses origines qu’elle a exorcisé cette peur. À chaque occasion, elle rappelle que son pays, le Rwanda, n’a jamais pris part à la traite négrière. « Je crois que cela les a mis à l’aise. Et puis, nous avions une empathie du fait de nos mémoires douloureuses : l’esclavage et le génocide. »
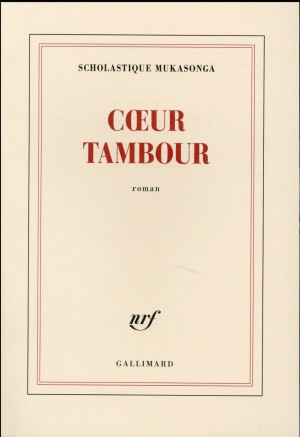
Coeur tambour de Scholastique Mukasonga; éd. Gallimard, 176 pages 16,50. © DR
Le récit de tensions précédant la tragédie rwandaise
C’est toutefois dans les livres de Scholastique Mukasonga que l’on trouve les meilleures preuves de sa délicatesse. Chacun des six récits qu’elle a publiés à ce jour, parmi lesquels Notre-Dame du Nil (prix Renaudot 2012), est imprégné de la question du génocide. Aucun ne se déroule durant les trois mois fatidiques de 1994. Elle raconte plutôt le Rwanda de son enfance, un pays crépusculaire où l’extermination n’est pas encore survenue, mais où sa famille se savait condamnée.
Dans ses textes, on ne trouve ni violence physique ni machette. Et pourtant, ils éclairent puissamment la tragédie rwandaise. « Je voulais préserver les lecteurs. Je sais que, face à la brutalité, on se bouche les oreilles et les yeux en disant : « Ce n’est pas possible. » C’est pour cela aussi que les rescapés du génocide sont souvent murés dans la souffrance sans oser en parler. »
Scholastique Mukasonga
Beata Umubyeyi Mairesse a longtemps fait partie de ceux-là. Elle est arrivée en France à l’âge de 15 ans, après plus de deux mois dans l’enfer génocidaire. « Au début, je n’en parlais pas. Les gens ne m’interrogeaient pas forcément, par crainte d’entendre des choses terribles. Mais ça m’allait bien. Très peu de gens connaissent toute mon histoire. » Aujourd’hui encore, sa voix chute jusqu’à devenir inaudible à l’évocation de cette période de « fuite » et de recherche de nouvelles « cachettes ». Cette expérience-là n’est d’ailleurs pas relatée dans Ejo, son premier livre, paru en 2015.
Beata Umubyeyi Mairesse
En kinyarwanda (langue bantoue parlée au Rwanda), ce titre signifie à la fois « hier » et « demain ». Les nouvelles de ce recueil, d’une subtilité et d’une justesse rares, se déroulent avant et après le génocide, jamais pendant. C’est donc par le quotidien chamboulé des multiples narratrices que se révèle l’ampleur du traumatisme.
« Il y a beaucoup de présupposés en France sur ce qui s’est passé au Rwanda. On a parlé de « guerre tribale », on a pensé : « Ils s’entre-tuent depuis toujours », on a dit : « Dans ces pays-là, un génocide, ce n’est pas très important. » Je ne voulais pas laisser le lecteur indemne, mais pour y arriver, je voulais le prendre par la main délicatement, rendre ces femmes proches de lui en racontant des histoires intimes, qui pourraient être les siennes. Parfois, on voit mieux les choses en faisant un pas de côté. »
Des stylos subtils et pudiques comme refuges
En cela, les deux auteures sont peut-être héritières d’une certaine « pudeur » rwandaise – un terme que Beata Umubyeyi Mairesse récuse toutefois pour sa connotation morale. Sur les collines, les souffrances sont souvent tues. La langue poétique qu’on y parle, riche en métaphores et en proverbes, en est peut-être le reflet. Elle évoque et fait comprendre plus qu’elle ne désigne. C’est ce qui a fasciné l’écrivain et ancien journaliste français Jean Hatzfeld, auteur de cinq livres essentiels sur le génocide, rédigés à partir d’entretiens avec des Rwandais.
« Ils ont cette manière très pudique et très précise de contourner à la fois les difficultés et le mensonge, nous confiait-il, admiratif, lors de la sortie son dernier opus, Un papa de sang. Je pense que cette beauté de la langue est accentuée par la difficulté du sujet. Je ne sais pas s’il y aurait eu tant de subtilité et d’images il y a trente ans. »
Je suis la mémoire de ma famille. Si je garde ça dans la tête, je vais la perdre. J’écrivais partout. C’était obsessionnel. C’était normal. C’était ça ou je devenais folle
Ce qui est nouveau, en revanche, dans ce pays de tradition orale, c’est l’expression par le livre de fiction. « J’ai grandi à Butare, la grande ville universitaire et intellectuelle, se souvient Beata Umubyeyi Mairesse. Je lisais déjà beaucoup. Mais il y avait très peu de livres écrits par des Rwandais. Il y avait bien sûr ceux de l’abbé Alexis Kagame, mais il était historien. Je n’ai gardé le souvenir que d’un seul romancier rwandais : Saverio Nayigiziki, auteur de Mes transes à trente ans. »
Jusqu’en 1994, Scholastique Mukasonga ne se servait de ses stylos que pour rédiger ses rapports d’assistante sociale, profession qu’elle exerce toujours. C’est au moment du génocide que tout a changé. Elle avait 38 ans, et l’écriture est alors devenue une nécessité. « Quand c’est arrivé, je me suis dit : « Maintenant, je suis la mémoire de ma famille. Si je garde ça dans la tête, je vais la perdre. Il faut absolument la sauver. La seule solution, c’est d’écrire. » Je ne dormais pas. J’avais un carnet bleu. J’écrivais partout. C’était obsessionnel. C’était normal. C’était ça ou je devenais folle. »
Fixer la mémoire par le support inaltérable de l’écrit. À ce moment-là, ses textes n’avaient pas d’autre ambition. « Quand je suis retournée chez moi, en 2004, j’ai cherché les traces de l’endroit où j’avais grandi. J’ai couru dans cette brousse sèche. Mais je n’ai rien retrouvé. Je me suis dit : « L’affaire est grave. » J’ai tout de suite voulu rentrer en France pour organiser tous mes textes éparpillés, en faire un manuscrit et tenter de le publier. Je n’aurais jamais écrit autrement. Sans le génocide, pourquoi l’aurais-je fait ? »
Son histoire rappelle un personnage inventé par le romancier Gilbert Gatore : celui d’Isaro, une orpheline du génocide, dans Le Passé devant soi (prix Étonnants Voyageurs 2008). Ce livre très métaphorique, d’une saisissante intériorité, fut l’un des tout premiers romans rwandais sur le génocide (après Le Feu sous la soutane, de Benjamin Sehene, en 2005). Mais à aucun moment les mots « Rwanda » ou « génocide » n’y apparaissent.
On peut se confier à la feuille blanche sans qu’elle ne pose de question.C’est en cela que l’écriture est une chose exceptionnelle
Dans une mise en abîme vertigineuse de sa condition d’écrivain, Gatore décrit Isaro saisie par cette nécessité : « Au lieu de dormir, elle se mit à écrire. Cette journée venait de la décider à entreprendre un projet essentiel. Rédiger le résumé de cette entreprise ne pouvait pas attendre. Sur une feuille à part, elle s’appliqua d’abord à en calligraphier le titre : « En mémoire de… » » Isaro envisage d’abord d’écrire un livre monumental, rassemblant des témoignages. Puis elle change d’idée pour écrire… un roman.
« Les rescapés doivent d’abord parvenir à délier leur langue, explique Scholastique Mukasonga. C’est en cela que l’écriture est une chose exceptionnelle. On peut se confier à la feuille blanche sans qu’elle ne pose de question. » D’où cette interrogation : est-ce la tragédie rwandaise elle-même qui a engendré cette génération d’écrivains ?
C’est évidemment le cas pour les nombreux auteurs, eux-mêmes rescapés, qui ont raconté leur histoire. Comme Esther Mujawayo, Annick Kayitesi ou Révérien Rurangwa. Certains de ces témoignages ont des qualités littéraires indéniables. Ils ont permis de raconter l’Histoire en même temps que la leur. Ils ont souvent servi de catharsis aussi.
« Ce n’était pas du tout le cas pour moi, explique Beata Umubyeyi Mairesse. J’ai dû aller mieux avant de pouvoir écrire. » Mais serait-elle devenue écrivaine sans cette expérience ? Silence. « Je pense que oui, quand même, finit-elle par répondre. J’ai toujours aimé lire et raconter des histoires. Aurais-je pu écrire un premier livre sur tout autre chose ? Peut-être pas. Mais aujourd’hui, je travaille à un nouveau recueil, sur l’enfance. »

Ejo, de Béata Umubyeyi Mairesse, éd. Cheminante, 144 pages, 14 euros. © DR
Scholastique Mukasonga, elle, sait qu’elle n’écrira jamais un livre sans lien avec son pays. C’est en Guadeloupe qu’elle a fait le deuil de ce projet. L’obtention du prix Renaudot et les innombrables demandes de lecteurs pour un livre qui parlerait d’autre chose avaient fini par la convaincre de s’aventurer dans d’autres contrées. En 2013, à Pointe-à-Pitre, elle flânait donc en quête d’une inspiration venue d’ailleurs. « J’assistais à une manifestation de tambouyés [tambourinaires traditionnels].
Et puis quelqu’un est venu me demander d’où je venais. J’ai répondu : « Du Rwanda. » Et c’est là qu’il m’a dit : « Donc vous connaissez Nyabinghi ? Je n’en revenais pas. Les histoires de ma mère me sont revenues en tête. Le thème de mon nouveau livre venait de s’afficher. J’ai ensuite réalisé que j’étais prisonnière de mon pays, ce qui est formidable.

Benjamin Sehene. © Baudoin Picard
Je suis resté attachée à cet endroit dont on a voulu me détacher. Jusqu’au génocide, ce beau pays, mon pays, m’avait été interdit. J’y ai à nouveau accédé par l’écriture. Maintenant, je peux naviguer à l’intérieur. Aujourd’hui, si des lecteurs me reposent cette question, je leur répondrai : « Oui, je vais continuer d’écrire sur mon pays. » Il y a beaucoup de choses à dire sur le Rwanda. »
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles
